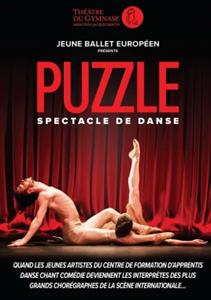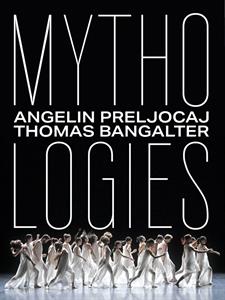Alice Ripoll / Lisa Vereertbrugghen / Sina Saberi
Alice Ripoll / Lisa Vereertbrugghen / Sina Saberi
- Chorégraphie : Lisa Vereertbrugghen, Sina Saberi, Alice Ripoll
- Avec : Lisa Vereertbrugghen, Sina Saberi, Leandro Coala, Alan Ferreira, Romulo Galvao, Tony Hewerton
Alice Ripoll / Lisa Vereertbrugghen / Sina Saberi - Photographies
- 1ère partie : aCORdo (30 minutes)
Répondant au départ à l'invitation à participer à une exposition autour de l'héritage laissé à Rio de Janeiro après la Coupe du monde de football et les Jeux Olympiques, Alice Ripoll a choisi de penser la ville à partir des danseurs avec lesquels elle travaille depuis huit ans et qui vivent dans les favelas, et signe une pièce engagée. En choisissant pour titre aCORdo, la chorégraphe fait ainsi référence à « l'accord » entre la Cour suprême, l'armée et des politiciens, supposé avoir fait tomber la Présidente du parti des travailleurs, Dilma Rousseff, mais aussi « la couleur de » tant il est vrai qu'au Brésil la frontière qui sépare blancs et gens de couleurs est toujours considérable.
Pour commencer, Alice Ripoll fait surgir une image puissante qui rappelle les corps qui aujourd'hui hantent les grandes villes, SDF et migrants.
Les quatre danseurs, d'abord au sol, finissent par se lever et danser, quatuor tournoyant, parfois chacun dans sa bulle, parfois ensemble, en accord ou en opposition. Jusqu'à ce que le « spectacle » bascule et que le public soit vraiment confronté à leur existence. On n'en dira ici pas plus, mais ce qui s'apparentait à une forme étrange et potentiellement ludique devient une pièce profondément politique, où le spectateur est soudain aux prises, sans intermédiaire, avec une situation vécue à répétition par la population des bidonvilles, mise à l’écart et soupçonnée. On peut aisément transposer la scène sous nos latitudes et le miroir ainsi tendu bouscule. « Notre organisation sociale permet d’ignorer totalement l’existence de certains d’entre nous : celui qui vient réparer votre chauffage, faire le ménage dans votre bureau ou vous servir un café. aCORdo expose leur invisibilité, leur soumission et questionne la peur du spectateur de remettre en question ces positions préétablies » affirme ainsi la chorégraphe.
Cela dure trente minutes mais ces trente minutes se gravent dans la mémoire, dérangeantes et fortes.
- 2ème partie : Softcore - a hardcore encounter (45 minutes)
Softcore - a hardcore encounter est une danse et une lecture physique qui aborde la culture Gabber née dans les années 1990, toujours cultivée dans les clubs et sur YouTube. Cette danse techno hardcore est connue pour sa vitesse extrême et ses distorsions si spécifiques. La chorégraphe belge questionne à la fois le « hard », le rigide et le « core », le coeur, l’âme. Elle fait évoluer la techno hardcore dans la danse softcore et l’érotisme, transforme des moments de vulnérabilité en spasmes percutants. Lancé à 200 bpm, le corps à haute vitesse fait tant partie de la société capitaliste que de sa résistance. Et si danser si rapidement devenait une réappropriation de la vitesse non pour la productivité mais pour l’opposé : la vitesse devient une astuce pour les sens, pour déjouer le contrôle.
Parmi les sons de la techno, il n'y a pas plus hardcore que le gabber, qui se déchaîne à 200 bpm (battements par minute). Quand elle se préparait à un parcours en danse contemporaine, Lisa Vereertbrugghen s'y frotta. Cette folie enthousiasmait son jeune frère. Résultat : la jeune artiste belge se voue depuis cinq ans à une exploration poétique et savante du gabber. Elle voulait toucher à l'idée d'un folk contemporain. Elle repousse les limites paradoxales de cette danse extrême.
Mais qu'entend-on par hardcore ? Quand le corps entre à ce point en course avec lui-même, quand il relève le défi jusqu'au bord fascinant d'un abîme, il se confronte à l'hypothèse d'un débordement, d'un envol et d'une perte de contrôle. Ce corps n'est pas de pierre ; de métal. Il s'ouvre. S'abandonne. Il révise les micro-circuits de ses connexions au monde. Il est souple. Poreux. Et même doux. Multiple, il foisonne de propos. Politique, ce corps suggère un softcore.
Le solo Softcore – a hardcore encounter, sur musique live qui remixe aussi la voix de la performeuse, restitue cette expérience. Il ne consiste pas à montrer du gabber. Rien de pittoresque. Il n'est pas plus un documentaire de niche. Il est la traduction poétique et savante, par une artiste chorégraphique, d'une pratique de corps exceptionnelle. Lisa Vereertbrugghen (déjà pour une précédente pièce avec sept danseuses) a sondé la variété obstinée des motifs corporels, là où les préjugés ne voudraient voir qu'un trait sommaire univoque.
L'artiste parle sur scène, d'un texte issu de l'épreuve du geste. Comprimée dans un jeu surpuissant aux limites, elle s'offre à la porosité généreuse d'une mise en perspective d'un corps à propos. C'est son art.
- 3ème partie : Damnoosh (50 minutes)
Damnoosh est créé dans la nécessité d’unité. Une invitation à la poésie, à la musique, aux rencontres à travers le simple acte de faire du thé. Sept herbes du sept coins de l’Iran sont choisies en relation à une histoire personnelle et à une histoire de la danse en Iran. La danse est imaginée collectivement avec le public comme un rituel, et petit à petit, incarnée.
En 2017, l’Iranien Sina Saberi était venu présenter Prelude to Persian Mysteries aux Rencontres chorégraphiques. Dans ce solo mystérieux, il était déjà question de la manière de faire de la danse dans un pays où celle-ci a été occultée pendant de nombreuses années par le pouvoir – la révolution iranienne de 1979 l'a condamnée et ce n’est que depuis peu qu’elle est parfois autorisée.
Avec Damnoosh, il poursuit cette exploration, sur le mode d'une performance dans laquelle il invite le public à découvrir le rituel du « damnoosh ». Mêlant poésie, musique et « naqqali » - forme ancienne de représentation théâtrale dans laquelle le conteur raconte des histoires en vers ou en prose tout en faisant des gestes et des mouvements -, il invite à la préparation d'un thé fabriqué à partir de sept herbes de différents endroits d'Iran choisis pour lui permettre de relater soit un récit personnel, soit une part de la grande Histoire, le plus souvent liés à la trajectoire de la danse en Iran.
Dans ce dispositif à la fois très simple et très quotidien, ce qui tient lieu de danse est son évocation, notamment à travers la figure d’une grand-mère dont le chorégraphe convoque à plusieurs reprises le souvenir. Quelques gestes d’une danse qu’elle pratiquait esquissés, quelques paroles remémorées, incarnent le passé et les trous de mémoire d’un pays. Plutôt que de vouloir à toute force les combler, celui-ci préfère les offrir en partage. À la fois leçon de choses et de géographie, jeu sur les représentations et les stéréotypes – il s’amuse à brouiller les images que l’on peut avoir de l’Iran en Occident – Damnoosh offre une pièce joueuse, ironique et tendre qui interroge l’air de rien la place du passé et la manière de lui redonner vie.
Alice Ripoll / Lisa Vereertbrugghen / Sina Saberi – Bandes-annonces
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - La Dynamo de Banlieues Bleues
La Dynamo de Banlieues Bleues
9 rue Gabrielle Josserand 93500 Pantin
- Métro : Aubervilliers-Pantin Quatre Chemins à 130 m
- RER : Pantin à 793 m
- Bus : Quatre Chemins - La Poste à 65 m, Quatre Chemins - Edouard Vaillant à 103 m, Quatre Chemins à 118 m, Quatre Chemins - République à 179 m
Plan d’accès - La Dynamo de Banlieues Bleues
9 rue Gabrielle Josserand 93500 Pantin