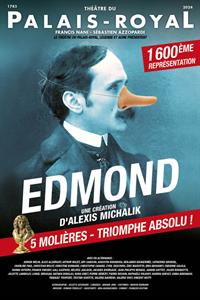Jan Karski (mon nom est une fiction)
Jan Karski (mon nom est une fiction)
Coup de cœur CONTEMPORAIN Le 14 juin 2017
- De : Yannick Haenel
- Mise en scène : Arthur Nauzyciel
- Avec : Laurent Poitrenaux, Arthur Nauzyciel, Marthe Keller, Manon Greiner
Jan Karski (mon nom est une fiction) - Photographies
« Plus encore que de ces images, je voudrais me libérer de la pensée que de telles choses ont eu lieu. » Jan Karski
- Le projet
Le livre m’a été envoyé par Yannick Haenel après qu’il ait vu Ordet. Il y reconnaissait une démarche semblable à la sienne : celle de considérer l’art comme « espace de réparation ».
Je lisais le livre à New York, pendant les répétitions de la reprise de Julius Caesar prévue à Orléans puis au Festival d’Automne. Je disais aux acteurs que pour jouer cette tragédie ils devaient être « comme des revenants : vous avez vu l’horreur du monde et vous le retraversez éternellement pour ne pas oublier ». Je pouvais lire la même phrase dans le livre, quand Karski parle de sa seconde visite du ghetto : « Je parcourus à nouveau cet enfer pour le mémoriser ». À New York, je pouvais suivre les traces de Karski, depuis son arrivée de Pologne par l’Angleterre, ses errances new-yorkaises rêvées par Haenel dans son livre : la Frick Collection, la Public Library. Je pouvais passer dans la rue qui porte son nom, derrière Penn Station. Je me retrouvais sûrement dans ce trajet.
Je l’ai lu quelques jours après la mort de mon oncle Charles Nauzyciel, frère de mon père, déporté à Auschwitz Birkenau de 1942 à 1945. Un des liens forts que j’avais avec lui s’est justement construit autour de cette expérience. Étant le premier né de ma génération, c’est à moi qu’il a commencé, tôt, à raconter son expérience concentrationnaire. J’avais une dizaine d’années. En famille, le dimanche, ou à d’autres occasions, avec ses amis anciens déportés comme lui, il racontait. Pas de manière solennelle, non, comme ça, comme ça venait, par associations d’idées. Mon grand-père maternel, lui aussi déporté à Auschwitz Birkenau de 1941 à 1945, me parlait beaucoup aussi. Mais dans un Français approximatif, plus physique, plus brut.
J’avais cinq ans quand il me racontait comment se partageaient les épluchures et comment on cachait les morts pour garder leur nourriture. Par exemple. J’écris cela pour expliquer que rien n’était de l’ordre de l’indicible chez moi. Tout était dit. Plusieurs fois, à des années d’écart. Et tout le temps, de nouvelles anecdotes, de nouvelles souffrances, de nouveaux souvenirs, c’était sans fin. Ce qui était raconté dépassait « l’entendement », mais enfin on entendait. Ce qui était « inimaginable » avait pourtant été imaginé, tellement bien imaginé et conçu, qu’assez facilement tout cela a pu être appliqué, organisé, par des gouvernements, des administrations, des fonctionnaires, des services publics, des entreprises, etc. Lois, appels d’offres, constructions, déportations, rafles, il a bien fallu que beaucoup de gens y participent pour que cela soit possible. À l’échelle de l’Europe, oui dans quatorze pays. Où est « l’inimaginable » ?
Haenel imagine ce qui a hanté les nuits de Jan Karski. Dans ma famille, on dit de ceux qui ont survécu, qu’ils en sont « revenus ». Le revenant, c’est très concret pour moi. Le revenant parle, raconte, se répète souvent, et a des nuits agitées. Le silence et les nuits blanches de Karski visité par ses fantômes déréalisent le propos, le replace dans quelque chose qui est de l’ordre du rêve (du cauchemar ?), de la vision. Il est habité. Submergé. Une telle conscience n’est pas indicible, elle est invivable. Le mérite du livre, c’est d’arriver par moments à nous faire ressentir quelque chose de cette conscience, de cette douleur inouïe, domestiquée, apprivoisée. La rencontre forte, comme d’inconscient à inconscient, avec le livre de Haenel était une possibilité de calmer l’inquiétude en moi, cette responsabilité un peu lourde, comme une injonction, celle de devoir témoigner pour les témoins : mes grands-pères, oncles, cousines, amis. L’angoisse de ne plus me souvenir dans le détail de tout ce que mon oncle m’a raconté. Une peur irrationnelle : il a été plusieurs fois interviewé, les enregistrements existent. La gêne aussi que cette parole rencontre à nouveau indifférence ou désapprobation polie (« ça va, on connaît », « on en a marre », etc). Cette gêne a été celle des déportés qui n’osaient pas dire, à leur retour, ce qu’ils avaient vécu, par peur d’ennuyer, par peur de ressentir l’indifférence ou l’ennui poli de l’interlocuteur. Je lutte contre ça en moi aussi, je me fais violence en abordant si frontalement la Shoah. Cette conscience, ces visions, ce savoir qui m’ont été transmis de manière quasi utérine sont en moi, ont toujours été en moi et le seront toujours. Il m’a fallu du temps pour passer de la survie à la vie. Aîné d’une génération qui est la première à ne pas avoir eu à fuir ou à se cacher, je sais que l’essentiel de mes actes, de mon travail, est consacré secrètement à calmer en moi la bête, le monstre, une douleur sourde et permanente à laquelle on s’habitue.
Je me rendais compte aussi que je ne connaissais pas la Pologne, d’où venait ma famille. « Je ne mettrai jamais les pieds en Pologne » est une phrase que l’on disait souvent. Sans nier l’antisémitisme polonais sur lequel on a déjà beaucoup dit, je me rendais compte en lisant le livre et découvrant l’histoire de cet homme remarquable, puis de beaucoup d’autres, qu’aujourd’hui il était important pour moi de créer des liens nouveaux avec ce pays. Travailler sur ce livre et ce projet est paradoxal : je le fais pour donner une voix à ces témoins disparus, à leurs visions et à leur effroi, pour réactiver ce passé puissamment douloureux, mais de façon à avancer dans mon histoire, afin de m’ouvrir des perspectives nouvelles. Je ne sais pas encore à quoi ressemblera ce travail sur Jan Karski. La polémique autour du livre ne me fait pourtant pas douter de la nécessité de le mettre en scène.
De chercher comment aborder cette question au théâtre aujourd’hui, quelle forme imaginer pour rendre compte de cette conscience qui déchire le livre. Nous avons quarante ans, et nous devons nous approprier l’Histoire pour en transmettre à notre tour quelque chose de fondamental. Nous le ferons peut-être maladroitement, alors d’autres le feront plus tard, mieux. Nous préparons le terrain. Haenel aborde des questions qui devront hanter encore, parce qu’elles sont le fondement de nos sociétés aujourd’hui, le ciment honteux de l’Europe, qu’il faut racler encore, notre avenir en dépend. Mais, déjà, je suis heureux du parcours que ce livre m’a fait faire pour pouvoir le mettre en scène : avoir enfin le courage d’aller à Auschwitz, ou à Siedlce, d’où viennent les Nauczyciel, près de Treblinka, se retrouver dans ce pays, y chercher les traces de ceux d’avant, un peu affolé, comme un chien renifle les trottoirs, avec l’espoir d’y retrouver une présence, un signe de présence.
Mais non, rien. On ne voit plus rien. Tout est dans l’air. Pourtant soixante-dix ans après l’exil, la fuite, je me suis retrouvé là, à passer du temps à Varsovie, travailler avec Miroslaw Balka, un des plus grands artistes polonais, répéter au théâtre TR à Varsovie, y faire des rencontres importantes. Il y a encore un an je n’aurais pas pu penser cela possible. Un miracle. Etre à Varsovie, créer à Varsovie, oui, vivant. Un horizon s’ouvre devant moi.
Arthur Nauzyciel, Mars 2011
D’après le roman de Yannick Haenel publié aux éditions Gallimard, 2009.
Avec la voix de Marthe Keller.
- La presse
« C'est d'une beauté violente, qui vous saute à la gorge, et les larmes viennent aux yeux. » Jean-Pierre Léonardini, L'Humanité, 8 juillet 2011
« Un comédien hors pairs. » Fabienne Darge, Le Monde, 8 juillet 2011
« Un spectacle austère et puissant » Vincent Josse, France Inter, 7 juillet 2011
- Le roman de Yannick Haenel
Les paroles que prononce Jan Karski au chapitre 1 proviennent de son entretien avec Claude Lanzmann, dans Shoah.
Le chapitre 2 est un résumé du livre de Jan Karski Story of a Secret State (Emery Reeves, New York, 1944), traduit en français en 1948 sous le titre Histoire d’un état secret, puis réédité en 2004 aux éditions Point de mire, collection « Histoire », sous le titre Mon témoignage devant le monde.
Le chapitre 3 est une fiction. Il s’appuie sur certains éléments de la vie de Jan Karski, que je dois entre autres à la lecture de Karski, how one man tried to stop the Holocaust de E. Thomas Wood et Stanislaw M. Jankowski (John Wiley & Sons, New-York, 1994). Mais les scènes, les phrases et les pensées que je prête à Jan Karski relèvent de l’invention.
Yannick Haenel, Note introductive, Jan Karski, Editions Gallimard, 2009
- Le spectacle
Le livre de Yannick Haenel parle du silence de Karski pendant 40 ans, de la passivité des Alliés, de l’abandon des Juifs d’Europe, et de l’unicité de l’extermination radicale de ce peuple. Mais au-delà de ce qu’il raconte, l’un des intérêts majeurs du livre est son dispositif, en trois parties.
Le spectacle sera l’adaptation du livre pour le théâtre, c’est-à-dire la mise en scène de ces trois parties en tant que parties, comme la continuité du roman même, et comme si le passage à la scène et l’incarnation par un acteur de Jan Karski, faisant de lui un personnage et un revenant, en constituait un 4 ème chapitre. À la fin du livre, la logique appelle la matérialisation de cette parole. La transmission du message. Dans la continuité du rêve proposé par Haenel, on aimerait voir alors apparaître un homme qui dirait : « Je suis Jan Karski, j’ai quelque chose à dire », et l’on serait en 1942, et il serait entendu…
Ce qui m’intéresse dans le livre d’Haenel, c’est comment cet homme, l’un des plus fascinants du XX ème siècle, hanté et habité par son message dont il pense qu’il n’a pas été entendu, a vécu à l’intérieur de ce silence. Le théâtre est par essence lieu du mystère, de ce qui échappe, de l’évocation des morts et du revenant.
Le théâtre me semble être aujourd’hui l’un des rares lieux possibles pour raconter cela, pour témoigner de la complexité du monde et des êtres. Art paradoxal qui peut être à la fois le lieu du silence et de l’écoute, où l’on peut raconter à la fois une parole, et la défaite de cette parole.
Dans le roman, Karski parle pour réactiver la mémoire et l’existence de ceux qu’il n’a pu sauver. Il parle pour ne pas oublier et transmettre une expérience de l’enfer. Donner un espace à Karski pour parler, même à travers la vision romancée d’Haenel, c’est donner un auditoire à cette parole, c’est donner du sens à ce silence, à son obsession, ce ghetto revisité des centaines de fois en rêve, ce message ressassé pendant des années. C’est faire résonner les six millions de voix qui ont hanté cet homme toute sa vie.
Ce dispositif, ni didactique ni idéologique, relève d’une certaine délicatesse : il raconte l’histoire d’une parole, et aussi la tentative d’un romancier de la retenir, de la transmettre, de l’interpréter, afin de rendre compte avec les moyens de la littérature de ce que l’historien ne peut documenter : les cauchemars, la nausée, le silence. Le livre imaginé par Haenel pose de manière aiguë la question de la représentation. Non pas celle de l’extermination, mais celle d’un témoignage : quel équivalent théâtral trouver alors, pour rendre compte de ce roman, qui passe par le documentaire, la biographie, puis la fiction ? Pour tenter de rendre compte d’un homme, du message qui l’a hanté, et d’une vie hors du commun : un « personnage » qui meurt et ressuscite plusieurs fois, dans toutes les acceptations du terme, en plusieurs pays, un « personnage » multiple dont on se doute bien que la vérité n’est que la somme de toutes ces inventions : grand bourgeois polonais, catholique pratiquant, espion, diplomate, aventurier, professeur américain, citoyen d’honneur israélien, fait « Juste parmi les nations ».
À travers lui, à travers la structure du roman d’Haenel, ce spectacle espère témoigner à son tour d’une génération, celle qui, comme Paul Celan, se demande, alors que les survivants disparaissent : « Personne ne témoigne pour le témoin », sans ponctuation, ni question ni affirmation, une phrase ouverte, qui semble flotter et nous renvoie à nous-même. Cette question est aujourd’hui fondamentale. Ma génération doit assumer l’héritage des historiens, les témoignages de ceux qui disparaissent, les études et les oeuvres consacrées depuis un demi-siècle au judéocide et à partir de cela, tenter, inventer, proposer de nouveaux modes de transmission. Qui va transmettre, quoi et comment ? Quelles formes artistiques peuvent naître de ce questionnement qui ne soient pas la reproduction de ce qui a déjà été fait ? Le roman d’Haenel se situe dans ce questionnement-là. Son dispositif même suggère la multiplicité des formes de représentations, et donc la difficulté d’en penser une plus juste qu’une autre, le souci de se replacer dans l’histoire, en inventant une voie pour aujourd’hui, en s’appuyant sur le socle construit par les prédécesseurs. Ce dispositif qui n’aborde la fiction qu’en 3 ème partie, révèle la difficulté de la fiction mais aussi sa nécessité.
Pour répondre au défi que représente cette adaptation sur scène, j’ai voulu réunir un groupe de personnes dont l’histoire, ce qu’ils sont ou représentent, fait déjà sens : ces artistes réunis autour du projet Jan Karski (Mon nom est une fiction) viennent de France, Belgique, Pologne, Suisse, Autriche, Etats-Unis. Ils sont le voyage de Karski, voyage qui nous rappelle que l’événement est européen et américain. Comme toujours, je pense que le processus et les rencontres imaginées ou produites pour construire un spectacle doivent en devenir le sujet même. Le spectacle sera créé à l’Opéra-Théâtre municipal, au Festival d’Avignon. En plein centre-ville. Comme pour nous rappeler que ce monde qui n’était pas le monde était pourtant en plein coeur de Varsovie. Les murs qui l’encerclaient dessinant à ciel ouvert un immense tombeau où gisaient, assassinés, des centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants. Ce témoignage, documentarisé, biographié, romancé, est celui d’un Catholique polonais raconté par un Français de quarante ans. Le spectacle parle donc aussi de ce regard-là sur cet homme et son histoire, un témoin majeur de l’extermination radicale, politique et industrielle des Juifs, en France comme dans le reste de l’Europe. Ce regard raconte quelle empathie (« se mettre à la place de »), quelle conscience, cette génération peut avoir de l’Histoire, avec ce qu’elle sait aujourd’hui et ce qu’elle voudrait transmettre.
Arthur Nauzyciel, Mars 2011
Jan Karski (mon nom est une fiction) – Bande-annonce
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Les Gémeaux - Scène Nationale de Sceaux
Les Gémeaux - Scène Nationale de Sceaux
49 avenue Georges Clémenceau 92330 Sceaux
- RER : Sceaux à 602 m
- Bus : Les Musiciens à 103 m, Les Blagis à 210 m, Les Blagis à 321 m
Plan d’accès - Les Gémeaux - Scène Nationale de Sceaux
49 avenue Georges Clémenceau 92330 Sceaux