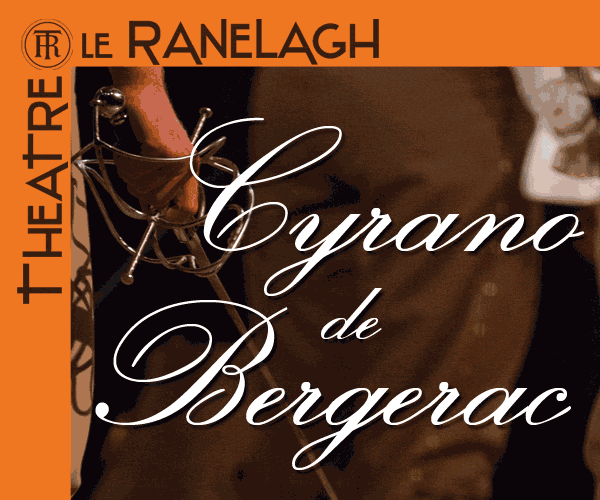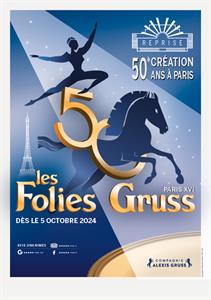L'homme de Hus
L'homme de Hus
Coup de cœur CONTEMPORAIN Le 1er janvier 2017
- De : Camille Boitel
- Avec : Camille Boitel
L'homme de Hus - Photographies
Tout public dès 8 ans.
- Bataille désespérée et libre avec les choses
De l’intérieur d’un amas de tréteaux, un homme au corps encombré s’extrait comme il peut ou comme, en vérité, il ne peut pas puisque le voilà misérablement coincé et plaqué par toutes sortes d’objets et de machines. Pourtant, jamais il ne renonce au combat.
L’agilité virtuose de Camille Boitel, sa bataille désespérée et libre avec les choses, provoquent une intense jubilation poétique. L’Homme de Hus révéla son travail dès 2003.
« Travailler sur le burlesque est déjà une forme de critique sociale : il s’agit de prendre un système, quel qu’il soit, et de le faire s’écrouler. » Camille Boitel
« Je vais parler tel que je le sens, amoureux du langage, mais dans ce spectacle il n'y a que des mots qui tombent comme des pierres, qui tapent des pieds. Les idées sont en miettes dans ce spectacle, il s’agit de décharges, de drôleries, de désespoirs et de risques mêlés, les enfants l’aiment, et j’aime que les enfants l’aiment, les adultes ont plus peur que les enfants, c’est un spectacle gouffre, raide, et fou furieux, tout ce que je dis et même maintenant ment, mentira toujours, mon rêve est de me taire, mais je voudrais que vous soyez là, je suis encore trop fragile pour me taire, alors je réponds à des questions et à des demandes, mais L’Homme de Hus n’a rien à dire, n’a rien a expliquer, n’a rien expliciter, il a lieu, il parle par lui même, et son langage n’est pas fait de mots, mais de ce tissage qu’il faut vivre avec sa présence, j’attends de pouvoir me taire, d’avoir cette force magique qui fait que vous veniez sans avoir eu besoin de ne rien savoir… » Camille Boitel
- Entretien avec Camille Boitel
L’Homme de Hus d’aujourd’hui sera-t-il le même que celui de la création (2003) ? Qu’est-ce qui a changé dans le spectacle ?
Ce spectacle était pour moi la seule manière d’écrire, j’avais mis tout ce que je pensais important, il agissait comme son propre manifeste, et après Hus je n’avais pas besoin de faire d’autres spectacles. Quand je l’ai arrêté, c’était pour l’enterrer. J’avais tenté plusieurs fois d’y affiner des choses à l’époque, et je constatais qu’il était toujours meilleur dans sa brutalité d’origine, dans sa forme instinctive. Aujourd’hui, si quelque chose a changé, ça n’est pas tellement dans son écriture, que j’ai cherché à retrouver telle qu’elle était (je viens me nourrir à cette source, partager cette oeuvre que j’aime), mais peut-être dans de minuscules différences rythmiques, légers changements qui m’instruisent sur ce qui a changé dans mon élan artistique. Mais ce qui est intéressant c’est que le temps ne m’a pas donné de marge, il fallait que je retrouve cette totale implication. Jusqu’aux premières j’ai eu la sensation que je n’en étais plus capable. Le chemin s’est fait, dans le corps, dans la mémoire, et dans l’instant, comme s’il s’agissait d’inventer quelque chose de neuf, quelque chose qui n’existait pas, plus, ou qui avait disparu en moi.
Comment est construit le spectacle ? Y a-t-il une idée qui l’organise ?
C’est un spectacle par rythmes. Les choses se font écho. Elles ont toutes les mêmes racines, mais elles fonctionnent par séquences. Neuf séquences en trois parties. Qui ont des temps et des textures totalement différentes. C’est a travers ce spectacle que j’ai compris que ce qui comptait pour moi c’était l’explosion du discours, et une ouverture du sens, un éclatement. Et c’est toujours mes bases de travail. Je sens que c’est pour moi exactement l’endroit de l’écriture scénique, insoumise à l’ordre, à la logique ou au temps. Dans L’Homme de Hus un manteau et une robe jouent un rôle essentiel. Dans un autre spectacle ce sont des couches.
Les vêtements sont-ils une façon de vous construire des corps différents ?
Oui, les vêtements ont un rôle de décalage, il fallait toujours trouver quelque discours vestimentaire qui tende les situations, brouille les idées reçues… Très clairement, ici, il y a toute une séquence qui est rendue grotesque parce que le vêtement et le corps qui l’habite ne correspondent pas, le corps et le vêtement se confondent et c’est bien un corps difforme que l’on voit, par la forme de ce vêtement. Nous avons refait, alors nous avons pu voir que c’est une proportion exacte qui rend ce terrible effet comique, à quelque centimètre près il s’agit d’un vêtement, puis rallongé, élargi, voilà que c’est un corps.
Le titre fait un clin d’oeil à l’homme préhistorique. Diriez-vous que vous cherchez à rejoindre un certain état antérieur de l’homme ?
Effectivement ce spectacle est archaïque. Il n’y a que des vertèbres, des mains, des jambes nus, des gestes préhistoriques, et l’humain n’est pas ou plus sûr d’exister. Un être et ses fondements en ruines.
Dès ce premier spectacle, on trouve le thème du corps en prise ou en lutte avec les objets. Est-ce qu’on pourrait dire que votre travail vise à permettre un ajustement entre l’homme et les choses ?
Les objets ici sont tous les mêmes, ils sont milles choses, ils se transforment, ils ne représentent pas les objets, mais le monde, ils sont un dédale, des troupeaux, des machines ou de la pensée. Les objets sur scène m’ont en effet beaucoup servi. Je pense que je suis un vrai manipulateur d’objets. C’est ce qui m’a fait comprendre comment je voulais jouer, c’est une sorte de constante dans mon travail. Mais je n’aime pas tellement les objets à vrai dire, c’est pour la scène que je les trouve importants, ils ramènent nos vies, ils nous donnent une sorte d’émotion liée à nos expériences physiques avec les choses, au milieu des choses…
La quête de la Jubilation qui parcourt beaucoup de vos spectacles est-elle déjà présente ?
À vrai dire, il ne s’agit pas tellement d’une quête de jubilation, mais plutôt pour moi d’une jubilation de l’écriture scénique, la jubilation est un symptôme de l’écriture. On n’a pas juste quelque chose a dire, il y a ce qui déborde. Je me suis ici nourri de la figure de Job qui, après avoir tout eu, perd tout en même temps. Son corps est devenu un abcès et tous ses proches tentent de le persuader qu’il a dû bien le chercher et qu’il y a un sens à tout cela. Cette terrible histoire devrait nous faire frémir et nous laisser le front plissé, mais j’ai utilisé tous les vieilles ficelles comiques, burlesque-absurde-grotesque, et une technique physique inspirée du vertige tel qu’on le pratique dans le vieux cirque. Et voilà que le bruit des spectateurs est joyeux, le rire est profond et humide, caverneux, et l’amertume est délectable. Oui je jubile en tant que spectateur, c’était mon premier rêve de spectateur.
Propos recueillis par Stéphane Bouquet, juin 2016
- Note de Camille Boitel
Dans une faible lueur une silhouette tâtonne sans bruit.
Elle tente simplement de mettre en place une table et une chaise pour s’installer face à nous.
Mais chaque geste se désagrège en petits accidents.
De légers détours insignifiants qui alourdissent chaque tentative de poser ou de prendre.
Et peu à peu, le silence s’effiloche.
Les objets s’ébouriffent, résistent et grincent.
Et le but limpide des gestes se recroqueville.
S’écarte et s’atténue.
Le sens et les objets tombent en ruine.
Et les nombreux débris de tentatives de simplement mettre cette foutue table s’accumulent et s’entassent démesurément. Accidentant tout.
Il ne reste que ce corps en miette par décharges qui tombe à plat dos.
Et les craquements vertébraux du bois.
Il y a un cri monumental dans l’obscurité et des mots qui tombent de sa bouche comme des pierres.
La perte du poids d’un corps, une illumination, des allers-retours amnésiques, et la résurgence d’un corps aux difformités grotesques pourfendant l’hilarité.
Puis vient l’attaque frontale d’une machinerie des objets devenus des monstres moyenâgeux et cela se termine par un dédale. Noir.
Ce spectacle je m’étais promis de ne plus le jouer, par peur de le trahir, de m’habituer à le jouer, de le faire à moitié. C’est après quelques nuits d’insomnies à le rejouer dans les méandres de ma mémoire, dix ans après, que j’ai pris la décision brusque de le retrouver, sentant qu’il était une nourriture dont j’avais besoin artistiquement. Non pas la reprise d’un vieux spectacle, mais quelques traditions ancestrales, quelques poèmes préhistoriques encore à inventer.
L'homme de Hus – Bande-annonce
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Théâtre de la Cité Internationale
Théâtre de la Cité Internationale
17, boulevard Jourdan 75014 Paris
- RER : Cité Universitaire à 157 m
- Tram : Cité Universitaire à 32 m
- Bus : Cité Universitaire à 223 m, Stade Charléty - Porte de Gentilly à 320 m, Jourdan - Montsouris à 358 m
Plan d’accès - Théâtre de la Cité Internationale
17, boulevard Jourdan 75014 Paris