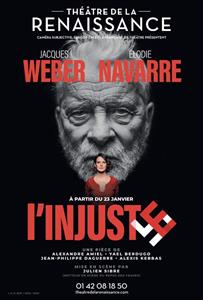La comédie indigène
La comédie indigène
- De : Lotfi Achour
- Mise en scène : Lotfi Achour
- Avec : Thierry Blanc, Marcel Mankita, Ydire Saïdi, Lê Duy Xuân
Clic, clac, cliché
Entretien avec Lotfi Achour
C’est bien connu, le Chinois est "lubrique" et a "les muqueuses couleur carmin"... La Négresse, pourtant "admirable de forme", a "le cerveau gourd et stagnant" et "les seins tombants au premier enfant". L’Arabe est "fourbe", "sodomite" et... nyctalope". L’indigène a une vie "essentiellement végétative et instinctive" et c’est "une sécrétion fournie par le foie qui noircit la peau de l’Ethiopien"... Il vaut mieux en passer et des pires ! Le reste est à l’avenant et le florilège réuni par Lotfi Achour, tout simplement monstrueusement effrayant.
Un conférencier es-exotisme lit des extraits du livret distribué aux militaires français partant aux colonies (1927) et quelques citations empruntées à Montesquieu et Tocqueville, Lamartine et Maupassant, Flaubert, Gide et Conrad, tandis qu’un contradicteur vient esquisser une réponse en citant, parmi d’autres, Achille Mbembe ou Aimé Césaire...
Et si toutes ces belles pensées avaient pour auteurs des signatures dûment répertoriées dans la catégorie des racistes invétérés, penseurs xénophobes, écrivains nauséabonds et autres intellectuels fangeux, tout serait dans l’ordre des choses mais il n’en est rien et les citations empruntées, ici,à Montesquieu et Tocqueville, Lamartine et Maupassant, Flaubert et Pierre Loti, là, à Gide, Conrad et Simenon sont inquiétantes et doivent nous mettre en garde. La bêtise est ferme, tenace et… commune. Elle est sans âge et sans ride. Elle se joue du temps et défie les distances. Elle persiste et signe.
Regard de l’Occident sur l’Autre, barbare et lointain, galerie du fantasme et du cliché, xénophobie tranquille, racisme estampillé scientifique ou labellisé par les grands esprits, repris sans nuance par les meilleures plumes... D’un côté le savoir, la civilisation, le bon sens et la bonne conscience. De l’autre, l’étrange, le lointain (parfois si proche), le barbare, l’indigène, celui que l’on mon(s)tre, que l’on exhibe, que l’on caricature, que l’on expose… colonialement. La Comédie indigène serait une farce grotesque s’il ne s’agissait que d’un délire paranoïaque de quelques-uns, si elle n’était une tragédie et si l’on était bien sûr qu’elle appartient à une autre époque.
Certes, quelques esprits éclairés sont venus apporter des retouches à ce costume sur mesure, et aujourd’hui d’autres regards tentent un bilan critique, entre remords et regrets, désillusions et amertume, illustration de l’oeuvre et satisfaction du “devoir” accompli, dénonciation virulente d’un processus oppressif et honte devant certaines révélations tardives…
Mais les aberrations ont laissé des traces et leurs effets collatéraux, plus sourds et plus subtilement mal pensants, sont encore d’actualité. Et c’est bien là la raison de ce parti-pris d’en rire qui nous est offert en réponse au burlesque involontaire de la démesure. Et c’est bien là la force de ce miroir grimaçant qui nous est tendu.
Bernard Magnier
Textes du livret distribué aux militaires français partant aux colonies (1927) et de Aimé Césaire, Joseph Conrad, Frantz Fanon, Gustave Flaubert, André Gide, Victor Hugo, Dr Jacobus x, Alphonse de Lamartine, Guy de Maupassant, Achille Mbembe, Montesquieu et Alexis de Tocqueville.
Comment est née l’idée de La Comédie indigène ?
Depuis longtemps, j’avais envie de travailler sur l’enseignement
du français dans les anciennes colonies françaises, et
sur ce que cette langue a véhiculé comme idées, représentations,
fantasmes de l’Autre. Je voulais travailler surtout à partir
des manuels scolaires et des méthodes d’enseignement du
français aux militaires indigènes. Avec Natacha de Pontcharra,
nous avons même écrit un premier texte qui imaginait le voyage
d’une petite troupe de militaires indigènes, de Saint-Louis du Sénégal jusqu’à Paris en passant par Alger. Ils étaient
accompagnés de deux officiers français qui avaient pour mission
de former, sous nos yeux, ces militaires "à la civilisation"
avant de les "exposer" à l’Exposition Coloniale de 1931 à
Vincennes, comme preuve vivante de la réussite de la Mission
Civilisatrice, si chère à la Troisième République.
Ce texte n’a jamais été mis en scène, car à un moment,
je pensais qu’il y avait quelque chose de dépassé dans
cette démarche, que la société française, avec le métissage à grande vitesse qu’elle vivait, était en train de dépasser ces
questions, de régler le problème de l’histoire coloniale par le silence et en allant de l’avant. Que c’était peut-être possible
de régler ça comme ça !
Mais l’envie de travailler sur ce moment
de l’Histoire ne m’avait pas quitté. Et puis la loi de février
2005 sur les "bienfaits" de la colonisation est passée par là,
apportant la preuve que cette époque est loin d’être révolue.
Et ce qui était une envie de fiction est devenue pour moi une
nécessité de visiter l’Histoire.
En effet, concernant la période coloniale, tout à coup,
le silence et l’occultation faisaient place, avec cette loi, à une
attitude et une volonté de révision de l’Histoire, menée notamment
par des élus du peuple. J’étais très en colère et j’ai alors
décidé de ressortir ce projet. Mais là, la pure fiction ne me
satisfaisait plus et j’ai eu envie de plonger dans les écrits, les
faits, les témoignages… sur ce qu’a été véritablement cette époque. Et c’est comme ça qu’est née cette deuxième version
de La Comédie Indigène.
Comment avez-vous composé votre spectacle ?
Mon travail a d’abord consisté à accumuler un matériau très
hétéroclite, constitué d’écrits scientifiques (ou considérés
comme tel) sur l’inégalité des races, de textes de grands écrivains
principalement du XIXe, de chansons exotiques et coloniales,
de débats à la Chambre des Députés entre 1830 et 1847.
Pourquoi avez-vous choisi principalement cette période ?
Cette période est très particulière car elle correspond au début
de la conquête de l’Algérie et de l’entreprise coloniale française.
Elle a été un des moments les plus terribles de l’histoire
franco-algérienne, un des plus meurtriers, des plus
barbares avec, bien sûr, plus tard, la guerre de libération.
Cette période correspond surtout à un moment où la France,
par la voix de ses députés, hésitait entre l’extermination
pure et simple de tous les Algériens, leur déportation ou un
moyen de les soumettre et de "pacifier" le pays… Tout le
monde était d’accord sur la supériorité de l’Homme Blanc et
sur la justesse de cette action, pour le bien même des Algériens,
qu’on appelait plutôt, à cette époque et pour très longtemps, "indigènes". Et ces différentes options ont été débattues à la Chambre, et mises en application, partiellement ou
entièrement.
A partir de ces matériaux, comment s’est imposée l’articulation
de votre spectacle ?
Dans un deuxième temps, il a fallu trouver un fil conducteur à tout ça, et surtout un lien avec aujourd’hui, car c’est d’abord ça qui m’intéresse. J’ai donc décidé de m’intéresser aux
représentations qui ont été faites des "indigènes" sur un
siècle, entre 1830, début de la colonisation, et 1931, date de
l’Exposition Coloniale de Vincennes, qui correspond au moment
où l’Empire Colonial français a été le plus grand, mais
qui correspond aussi au début du déclin de cet empire. J’ai
voulu comprendre le processus de fabrication d’un imaginaire
collectif et surtout, à travers tout ça, interroger chacun
sur les traces qu’il porte encore en lui de cet imaginaire. Et il
en reste beaucoup…
Pouvez-vous nous parler de ce "processus de fabrication
d’un imaginaire collectif" ?
Le projet colonial a été une véritable
réunion de tout le
génie français, de
tous les talents (à
part quelques exceptions
comme
les Surréalistes et
leur contre Expo)
qui ont contribué à
construire cet imaginaire
et à justifier
l’action coloniale.
Les scientifiques
cautionnaient cette
action en établissant
la supériorité
de la "race" blanche
sur le reste du
monde, en bestialisant
l’autre, en projetant sur lui, sur son corps surtout, toute
l’inhumanité. Les politiques s’appuyaient sur cette pseudoscience
pour justifier leur action. Les écrivains célèbres et
moins célèbres inventaient des récits pour exalter cette
action ou pour donner envie aux Français de la métropole
d’aller s’installer dans les colonies. Les paroliers et chansonniers
faisaient eux aussi rêver de ces contrées lointaines
et flattaient l’homme blanc aux dépens du sauvage. De
même pour les peintres et, plus tard, pour les photographes,
le cinéma, la publicité… Une production phénoménale et
ininterrompue pendant des décennies.
Avant de plonger dans tout ça, on n’imagine absolument
pas à quel point cette entreprise a été démente et à
quel point l’esprit humain a "déliré" et a été inventif durant
cette période. Tous les Tocqueville, Maupassant, Marx, Hugo,
mais aussi plus récemment, Charles Trenet, Francis Blanche…
et même Audiard qui dans un de ses films des années soixante,
parle, par la voix de Gabin, du jazz comme de la "musique
de singe"… On n’a donc pas besoin d’aller très loin dans le
temps parfois.
Outre la remise à jour de ces propos, quels étaient vos objectifs
en réalisant ce travail ?
Je voulais m’intéresser au pouvoir de ceux qui détiennent la
parole publique dans la fabrication de cet imaginaire, dans la
fabrication des clichés, dans la fabrication des généralisations,
ceux qui ont un pouvoir énorme pour modeler l’imaginaire
collectif et par là, les comportements collectifs. Ce
pouvoir est d’autant plus dangereux aujourd’hui, avec tous
les moyens de communication dont nous disposons, si on ne
sait pas le manipuler quand on le détient.
Et les propos recueillis trouvaient un écho dans d’autres
prises de paroles plus contemporaines…Le projet de loi sur les "bienfaits" de la colonisation commençait à libérer aussi une parole qui n’avait pas osé s’exprimer
jusqu’alors, celle par exemple d’une Hélène Carrère
d’Encausse qui reliait les émeutes en banlieue à la polygamie,
ou celle d’un Finkielkraut affirmant que la colonisation
a apporté la civilisation aux sauvages ! Et j’en passe… Ce qui
est drôle, si l’on peut dire, c’est que cette histoire de polygamie était déjà évoquée par Montesquieu deux siècles auparavant,
qui la reliait lui au climat du sud, chaud et moite, qui
excite les sens et fait des noirs, arabes, etc. des bêtes à plaisir.
Je pense qu’en fait, cette vision n’a jamais totalement disparu
des esprits, et c’est pour cela qu’elle refait surface,
comme tant d’autres choses.
Dans le même ordre d’idée, on a toujours parlé des
colonisés en Algérie par exemple en les assimilant tous à des
musulmans. Et c’est exactement ce qu’on fait aujourd’hui en
France en nous comptabilisant tous dans les cinq millions de
Français musulmans. Peut-être pour grossir la peur ! Or nous
sommes nombreux à ne pas être musulmans, nombreux à avoir
transgressé l’ordre social ou religieux dans lequel nous sommes
nés, à avoir traversé par notre esprit (ou à notre corps défendant)
de grandes violences, à avoir accepté d’affronter nos
sociétés où il est difficile d’affirmer ses convictions, notamment
religieuses. Nombreux à ne pas nous reconnaître dans cette "classification" qui nous ramène à l’état de masse, comme ce fut
le cas à l’époque coloniale, où l’indigène était un sans nom, un
sans tête, un sans visage, et n’était jamais reconnu dans son
individualité, dans sa singularité, mais toujours au sein d’une
communauté, dans le meilleur des cas.
Avec cette démarche, à quel public pensiez-vous vous
adresser ?
Je crois qu’en interrogeant cet imaginaire, je n’interroge pas
seulement les Français de "souche", mais aussi les autres,
les Noirs, les Arabes… En effet, je pense que le spectacle
s’adresse aussi à eux, à la fois comme "producteurs" de clichés
à leur tour, mais aussi comme personnes ayant intériorisé
les images qu’on a créées d’eux.
En effet, cette intériorisation des images par ceux-là
même qui en sont les victimes, est également un classique
du genre. Albert Memmi en parle très bien. Il y a souvent
une reproduction des clichés par ceux qui en sont les
victimes, car cela peut servir tout à fait leur intérêt, dans la
mesure où c’est ce que l’on attend d’eux.
Pouvez-vous nous donner un exemple ?
J’étais, il y a quelques mois, sur un forum Internet
consacré au livre de Serge Bilé, La légende du sexe surdimensionné
des Noirs, et je suis tombé sur un texte de lecteurs
noirs qui insultaient violemment l’auteur, lui reprochant
de leur "casser la baraque", car un de leurs atouts
pour séduire résidait dans cette idée très répandue chez les
Blancs, qu’ils ont des sexes énormes et sont des bêtes de la
chose… !
C’est cette complexité et ce rapport entre le dit et
les non-dits qui m’intéresse à travers ce spectacle.
Vous-même en tant qu’artiste, metteur-en scène, n’êtes-vous
pas victime de ces images, de ces attentes ?
Il m’est arrivé quelque chose de cet ordre-là dans mon propre
travail, il y a quelques années. Je travaillais sur le livre Oum de Selim Nassib, qui raconte la vie de la grande diva égyptienne,
Oum Kalsoum. Je voulais en faire une adaptation
théâtrale, et j’ai demandé à Adel Hakim de l’écrire et au
compositeur Anouar Brahem, d’assurer la direction musicale
du spectacle. C’était un spectacle très lourd financièrement,
et pourtant je n’ai eu pratiquement aucune difficulté à
monter la production. Le ministère ne m’a jamais donné
autant d’argent et j’ai été coproduit par des structures
importantes. Bien entendu, j’étais très content et je les en
remercie, mais en même temps je demeure assez perplexe.
Je pense que ces gens m’ont aidé à cause de l’intérêt du projet,
de sa qualité et de la grande qualité des collaborateurs,
mais aussi parce qu’ils trouvaient là une évidence : j’étais là
où je pouvais être le plus créatif. J’étais à ma meilleure place
en tant que metteur en scène… dans un spectacle sur une
diva arabe, écrit, adapté, dirigé musicalement et mis en
scène par des Arabes !
Au-delà de mon intérêt et de la passion que j’ai eu
pour cette aventure artistique qu’a été la création de Oum, je
pourrais même m’interroger et me poser la question : Est-ce
que je n’ai pas moi-même intériorisé ce qu’on attend de
moi ? Et ça ne s’arrange pas puisque j’ai des projets d’auteurs
arabes que j’ai envie de mettre en scène en France.
Il est donc encore difficile de sortir des lieux où chacun est
attendu…
Pendant des années, j’ai travaillé avec la dramaturge Natacha
de Pontcharra, et je me suis entendu dire à plusieurs reprises
- y compris par ceux qui avaient le pouvoir de financer - queça serait bien que je monte des auteurs arabes. Bien sûr, je
n’ai rien contre ça puisque c’est ce que je fais quand je travaille à Tunis par exemple, mais je pense qu’il y a là aussi
une chose qui relève de cet imaginaire que j’essaye d’ausculter,
même si je n’ai aucun doute sur la sympathie et la
bonne foi des gens qui m’ont soutenu. (...)
Propos recueillis en juillet 2007 par Bernard Magnier
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Le Tarmac
Le Tarmac
159 avenue Gambetta 75020 Paris
- Métro : Saint-Fargeau à 184 m
- Bus : Saint-Fargeau à 128 m, Pelleport - Gambetta à 208 m, Pelleport Bretonneau à 313 m
Plan d’accès - Le Tarmac
159 avenue Gambetta 75020 Paris