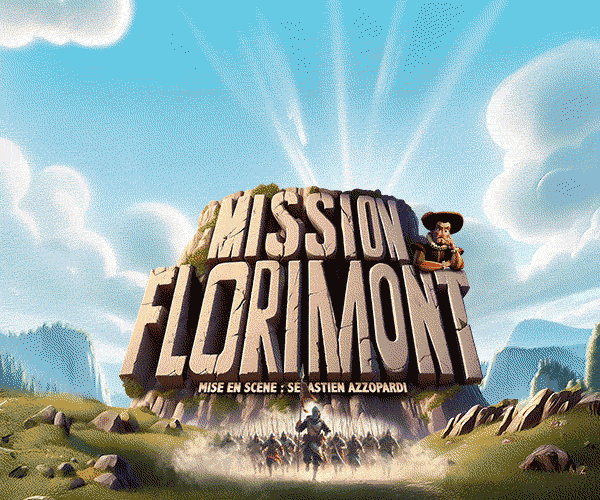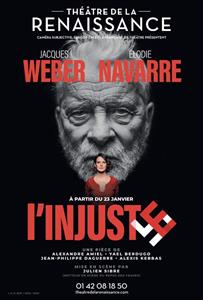Moi, fardeau inhérent
Moi, fardeau inhérent
- De : Guy Régis Junior
- Mise en scène : Guy Régis Junior
- Avec : Nanténé Traoré
Une femme est seule dans la nuit, elle attend. Il pleut.
Ombre. Prétexte. Fantôme. Peut-être ? Frêle apparition qui parle et dit sa déchirure, sa blessure à jamais ouverte, le secret longtemps gardé dans son corps flétri, son fardeau.
A fleur de mots, une silhouette dans la nuit, avec des paroles de lune dans une pluie opaque. Elle évoque le temps d'avant. Elle attend le temps de la vengeance. Elle attend l'homme, cette charogne. Elle l’attend avec, dans sa main, l'orage et le glaive.
Un texte d'une grande charge poétique doublé d'un propos politique engagé, un regard acéré posé sur Haïti, son quotidien, ses beautés et ses laideurs.
- Extrait
"Toujours attendre /
Que notre vie soit pesante ou légère /
Attendre /
Accepter /
Pour geindre /
Simplement rester en vie /
Même de se savoir offensé /
Même dans une vie elle-même entichée ou atroce /
Tous attendre /
Accepter /
Héberger en nous ce qui peut advenir /
Possible victime certes possible /
Vaincu d'avance /
Mais attendre"
- Entretien
Bernard Magnier : Pourriez-vous nous dire comment est né ce texte ?
Guy Régis Junior : Il y a toujours une préexistence à la genèse de la genèse d’un texte. Tous les textes que nous écrivons ont leurs prémisses déjà cachées en nous. Ils sont nés avant même d’être nés. Et souvent la première phrase rassemble, corrobore l’idée qui nous a travaillé depuis des temps. Je suis peu surréaliste et je ne crois pas que le subconscient crée et que l’esprit emmagasine tellement de choses qu’il nous faille les extraire. Mais le prosaïsme du théâtre (mon plus dur ennemi), auquel on fait face souvent dans ce mode d’écriture, empêche de se soumettre à ses premières pensées. Telle genèse devient prétexte, indication scénique, telle autre s’efface pour mettre en relief un plan, une scène. L’écriture pour la scène se plie souvent aux exigences de liens concrets, perceptibles, vrais, crédibles sinon incontestables. Le théâtre est un langage parlé. Le propre du langage parlé est qu’il est constitué de faits, parfois visibles, parfois invisibles, d’accompagnements, de gestuelles, de silences...
La richesse dramatique du langage parlé fait de l’écriture théâtrale une poésie de l’instant.
Vous souvenez-vous de la première phrase écrite ? Est-ce vraiment la première ?
Dans le cas de Moi, Fardeau Inhérent, la phrase du début, la vraie, est celle-ci : « Il y a longtemps depuis que j’attends ». Je l’ai trouvée, comme une sorte de remous de l’intérieur, une introspection farouche. Toute la suite viendra de cette « situation » inconfortable d’incitation à la prise de conscience contre l’attentisme, le marasme du rester en place.
Si vous deviez nous présenter le personnage de votre pièce…
Une femme lavée, délavée, qui attend, de prendre sa vengeance, de triompher contre l’injustice, le mal (mâle). Une femme en prise avec le temps infini. Une femme en prise avec la nature impartiale.
La nature est très présente dans votre texte, quel rôle lui attribuez-vous ?
L’écriture est quête de sens et de non sens. Du sens et du non sens dont nous sommes faits. Une interrogation infinie à la fois de l’imaginaire et de la réalité. J’écris (sur) ce qui m’interpelle, me dépasse. Je me trouve infiniment petit face au débordement des choses de la terre, de l’invisible. La nature imprévisible de l’air, de l’eau, du feu, de la terre… M’interpelle, alors j’essaie d’interpréter ses signes autant que faire ce peut.
Tous ces éléments s’imposent à moi, en parallèle à ce que je décris de la banalité de l’homme lui-même, du citadin, de l’urbain dans sa vie grouillante, et de son obstination à dominer, sans succès, la nature, avec agressivité et violence.
Le jardin français, le comble de la sédentarité, est d’une telle violence rigide, calculée telle, cartésienne jusqu’au pollen, qu’il témoigne extraordinairement du génie de l’homme et de sa toute puissance. Mais combien avons-nous peur du lendemain face à ces choses qui pourront un jour nous étonner et nous emporter ?
A quel moment avez-vous commencé à écrire ?
A l’école à onze ans ! Et c’était pour réécrire la Bible, du moins des passages. Je voulais adapter tous les sermons de Jésus. Vaine entreprise dans une classe primaire où mes camarades m’ont vite transformé en petit écrivain public. Pour eux, il valait mieux que j’écrive leurs lettres d’amour, leurs acrostiches. En y pensant, aujourd’hui, je regrette de ne pas avoir continué avec cette première entreprise. La Bible est l’oeuvre de fiction la plus complète. On ne fait tous que la réécrire. Peut-être parce que la fin et le début de l’homme y sont relatés.
Parmi la richesse de la littérature haïtienne, vers quels auteurs vont vos préférences ?
Aucun écrivain de ma génération ne peut ignorer l’héritage, aussi infime soit-il, de Frankétienne . Même ses fulgurances gratuites nous sont nourriture. J’ai eu la chance de côtoyer et de m’abreuver de Syto Cavé, de lire Jacques Stéphen Alexis, René Philoctète, Marie Chauvet, Yanick Lahens, d’admirer fortement Jean-Claude Charles, de pratiquer Lyonel Trouillot. Et beaucoup d’autres encore…
Comment expliquez-vous cette vitalité créatrice haïtienne dont on a pu encore constater la force lors des derniers événements tragiques ?
Nous avons un patrimoine littéraire extraordinairement riche. Notre littérature, liée à l’histoire foisonnante du pays, est bondée d’auteurs, de mouvements esthétiques, littéraires, divers, les uns plus ambitieux que les autres, et il nous reste encore beaucoup à découvrir de ce qui a été. La vitalité, comme vous dites, de la littérature haïtienne d’aujourd’hui n’est pas si étonnante que ça à mon avis. Ce n’est pas un ovni. On la doit au travail de grands hommes, des bases, des piliers plantés par nos prédécesseurs, et sur qui nous pouvons compter. L’Indigénisme qui prélude à la Négritude, en est un exemple indéniable.
Pensez-vous que cette vitalité va perdurer ?
Aujourd’hui, j’ai peur du futur car nous avons de moins en moins d’écoles pour former les esprits. Et les lieux de rencontre ou de diffusion, qui ont façonné les écrivains, les intellectuels, qui leur faisaient faire leurs premières armes, pendant les deux siècles de la littérature haïtienne, sont aujourd’hui peu nombreux. Et même quand ils existent, ces lieux ne profitent pas vraiment à l’échange. Chacun garde son « mystère », son dieu qui le protège. Nous sommes tellement liés à nos terreaux que nous nous ignorons. L’autre existe pourtant, mais dans l’adversité. Nous sommes solidaires, oui, mais dans le malheur. Il suffit d’un drame pour qu’on se réunisse et le lendemain chacun se referme, se réfugie derrière son bouclier de la peur. Peut-être, faut-il voir là, les sévisses du lendemain de l’obscurantisme éternel, de l’effroi duvaliérien… Assez de théorie là-dessus ! Il faut dépasser ces temps de méfiance acerbe. S’il faut aujourd’hui une vraie concertation des forces vives, elle devra passer par l’art, par les écrits.
Comment avez-vous découvert le théâtre, la scène ?
En allant à la bibliothèque. Ils ont eu un jour la sale idée d’y organiser un atelier. Je pense que je n’en suis jamais sorti. Le diable m’a empoigné.
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - TARMAC de la Villette
TARMAC de la Villette
Parc de la Villette 75019 Paris
- Métro : Saint-Fargeau à 184 m
- Bus : Saint-Fargeau à 128 m, Pelleport - Gambetta à 208 m, Pelleport Bretonneau à 313 m
Plan d’accès - TARMAC de la Villette
Parc de la Villette 75019 Paris