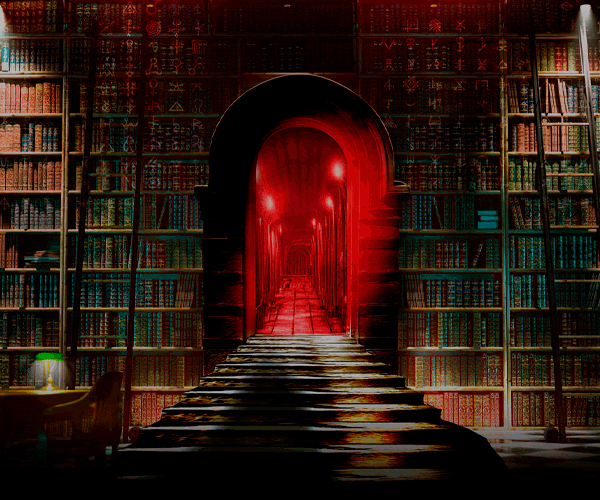Olivia Grandville - Come out
Olivia Grandville - Come out
- De : Olivia Grandville
- Avec : Monia Bazzani, Daniel Bodiford, Clara Cornil, Aurélien Desclozeaux, Olivia Grandville, Lucas Manganelli, Dominique Grimonprez
Le spectacle
Note d'intention
Interview d’Olivia Grandville
Don’t believe in war (extraits)
Entre les faïences livides d’un mur de métro, des hommes, des femmes, tournent en rond sans pouvoir échapper à la musique lancinante qui les encercle. Ils vont, ils viennent, se cognent les uns aux autres comme sans se voir, nettoient par terre, ramassent des paquets qui tombent et retombent, se pressent, traînent, s’affaissent contre le mur, y grimpent…
Étrange déambulation, qui emmène le réalisme au royaume de la fantasmagorie. Progressivement, la concentration inquiétante des gestes mécaniques dont on a oublié et le sens et l’utilité, cet étouffement anxieux, cette maladie urbaine, tout s’évase, se distord, devient grâce, devient danse…
Come out - littéralement « émerger » - nouveau spectacle d’Olivia Grandville chorégraphie l’isolement quotidien. Il se compose de deux parties, la première raconte la pression du monde extérieur. Puis s’expriment les individus.
« Avec l’équipe, nous avons fait un travail sur la ville. Nous nous sommes promenés, nous avons observé, interrogé notre indifférence à la violence quotidienne. Partant du plus petit dénominateur commun, nous avons cherché à démontrer comment les faits anecdotiques qui nous poursuivent jour après jour sont partie intégrante de la grande « actualité ». Nous avons tenté une réflexion sur l’intime et le général.
Au moment où j’ai commencé ce travail en 2000-2001, la rumeur du monde était particulièrement assourdissante, et
j’avais envie de revendiquer une certaine naïveté, le prix de ma sincérité.
Je suis tombée sur ce morceau de Steve Reich composé à partir d’une phrase enregistrée dans la rue : celle d’un jeune
noir au cours d’une émeute, qui disait « J’avais à faire monter à la surface, à faire jaillir le sang du bleu ». Il s’agissait
de peau et de ce qui peut traverser cette peau qui nous relie et nous sépare du monde extérieur.
J’ai établi le lien avec les pratiques d’improvisation et le contact, qui m’intéressent aujourd’hui : ces formes d’approches nées dans les années 50-60 à New-York dans un moment de contestation sociale et d’aspirations communautaires. Pour traiter cette réalité d’aujourd’hui, j’ai mis en regard deux formes chorégraphiques, l’une pseudo-figurative, l’autre plus organique. Poser la danse comme moyen de faire entendre l’informulable, ce que nous savons ou n’osons plus dire. »
Olivia Grandville
Réalisé par Gilles Laprévotte de la Maison de la Culture d’Amiens le 9 septembre 2002.
Olivia Grandville : Mon parcours est lié à mon histoire de corps. J’ai eu une formation classique, et tout ce que je cherche dans ma danse est d’une certaine façon en réaction par rapport à cette formation, en tout cas en résonance. La pratique de la danse classique tend vers un modèle de corps absolu, il y a d’abord une forme que l’on remplit ensuite de “quelque chose”. La danse contemporaine procède à l’inverse, n’ayant pas de modèle et se définissant par l’absence d’une quelconque technique préexistante. L’expression du corps passe par chaque créateur, chaque interprète.
Gilles Laprévotte : Suite à cette expérience classique, vous avez continué votre vie d’interprète en travaillant avec Dominique Bagouet.
Olivia Grandville : Dominique Bagouet est quelqu’un qui m’a énormément apporté, qui m’a aidé justement à ce que la rupture avec le classique ne soit pas trop brutale. Je me suis retrouvée dans sa danse par le signe, le langage du signe, le goût du détail. Il a fait le lien entre ce que j’ai pu aimer du langage classique, son côté hiéroglyphe et mon goût d’une certaine théâtralité contenue dans le geste lui-même. C’est quelque chose qui continue de m’habiter.
Gilles Laprévotte : Le passage à la chorégraphie est-il né d’un manque, d’un manque de l’interprète ?
Olivia Grandville : Oui. Il est né d’un besoin de savoir ce qu’était ma danse,de comment je bougeais et ce que je pouvais raconter avec ça. Mais au-delà de cela, je pense qu’il y a toujours un manque à l’origine d’une demande de création.
Gilles Laprévotte : Vous parliez du signe, j’ai l’impression que ce qui pourrait, entre autres choses, caractériser votre danse, serait une volonté de confronter la danse à d’autres systèmes de signes tels que les arts plastiques, le texte mais aussi la science.
Olivia Grandville : Le corps est au centre de la danse et le corps parle d’anthropologie, de sociologie, de philosophie... L’organisation corporelle, c’est le premier modèle d’organisation sociale. C’est le jeu des correspondances qui m’intéresse, et les clefs qu’il peut nous donner pour lire le monde. Le plaisir de danser, la dépense pure, ont pour moi une valeur philosophique, mais j’aime aussi les images qui racontent. Il y a une multiplicité de sens dans la lecture du geste.
Gilles Laprévotte : Cela n’a-t-il pas comme conséquence de laisser une grande liberté au spectateur ?
Olivia Grandville : Oui, tout à fait. Le corps magnifié de la danse classique induit un regard admiratif, fasciné et passif. Le théâtre à l’italienne oblige à un certain type de regard, vu du dessus ou d’en dessous, mais rarement à niveau. Il s’agit de regarder et d’être à niveau, en proposant un réseau de signes que chaque spectateur doit décrypter pour lui-même. Dominique Bagouet parlait souvent “des bonshommes” et des “bonnes femmes” qui dansent, et pas des danseurs.
Pour Come out, je vais travailler uniquement avec des danseurs, contrairement aux précédents spectacles où je faisais intervenir des comédiens. J’ai fait ce choix parce que je veux que la parole soit celle du danseur, une parole travaillée, pas professionnelle.
Gilles Laprévotte : Pour Come out, vous avez demandé aux danseurs de collecter leurs impressions, mais contrairement au spectacle précédent Paris-Yerevan, où ils devaient réagir par rapport à un pays, l’Arménie, une culture, inconnus d’eux, cette fois-ci, ils doivent réagir vis-à-vis de leur propre environnement géographique et culturel, à savoir Paris.
Olivia Grandville : Oui. Come out est dans le prolongement de Paris-Yerevan, dans le sens où Paris-Yerevan rendait compte d’un voyage au travers du regard croisé de quatre interprètes. Ce qui se racontait du pays au travers de ces témoignages étaient forcément parcellaire, comme un relevé de surface, et pourtant, révélait quelque chose de l’âme de ce pays, c’est en tout cas le retour que des Arméniens de là-bas nous ont fait. C’est aussi le point de départ de Come out. En traversant ainsi la ville, il s’agit de croiser la grande et la petite actualité. Qu’est-ce-que produit en nous la rumeur quotidienne du monde, quelles en sont les pointes émergeantes ? C’est encore chercher la profondeur à travers la surface. Quand on observe la ville, on se rend compte qu’il existe des lois de circulation, des répétitions, des alternances de plein et de vide ; il s’agit également de ramener tout un corpus de gestes, de comportements collectifs, parce que tout est danse, en particulier la façon d’organiser l’espace qui nous sépare des corps qui nous entourent.
Gilles Laprévotte : Se greffe à cette démarche la présence dans le spectacle d’un morceau de Steve Reich intitulé Come out, morceau qui a une histoire particulière.
Olivia Grandville : Quand j’ai commencé à travailler sur ce projet, j’écoutais beaucoup ce morceau sans en connaître l’histoire. C’est une des premières pièces de Steve Reich à un moment où il travaillait à partir d’enregistrements dans les rues de New York. La phrase qu’il utilise a été prononcée par un jeune noir lors d’émeutes raciales à Harlem en 1964. N’étaient conduits à l’hôpital que ceux qui saignaient. Le jeune homme s’est alors mutilé pour être soigné. La phrase en question dit : “J’avais à faire monter à la surface, à faire jaillir, le sang du bleu”. Cette idée m’a percutée, faire sortir quelque chose de la peau, crever l’interface qui nous sépare du monde extérieur, déborder.
Cela m’est apparu comme le coeur de ce que je cherche avec la danse : qu’est- ce que c’est que cette surface de la peau qui nous protège de l’extérieur mais aussi nous en isole. C’est vraiment une histoire du dedans et du dehors. Comment on pénètre les choses, comment les choses nous pénètrent. Come out, ce serait aussi comme une sorte de mot d’ordre lancé, parce qu’il est peut- être temps de “sortir de sa peau” de se mettre “hors de soi”. Après Paris- Yerevan, j’ai eu besoin de restituer mon travail dans un rapport de perméabilité au monde qui m’entoure. Le geste artistique pur a du sens, à certains moments on peut avoir envie de ce simple geste et c’est important. Mais parfois, on peut avoir besoin de l’inscrire dans le contexte historique pour en réinterroger la nécessité.
On assiste à l’émergence d’une nouvelle forme de guerre qui n’a plus de lieu, de théâtre, ni d’espace de représentation. Impossible d’entrer en résistance et de la combattre comme au bon vieux temps du Général et du romantisme maquisard qui alimente encore les fantasmes post-situ de clandestinité.
Cette nouvelle guerre est partout et nulle part. C’est la guerre sans lieu, le non-lieu de la guerre ou encore la catastrophe comme milieu et comme présent intensifié. Guerre sans territoire qui se déroule autant sur les écrans de télévision que dans les cerveaux détraqués. Guerre qui désocialise les individus puis les dissocie d’eux-mêmes, les pousse à bout et provoque des sursauts de violence incontrôlée et imprévisible dans les écoles, les centres villes, les banlieues, les villas des quartiers chics ou les bords d’autoroutes. En ce sens, le massacre terrifiant de Richard Durn contre le conseil municipal de Nanterre est un acte politique, un véritable acte de guerre que les médias ont censuré en n’évoquant soigneusement que sa part de folie meurtrière et de fragilité psychologique. Alors que Richard Durn était parfaitement lucide et conscient des motifs politiques qui l’ont propulsé vers la mort : “Depuis des mois, les idées de carnage et de mort sont dans ma tête. Je ne veux plus être soumis, je ne veux plus manquer d’audace et me planter. Pourquoi devrais-je me détruire et souffrir seul comme un con ? Même si on me maudira, si on me prendra pour un monstre, je ne me sentirai plus floué et humilié. J’ai envie de vivre.
J’ai envie d’aimer. Je veux grandir, je veux me battre et trouver un combat auquel je crois, même si je perds”. (Extrait de son journal publié dans Le Monde du 10 avril 2002). Or dans cette guerre globale, il n’y a plus de combat possible pour canaliser les espoirs de ceux qui, sans aller au bout de leurs pulsions meurtrières, souffrent aussi en silence à horaires fixes ou se laissent abattre dans l’insignifiance quotidienne et le renoncement politique. Car il n’y a rien derrière l’écran de la guerre totale, pas d’idéal, pas de liberté, plus de révolution à faire ou à défaire, pas de Paradis, ni de parole qui puisse canaliser la souffrance et la frustration galopante, l’inutilité de la vie quelconque. Le sens politique d’un tel carnage municipal tient précisément dans l’absurdité de son effet, la gratuité de sa radicalité, l'absence de finalité autre que sa performance stupéfiante (52 secondes nous dit-on pour liquider un conseil municipal) qui va bien au-delà du motif de la revanche contre ceux et celles qui ont écarté Richard Durn de toute responsabilité politique. Cet acte de désespoir solitaire est la ligne de fracture grande ouverte, le désespoir en image, de toute une société en guerre intestine contre elle-même (...)
(...) Impossible de se poser la question de la guerre sans buter sur celle de l’amour. Alors que la contre-culture pop faisait le deuil en 1969 de sa tentative de transgression politique (Dream is over), John Lennon et Yoko Ono organisaient leur Bed in for peace exposant aux journalistes leur intimité glamour à la face de la guerre impérialiste qu’aucune contestation de masse n’avait pu endiguer. Comment déjà dans sa propre expérience amoureuse faire échouer les ravages et extensions de cette guerre totale à l’intimité ? Comment ne pas finir en petit couple sécuritaire implosé par la peur ? Comment faire de l’amour la limite externe de la guerre globale et de son fantasme ? Maurice Blanchot a ouvert la voie avec sa somptueuse hypothèse de la “communauté des amants” comme offensive, contre attaque, irréductibilité joyeuse à l’entreprise d’asservissement volontaire et de crétinerie meurtrière. Les amants isolés dans leur propre communauté sans règle, tous les amants ensemble et les ex-amants capables de se survivre, renvoyant au social son propre désespoir et sa misère existentielle. Il y a quelque chose d’une forme de résistance possible à l’horreur du monde dans l’émergence de cette communauté amoureuse qui ne se referme plus sur elle-même, hors du monde, mais jette toutes ses forces dans le combat mondial de l’actualité du désastre. L’idée de l’amour et de la jouissance sont une arme offensive, la manifestation d’une extériorité irréductible à la société suicidaire, un refus sans concession, l’envers d’une fuite ou d’un repli passionnel et érotique désormais phagocyté par la transparence pornographique, MTV, Loft Story, etc. “Là où se forme une communauté épisodique entre deux êtres qui sont faits ou qui ne sont pas faits l’un pour l’autre se constitue une machine de guerre ou pour mieux dire une possibilité de désastre qui porte en elle, fût-ce à dose infinitésimale, la menace de l’annihilation universelle”. (Maurice Blanchot, La communauté inavouable). Cette communauté trouve sa force dans la solitude des amants, dans leur passion et leur intimité avec la mort “que l’une révèle à l’autre comme ce qu’il incarne et comme le coup qu’elle voudrait recevoir de lui, signe de la passion qu’elle attend en vain”. C’est du côté de L’Amant selon Marguerite Duras et de La Maladie de la mort qu’il faut chercher une alternative féminine à la figure abstraitement nihiliste du Bloom. Cette communauté des amants expose une résistance, une explosion du corps, une ouverture à la passion que toute l’Esthétique du chaos de Mehdi Belhaj Kacem dessine comme la puissance du corps, le “démantèlement des interdictions et la diction de ce démantèlement”. C’est la mise en forme de nos singularités, la “plastique” des amants, la beauté qui échappe à toute information et transparence médiatique. Non pas la guerre des corps mais les corps en guerre dans la passion qui détiennent, jusque dans leur déchirure et leur part obscure, le secret de la survie de tous.
Olivier Zahm
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Théâtre de la Bastille
Théâtre de la Bastille
76, rue de la Roquette 75011 Paris
- Métro : Bréguet-Sabin à 377 m, Voltaire à 391 m
- Bus : Commandant Lamy à 2 m, Basfroi à 243 m, Charonne - Keller à 244 m, Voltaire - Léon Blum à 384 m
Plan d’accès - Théâtre de la Bastille
76, rue de la Roquette 75011 Paris