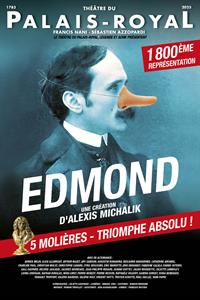Outrage aux mots
- De : Bernard Noël
- Mise en scène : Nicolas Kerszenbaum
- Avec : François Négret
Une lecture performance
Bernard Noël, Le Château de Cène et L'Outrage aux Mots
Le traitement scénique
Extrait
"Nulle part quelqu'un n'a pas posé sa main sur ma
nuque
aussi le manque n'a-t-il pas de visage
il est là simplement comme un toucher froid
un rappel de la parfaite solitude" Bernard Noël, Le reste du voyage
En 1969, Bernard Noël écrit Le Château de Cène. En 1973, l'ouvrage est attaqué pour outrage aux moeurs. Au tribunal, Robert Badinter axe sa défense sur le fait que l'auteur est un grand écrivain, pas un pornographe. Que sa littérature est inoffensive. Deux ans plus tard, en 1975, Noël répond au procès, et à la défense de Badinter, par L'Outrage aux Mots, texte théorique d'une quinzaine de pages.
L'Outrage aux Mots se déploie à partir du point précis où les histoires, la grande (l'Algérie, l'Indochine) comme l'individuelle (les matraquages par la police), envahissent les corps. Et où, trop violentés, les corps explosent dans un cri. Mais comment dire un cri ? Comment l'articuler ? Et quiécoutera, quand la langue qu'on parle est la même que celle du pouvoir, la même que celle du tribunal qui accuse ?
La performance L'Outrage aux Mots
s'enroule ainsi autour de cette pulsation, qui
palpite sous l'écriture, et qui transforme la
brutalité du monde en un élan de vie ; elle
accompagne le flux discontinu qui relie
Histoire, pensée et littérature.
Créateurs sons : Denis Baronnet et Delphine Chambolle
Créatrice vidéo : Antonia Armelina Fritche
En juillet 2009, la Maison des Arts de Laon a demandé à notre équipe de travailler à une lecture de textes de Bernard Noël, dans le cadre de la résidence qu'elle nous offre dans l'Aisne. L'oeuvre de Bernard Noël nousétait inconnue. Nous avons donc lu ses textes, beaucoup, ses romans, ses essais, sa poésie, ses journaux – Bernard Noël est un auteur prolifique, une petite centaine d'ouvrages.
La prose de Noël est troublante : en cinquante ans d'écriture, elle est protéiforme. Elle est souvent rugueuse – une prose qui prend acte du monde, des hommes et de leurs corps, dans des invasions réciproques et successives. L'un des premiers ouvrages publiés, en 1969, est Le Château de Cène. C'est aussi le plus célèbre, à travers le procès qu'il induira. Récit d'une initiation dans un château sur une île aux larges de côtes sauvages, Le Château emprunte à Bataille et Blanchot : il convoque violence des images sexuelles, crudité, mysticisme et charge politique.
L'histoire d'un homme, fasciné par une comtesse lointaine, qui cherche à la rencontrer, et se soumet, pour y parvenir, à des épreuves violentes, avant d'être intronisé hôte du château. Le Château de Cène justifiera en 1973 un procès d'outrages aux moeurs, en grande partie à cause de son troisième chapitre – le narrateur y fait l'amour avec des chiens sur un rivage désert. Une pétition de soutien sera alors lancée ; Jacques Derrida, Claude Gallimard, entre autres, témoigneront auprès de Noël au procès. Robert Badinter défendra l'auteur, sur la ligne qu'un bon écrivain ne saurait être dangereux pour les bonnes moeurs d'une nation.
En 1975, Noël rédige un court texte passionnant : L'Outrage aux Mots. Ouvrage qui répond au malaise que lui a inspiré ce procès, et, principalement, la défense de Badinter. Noël y énonce brièvement certaines de ses convictions : on écrit parce qu'on est traversé par le monde, et que l'écriture à son tour nous traverse. La violence du monde ne peut laisser l'écrivain inoffensif. L'écrivain mâchonne de l'obscur, l'écrivain ne sait pas ce qui le meut, ni ne sait ce qu'il cherche, mais il est bougé par le monde, et donc résiste. L'écrivain a sa réalité, c'est l'écriture, qui s'inspire du monde, mais qui ne lui défère pas. L'Outrage aux Mots s'ouvre sur un cri, un cri terrible, un cri au message vide, mais au sens plein : celui d'un corps qui souffre, et c'est là tout ce qu'on sait. Ce qu'il y a sous ce cri, c'est inconnu. Mais le cri transperce le corps de l'auteur, censure tout le reste. Le retranscrire, c'est affronter la « peur de faire de la littérature ». Le retranscrire, c'est la charge de l'écrivain. L'écrivain doit trouver la langue qui ne trahira pas le cri. Mais quelle langue ? C'est le coeur du texte. Noël écrit : « Il n'y a pas de langue pour dire cela. Il n'y a pas de langue parce que nous vivons dans un monde bourgeois, où le vocabulaire de l'indignation est exclusivement moral (…). Comment retourner sa langue contre elle-même quand on se découvre censuré par sa propre langue ? Il y a une police jusque dans notre bouche. »
Ce qui est beau, dans L'Outrage aux Mots, c'est la simplicité de ce qui tend l'écriture de Noël : le besoin de dire ce qui n'appartient justement pas au domaine du dicible, et, dans le même temps, l'appréhension de voir son discours récupéré par le pouvoir qu'on combat. Noël écrit dans la conscience de ce tiraillement, et dans la nécessité pourtant de poursuivre l'écriture.
Et c'est comme si, en réponse à ces incertitudes, un mouvement de va et vient agitait le texte : le texte théorique, littéraire trébuche sur des absences, sur des injections de réminiscences historiques : la guerre d'Algérie, les noyades dans la Seine en 1961, les tortures en Indochine, les brutalités policières. Et, dans cette intrusion erratique de l'Histoire dans la théorie littéraire, scintille la pertinence des analyses de Noël sur la récupération des opposants, la standardisation des érotismes, et l'amollissement des mots dans la surenchère langagière. Le pouvoir, en parlant trop, ne dit plus rien, et empêche progressivement toute pertinence. La censure, qui n'est que l'interdiction de parler, est moins à craindre que la sensure, ce beau néologisme de Noël, c'est-à-dire l'anéantissement du sens dans les mots qu'on use. « La censure bâillonne. Elle réduit au silence. Mais elle ne violente pas la langue. Seul l'abus de langage la violente en la dénaturant. Par l'abus de pouvoir, le pouvoir bourgeois se fait passer pour ce qu'il n'est pas : un pouvoir non contraignant, un pouvoir « humain », et son discours officiel, qui étalonne la valeur des mots, les vide en fait de sens. » Noël écrit un texte organique, dont le va et vient imprévisible le rend sans doute irrécupérable.
La performance se divise en deux temps :
dans un premier temps, la projection sur un
tulle d'extraits du Château de Cène, et, dans
un second temps, la lecture par François
Négret de L'Outrage aux Mots.
Dans le premier temps, les spectateurs sont
conviés à une expérience de lecture. Une
vidéo d'Antonia Fritche laissant lire le
troisième chapitre du Château de Cène est
projetée sur un tulle, face au spectateur,
pendant les dix premières minutes du
spectacle. C'est au spectateur de découvrir
le texte – personne ne le fera entendre. Le
public n'existe pas encore, c'est encore
seulement une communauté de lecteurs épars dans une salle, qui parcourent le
même texte de Noël. L'expérience proposée
est celle du lecteur – elle se déroule dans
un cocon, dans de la douceur, en opposition à la violence du texte (le narrateur fait
l'amour avec des chiens sur une plage
déserte).
Dans un deuxième temps, la vidéo achevée, François Négret lit L'Outrage aux Mots. Les spectateurs ne peuvent oublier de quel texte on parle là. François Négret parle de derrière le tulle. Il parle de derrière les mots, de derrière l'écriture. La seule existence de Noël que nous proposons, c'est une existence littéraire : au-delà de pages qui défilent, François n'incarne pas : il propose une pensée envahie par intermittence par des relents historiques. Le spectateur chemine sur ce texte, entre théorie littéraire, soubresauts politiques et coups de l'Histoire.
La langue reste première, projetée parfois sur le tulle, parfois non. Sur le texte de Noël, Delphine Chambolle et Denis Baronnet composent et jouent une bande son qui part de l'idée de silence, et développe les sons qu'on lui associe. Arrangement de musique live et de bruits, elle s'ingénie à faire entendre les cris inaudibles, dont les échos résonnent dans notre quotidien – comment la rumeur du monde nous est transmise quotidiennement, innocemment ; les plis où, incidemment, le monde se dépose et vibre. Le terrifiant tapi dans l'ordinaire, auquel on prête peu à peu attention, jusqu'à l'insupportable, dans le silence de nos corps.
" Des cris. Ils recommencent encore. Je les entends, et pourtant je n'entends rien. Je voudrais savoir ce qu'ils disent. Je l'ai su. Je cherche ce qui les censure en moi, maintenant. Des cris, comme d'une femme rendue folle. En les écoutant, je me disais : il ne doit rien se passer ici. Il ne se passait rien que ces cris. La nuit. J'avais peur, et j'avais peur d'avoir peur. Sale bicot, m'avaient dit les gardiens. Il est facile de résister à la provocation, plus facile qu'à l'attente. J'écoutais. J'écoute, mais à chaque fois que cela revient, il n'y a plus que le creux du cri. Comment dire? Cela crie, mais ne dit plus rien. Quelque chose a effacé les mots, le sens qui peut-être me rassurerait. Au moment même, j'avais peur de ce qui allait suivre; à présent, j'ai peur de faire de la littérature. J'ai beau le vouloir, je ne peux, ici, faire retentir le vide de ce cri vide. Et pas même expliquer pourquoi il revient, et revient, toujours obsédant, depuis plus de quatorze ans. Une femme qu'on va violer, qu'on a violée et qui n'en finit pas de revivre l'imminence? Une femme à qui le noir fait revivre sa peur? Mais dans les prisons, il ne fait jamais noir. Mon corps retrouve assez facilement ce qu'il éprouvait : ce froid qui se propage depuis la colonne vertébrale, cependant que tout s'arrête dans la poitrine pour qu'aucun bruit ne trouble l'écoute, si bien qu'on est soudain à bout de souffle comme doit l'être l'autre, là-bas, qui crie. Mais que voudrais-je raconter? Non pas ces cris, qui me surprennent chaque fois; non, d'ailleurs je les sens devenus autre chose que ce qu'ils furent. Cette femme criait à la mort, qu'importent ses mots. Qu'elle criait à la mort, je le sais. Mais alors qu'est-il advenu? Pourquoi affirmer un sens juste après avoir dit qu'il a changé? C'est que, maintenant, ce cri à la mort dont j'ai censuré les mots me censure à son tour. Il résonne et tout se tait, tout ce que je voudrais découvrir, et qui lui est lié. Peut-être écrit-on pour effacer? Dans ces nuits-là, s'ils avaient ouvert ma porte, j'aurais hurlé comme un fou. Il est intolérable d'avoir peur. On n'en parle pas. Un ancien déporté m'a raconté : Un soir, sur la place du camp, des milliers de Juifs étaient rassemblés. On allait les échanger contre des camions. Mais rien ne venait. Le silence. La neige. Longtemps. La neige. Longtemps. Tout à coup, un cri. Tous à la fois criaient. Et il a imité ce cri. Un souffle rauque et interminable. J'ai vu. Oui, j'ai vu. Le désespoir neigeait. J'étais glacé. Un cri mimé; un cri que j'ai entendu. Le même froid. Et à cet instant, je comprends pourquoi il n'y a pas d'indignation possible à l'instant même où retentit le cri à la mort d'un humain que d'autres humains maltraitent : il n'y a que le saisissement froid de l'horreur, et cela ne parle ni ne se parle. Après vient la colère, la révolte, mais comment dirait-on ce cri? Et si l'on pouvait encore le crier, quel froid - celui de la mort. La révolte nous réchauffe : elle nous fait revenir de la mort. La révolte rature la mort. La révolte agit; l'indignation cherche à parler. Seulement, depuis le fond de mon enfance que de raisons de s'indigner : la guerre, la déportation, la guerre d'Indochine, la guerre de Corée, la guerre d'Algérie... et tant de massacres, de l'Indonésie au Chili en passant par Septembre Noir. Il n'y a pas de langue pour dire cela. Il n'y a pas de langue parce que nous vivons dans un monde bourgeois, où le vocabulaire de l'indignation est exclusivement moral - or, c'est cette morale-là qui massacre et qui fait la guerre. Comment retourner sa langue contre elle-même quand on se découvre censuré par sa propre langue ?"
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - La Loge
La Loge
77, rue de Charonne 75011 Paris
- Métro : Charonne à 271 m (9)
- Bus : Faidherbe à 9 m, Charonne - Chanzy à 69 m, Gymnase Japy à 244 m, Basfroi à 271 m, Hôpital Saint-Antoine à 390 m
Plan d’accès - La Loge
77, rue de Charonne 75011 Paris