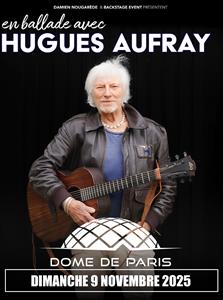William Sheller - Stylus
William Sheller - Stylus
Coup de cœur MUSIQUE & DANSE Le 1er janvier 2016
- Avec : William Sheller
Son précédent album remonte à sept ans - une éternité pour ses fans et pour le monde de la musique dont une des règles est qu’il ne faut jamais s’absenter longtemps - mais William Sheller ne s’en inquiète pas, s’étonne même que d’autres le fassent pour lui et s’amuse de cette image de solitaire vaguement misanthrope, légèrement dépressif et vivant isolé à la campagne, qui s’est construite autour de lui.
Donc, en souriant, il précise :
a) qu’il vit entouré de sa famille (enfants, petits enfants),
b) qu’il n’est aucunement dépressif,
c) qu’il aime bien les gens et
d) qu’il a passé trois des quatre dernières années sur les routes de France à donner des concerts, en piano solo ou avec son quatuor à cordes : « Je pense que quand on donne entre soixante et quatre-vingts concerts par an, ce qui est mon cas, on a une vie plutôt bien remplie et ne ressemblant en rien à celle d’un reclus. La scène est l’endroit où je me sens le mieux… »
Donc, après sept ans de vraie-fausse absence, William Sheller a repris le chemin du studio (en l’occurrence en Belgique) pour enregistrer un nouvel album.
Retour difficile ? « Pas facile-facile quand on n’a pas fait travailler depuis longtemps le muscle de l’inspiration, dit il, mais cela revient quand même assez rapidement pour la musique. C’est par à-coups, on trouve un bout et on n’arrive pas à le faire avancer. Et une semaine plus tard, tout se débloque, c’est un drôle de métier, ç’est pour cela que je l’aime bien. C’est plus dur pour les textes, que peut-on encore dire après dix sept albums ? Et puis, comme pour les musiques, les mots et les phrases arrivent, je les tords comme des morceaux de caoutchouc jusqu’à ce que cela prenne une forme qui me plaise. Il y a beaucoup de perte, pour chaque chanson de l’album, il y en a trois ou quatre qui sont parties à la poubelle. C’est un métier de chineur, on fouine dans le néant, dans le silence, c’est ce que pensait Barbara. Je vais fouiller chez Rimbaud mais les gens s’en foutent, ils ne s’en rendent pas compte. C’est un travail de solitaire, un truc de moine. »
Donc, finalement, ces atmosphères de solitude mélancolique dont il refuse l’étiquette ont quand même une base légitime... « Tout ça c’est un peu de ma faute, confesse-t-il, parce qu’après ‘Rock’N’Dollars’ qui était une casserole en or aux fesses, il fallait absolument être le rigolo de service. Je me suis retiré de tout cela, il y a eu la fréquentation de Barbara et je me suis mis à écrire différemment. Je ne suis pas un mélancolique. Un homme heureux sonne peut être comme une chanson mélancolique mais ne l’est pas. C’est une chanson d’espoir, un espoir timide de quelqu’un qui n’y croit pas trop, qui n’est pas trop sûr de son affaire. Je ne pouvais pas la chanter autrement. Je suis resté pendant un an à écouter la musique en boucle sans trouver de texte, mais je sentais que j’avais là quelque chose de beau. Et j’ai trouvé la phrase : je veux être un homme heureux. Le reste est venu facilement. »
Son nouvel album s’intitule Stylus. « Je l’ai appelé ainsi car l’essentiel n’était pas d’avoir une continuité dans le propos musical mais d’aborder plusieurs genres. Cela peut se rapprocher de la musique de chambre mais aussi sonner comme Stravinsky ou comme les Beatles, ça sonne comme ça veut. J’aimerais bien arriver à une certaine alchimie musicale où on puisse mélanger la pop, le rock et les grandes œuvres symphoniques sans que ça sonne ringard, type Hollywood. J’aimerais beaucoup écrire une sorte de Sacre du Printemps moderne où l’on réunirait tout ce qui couine, tout ce qui coince, tout ce qui choque. »
Quand il était enfant, tout prédisposait William Sheller à faire carrière dans la musique classique. A seize ans, il quitte le lycée pour se consacrer entièrement à la musique. Fugue, composition, harmonie, contrepoint, entrée au conservatoire. Il se préparait pour le Grand Prix de Rome quand une bombe fit tout exploser : « J’ai entendu les Beatles, dit il. Et je ne voulais plus de tout devenir un compositeur cherchant à atteindre des sommets en se déconnectant du monde. J’entendais des mélodies et des sons nouveaux et je ne voulais pas leur tourner le dos. C’est par là que ça se passait, avec les Beatles, Led Zeppelin, Procol Harum, Frank Zappa. »
Stylus réunit tout cela dans un format évoluant entre le baroque, le classique et la pop, accompagné principalement par son quatuor de musique de chambre qu’il emmène souvent avec lui dans ses concerts. Comme dans chacun de ses albums, il y a aussi des morceaux instrumentaux – Sweet pièce et Intermezzo enregistrés pour satisfaire la demande de fans/jeunes musiciens qui aiment déchiffrer et travailler ces pièces modernes qui évoluent gracieusement entre classique et contemporain. L’album s’ouvre sur Youpylong, une chanson que William range dans la catégorie « Beatles » tandis que Walpurgis s’offre - pour les oreilles averties - des détours du coté des lieder de Schubert et de ces romantiques « qui racontaient des histoires de fantômes sur des musiques échevelées. ». Les souris noires puise sa noirceur du côté de chez Baudelaire avec « ses souffrances moyenâgeuses du côté du château entre les sabots, les odeurs de chevaux, la guerre et les corbeaux qui ont le bec rouge d’avoir bouffé des cadavres ».
Les enfants du week-end qui reprennent le bus le dimanche soir le cœur serré ressuscite de vieilles souffrances adolescentes : « Cette chanson me prend aux tripes, dit-il, je serai incapable de la chanter en concert. » Bien qu’aimant se définir comme un homme d’un siècle passé, il a appris à maitriser les machines du vingt et unième. Il travaille, compose et écrit sur ordinateur et maitrise pas mal de logiciels dont il ignorait encore l’existence il y a peu. Y a-t-il autre chose qui soit en opposition avec ce que l’on croit savoir de lui ? Silence, hésitation, puis l’aveu : « Chez moi, j’écoute Marylin Manson en cachette. »
Sélection d'avis des spectateurs - William Sheller - Stylus
Un mélange de moment de partage, d’intimité et de défi Par Christian E. - 26 avril 2016 à 19h27
Voilà un peu plus de 40 ans que le plus british de nos auteurs-compositeurs-interprètes a suivi les conseils de la dame en noir et s’est décidé à chanter et à interpréter ses compositions. Avec un répertoire aussi impressionnant, William Sheller n’a plus rien à prouver et ses titres restent des classiques intemporels où s’entremêlent influences classiques, pop anglaise et textes poétiques très français. Le public est donc déjà conquis. Ce concert est touchant parce que William Sheller fait comme partie de notre famille, que ses morceaux sont magnifiques et que, plus particulièrement lors de ces représentations aux Folies Bergères, il apparait plus vulnérable, un peu fragilisé par ses récents soucis de santé et plus courageux et touchant aussi. La voix est toujours là même si l’énergie est moins forte et que l’on aurait aimé une représentation plus longue et avec moins de pauses. Un mélange de moment de partage, d’intimité et de défi.
Moyenne des avis du public - William Sheller - Stylus
Pour 1 Notes
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Un mélange de moment de partage, d’intimité et de défi Par Christian E. (10 avis) - 26 avril 2016 à 19h27
Voilà un peu plus de 40 ans que le plus british de nos auteurs-compositeurs-interprètes a suivi les conseils de la dame en noir et s’est décidé à chanter et à interpréter ses compositions. Avec un répertoire aussi impressionnant, William Sheller n’a plus rien à prouver et ses titres restent des classiques intemporels où s’entremêlent influences classiques, pop anglaise et textes poétiques très français. Le public est donc déjà conquis. Ce concert est touchant parce que William Sheller fait comme partie de notre famille, que ses morceaux sont magnifiques et que, plus particulièrement lors de ces représentations aux Folies Bergères, il apparait plus vulnérable, un peu fragilisé par ses récents soucis de santé et plus courageux et touchant aussi. La voix est toujours là même si l’énergie est moins forte et que l’on aurait aimé une représentation plus longue et avec moins de pauses. Un mélange de moment de partage, d’intimité et de défi.
Informations pratiques - Folies Bergère
Folies Bergère
32, rue Richer 75009 Paris
- Métro : Cadet à 213 m, Grands Boulevards à 300 m
- Bus : Provence - Faubourg Montmartre à 151 m, Cadet à 204 m, Petites Écuries à 228 m, Grands Boulevards à 299 m
Plan d’accès - Folies Bergère
32, rue Richer 75009 Paris