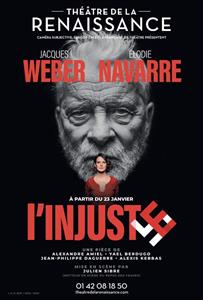14 minutes de danse
14 minutes de danse
- De : Sonia Ristic
- Mise en scène : Sonia Ristic
- Avec : Vincent Cappello
« Ça ne dure pas 14 minutes et ce n'est pas de la danse ! » Sonia Ristic
- Deux ados de trente ans à la mémoire brûlée
Elle, mutine, gamine, câline. Lui, caustique, cynique, épique. Elle et Lui ont une souffrance en partage. Ils n'ont pas pu, ils n'ont pas su en parler. Aujourd'hui, tous deux s'en vont plonger aux enfers de la mémoire. Là où s'est enfoui l'indicible. Là où la guerre est passée, pour justifier l'injustifiable. Là où, trop longtemps, les terreurs ont trouvé refuge au creux des non-dits...
Aujourd'hui, la pénombre d'une cave va laisser paraître le secret et les douleurs tues, les culpabilités, les trahisons, les lâchetés. La blessure, le feu, les hier à jamais meurtris. Alors, tendres et malhabiles, dans les gestes de l'amour, à mots couverts, à murmures confondus, avec les images floues des instants suggérés, Elle et Lui vont déchirer la nuit des silences, reconstituer la trame, vaincre les terreurs, fuir l'oubli et accepter de voir surgir les fantômes du passé.
Dans la sobriété d'une écriture riche de connivences complices et tout entière tendue vers cet instant, Sonia Ristic les invite à s'entendre et se dire jusqu'au bout, jusqu'à l'aveu. Alors, seulement, ils pourront danser, et s'enlacer.
Chorégraphie Tamara Saphir
Musique et son Stéphane Monteiro
Vidéo Carine Chichkowsky
- Entretien avec Sonia Ristic
Bernard Magnier : Vous êtes née en
Yougoslavie, en 1972, d’un père serbe et
d’une mère croate, et après un passage par le
continent africain, vous vivez à Paris depuis
1991 où vous écrivez, en français, des pièces
et des romans. Comment êtes-vous venue
vers la langue française ? Vers Paris ?
Sonia Ristic : Par l'Afrique. Ma mère a toujours été francophile d'une part, et d'autre part elle
croyait dur comme fer au Non-Alignement. En
tant que diplomate yougoslave, elle a toujours
eu des postes en Afrique francophone et
enfant, je l'ai suivie. Du coup, j'ai plus fréquenté
des écoles françaises que des écoles yougoslaves.
Le français a été ma langue d'apprentissage,
de tous les apprentissages, d'enfance
et d'adolescence. Je pense que c'est en français
que je me suis construite. Lorsque j'ai eu
mon bac, je voulais partir, m'éloigner d'une
géniale et très envahissante famille balkanique
et d'un pays au bord de la guerre. Je me cherchais,
et il y avait comme une évidence que
c'est à Paris que je me trouverais, même si, à
l'époque, c'était sans doute plus confus, moins
réfléchi, plus viscéral, plus… adolescent.
Pensez-vous que la (les) langue(s) de votre
enfance a (ont) laissé des traces dans votre écriture ? Quelles sont-elles selon vous ?
Oui, le goût des archaïsmes, des formules un
peu désuètes parfois, me vient du serbocroate.
Les répétitions. L'humour noir. Je crois aussi
que dans mes textes, je n'ai pas peur du “too
much”, d'une certaine grandiloquence, d'un
romantisme à outrance, de ces choses considérées
comme dépassées dans l'écriture
contemporaine française et que, en tant que
slave, j'assume et… adore.
Quelles influences ont eu sur vous les années
passées en Afrique ?
Presque dix années en Afrique ont laissé beaucoup
de traces dans la personne que je suis
devenue. La conscience de l'immensité du
monde, merveilleux et terrible, pas comme
une phrase toute faite, mais comme une sensation
aiguë, constante, quotidienne, qui m'habite.
Le besoin de me tenir en face de l'Autre,
dans toute sa différence et toute sa ressemblance.
Le fait de me sentir à chaque instant
citoyenne de ce vaste monde. J'espère que
cela se ressent dans mon écriture.
14 minutes de danse… Pourquoi ce titre ?
Quand j'ai écrit et monté Le temps qu'il fera
demain pour un cabaret au Théâtre de Verre,
cette pièce n'avait pas de titre. Comme cette
première version durait quatorze minutes et
que les interprètes étaient majoritairement des
danseuses, un des organisateurs du cabaret
avait appelé ce “numéro” 14 minutes de danse,
et je trouvais que c’était un beau titre. Par la
suite, Le temps qu'il fera demain a trouvé son
titre définitif et j'ai décidé d'écrire une pièce qui
s'intitulerait 14 minutes de danse. Je n'avais
aucune idée de ce que ce serait, je connaissais
juste le titre, et je savais qu'il y aurait une
femme et un homme en huis-clos. L'histoire
s'est vraiment révélée à moi au fil de l'écriture,
elle s'est déroulée d'elle-même et le titre a
trouvé sa place, comme une évidence aussi.
Dans vos précédents textes, l’action était
clairement située dans un lieu précis,
Sarajevo pour Sniper avenue, les pays d’oppressions
pour les femmes-témoins dans
Le temps qu’il fera demain. Avec 14 minutes de
danse, vous avez choisi de ne pas nommer
les lieux, pourquoi ce choix ?
Parce que je me suis attachée à la “petite histoire”
et pas à l'Histoire. J'avais vraiment envie
de rester dans l'intime, dans la relation des
deux personnages. J'avais envie qu'ils soient
monsieur et madame tout le monde, et puis
aussi sans doute parce que ces histoires-là,
hélas, ont eu lieu à tellement d'endroits différents
du globe.
Etait-ce une intention présente dès le début
de l’écriture de ce texte ?
Oui. Et avec le recul, je me dis que c'est une
influence très « durassienne ».
Les deux personnages sont appelés « Elle » et « Lui »… Pourquoi ce choix de ne pas les identifier ? Est-ce avec la même intention ?
L'écriture de cette pièce a vraiment été très
peu réfléchie, c'était un titre et puis une sorte
de flot. Je l'ai écrite en quelques nuits, entre
3h et 8h du matin, en rentrant d'un boulot de
serveuse. J'avais devant moi un homme et
une femme, je les ai fait parler et je découvrais
leurs histoires au fur et à mesure que je
les écrivais. Au début, je n'avais aucune idée
de qui ils étaient et je ne pouvais pas les nommer.
Quand la boucle s'est bouclée et que
l'histoire s'est révélée, que j'ai fini par les cerner,
ils étaient déjà tellement Elle et Lui qu'il
m'était impossible de les nommer autrement.
Si vous deviez nous les présenter… Qui
sont-ils ?
Ce sont des ados, même s'ils ont la trentaine.
Ils sont restés dans l'adolescence, dans le dernier
moment d'insouciance, de légèreté, de
joie, de jeu, qu'ils ont vécu, avant que leurs vies
ne basculent, qu'ils ne soient avalés par
l'Histoire. Ils ne font que recréer des rituels,
des rites initiatiques, ceux de l'adolescence,
qui leur permettent de préserver la beauté et
la joie, de sauver l'innocence, malgré les horreurs
qu'ils ont traversées et qui continuent à
les traverser. Ce sont deux grands ados… dans la trentaine.
Un peu comme Sonia Ristic ?
Je me suis rendue compte récemment que
j'écrivais à partir de l'adolescence, ce moment
charnière dans la vie où l'on est tiraillé par les
excès. Je suis toujours autant en colère qu'à
15-16 ans, je vis le monde et l'humain avec la
même acuité, le même émerveillement et la
même rage, et si je semble plus apaisée
aujourd'hui, c'est grâce à l'écriture.
Ce spectacle a déjà connu une destinée sur la
scène pouvez-vous nous raconter son cheminement ?
Je l'ai écrit pour une amie comédienne argentine,
presque sur mesure. De 2003 à 2005, j'ai
fait partie d'un collectif d'artistes qui squattait
des friches, Le Théâtre de Verre. On avait
investi une ancienne gare SERNAM, dans le
10e, et nous avions un immense espace pour
travailler et accueillir du public, en toute illégalité.
C'était un formidable outil, un vrai espace
de liberté et de création, complètement
alternatif, très vivant. Nous avons créé la première
version de la pièce là-bas, avec tous les avantages et inconvénients de ce type de “structures”, avec les moyens du bord.
Même si le spectacle n'a pas eu une longue
vie, c'était une très belle expérience.
Vous êtes, à la fois, l’auteur et le metteur
en scène du spectacle, est-ce un avantage ?
Un inconvénient ?
Les deux. Un avantage, parce que j'ai l'impression
de vraiment comprendre ce que ce texte
raconte, de connaître intimement les personnages,
de cerner les enjeux. Je peux, sans
avoir à ménager la susceptibilité de l'auteur,
creuser à travers la mise en scène ce qui
m'apparaît comme une faiblesse du texte.
Ecrire du théâtre est parfois terriblement frustrant,
un texte n'est jamais fini avant la couche
d'écriture scénique, et là, je m'offre le plaisir
de le faire, de continuer à écrire la pièce, d'y
rajouter des couches de lecture. C'est très
égoïste aussi, car je prends mon pied à le faire.
C'est sans doute un inconvénient parce que je
ne dois pas toujours avoir assez de recul, mais
heureusement, les comédiens, la chorégraphe,
la vidéaste et le compositeur sont tous
d'horizons très différents, avec des sensibilités
fortes, des regards très justes et ils m'apportent
ce recul indispensable.
Avez-vous des références parmi les dramaturges ?
J'ai mentionné Duras déjà. J'ai une passion
pour Shakespeare, mais uniquement les tragédies.
Eschyle, bien sûr. Brecht et Fassbinder.
Müller, à la folie. Plus contemporains, Lagarce
dont j'aime presque toutes les pièces. Laurent
Gaudé, Wajdi Mouawad. Fausto Paradivino a été un vrai coup de coeur. Et puis ceux autour
de moi dont j'ai la chance de suivre le travail,
Suzie Bastien, Gustave Akakpo, Guy Régis
Junior, Dieudonné Niangouna, Dejan
Dukovski... Il y en a beaucoup, en fait.
Et pour ce qui est des metteurs en scène ?
Brook, c'est tout le théâtre que j'aime.
Mouawad encore. J'ai eu de grands bonheurs
de spectatrice avec Stanislas Nordey.
Py, parfois. Mnouchkine.
Quelle part attribuez-vous à la vidéo dans
le spectacle et quel est son rôle ?
L'image a une force impressionnante dans
notre regard d'aujourd'hui, alors
on cherche comment la mettre à
profit sans lui permettre de bouffer
l'acteur. Elle doit être présente
mais ne doit pas prendre le pas
sur le vivant, le fragile. Elle doit offrir une ligne
de fuite, mais pas souligner. Dans le spectacle,
la vidéo est là pour restituer la nébuleuse du
souvenir, le désordre de la mémoire sensorielle.
Il s'agit de projection de sensations, de souvenirs
des personnages, de tout ce que ces
deux-là n'arrivent pas à mettre en paroles.
Quelle part attribuez-vous à la danse, aux
sons et aux musiques dans le spectacle et
quels sont leurs rôles ?
Tout le propos de la pièce est la tentative de ces
deux personnages d’organiser leur mémoire,
de trouver un début, un milieu et une fin, afin de
pouvoir raconter l'irracontable, pour qu'il cesse
de les grignoter de l'intérieur. Sauf que le souvenir émotionnel échappe à l'organisation, ne
respecte pas la chronologie, est beaucoup plus
désordonné. D'où la construction en caléidoscope, éclatée, par ces différents outils et langages.
Le corps, l'image et le son sont censés
donner à voir, à sentir, à entendre tous les
sous-textes qui échappent à la parole. Nous
essayons de créer des contrepoints, de
confronter un discours à une sensation, de
creuser le sensible. L'idée de départ était de
réécrire ce texte mais de façon polyphonique.
Sarajevo, le Rwanda, l’esclavage, la Shoah,
la guerre et ses blessures, votre univers
d’écriture est grave et douloureux, imaginez-
vous écrire sur un monde apaisé, sur
un monde plus proche de votre environnement
d’aujourd’hui ?
Le bonheur manque de ressort dramaturgique
! Je m'attache à raconter des histoires
et c'est du drame que naît l'histoire. Je suis
aussi peut-être trop slave ! C'est au bord du
précipice que la joie m'apparaît comme la
plus fulgurante. Et puis, même si j'écris à
partir de l'ombre, j'ai l'impression que tous
mes personnages cheminent toujours vers
la lumière, qu’ils s'en sortent toujours à la
fin. Que dans tous mes textes, je raconte la
même lutte pour faire jaillir la joie et le rire
du coeur de la nuit, pour faire vibrer la beauté,
même lorsque tout semble perdu.
Propos recueillis en février 2009.
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - TARMAC de la Villette
TARMAC de la Villette
Parc de la Villette 75019 Paris
- Métro : Saint-Fargeau à 184 m
- Bus : Saint-Fargeau à 128 m, Pelleport - Gambetta à 208 m, Pelleport Bretonneau à 313 m
Plan d’accès - TARMAC de la Villette
Parc de la Villette 75019 Paris