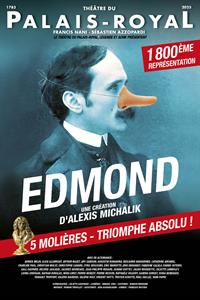Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas
Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas
Coup de cœur CONTEMPORAIN Le 28 mai 2014
- De : Imre Kertész
- Adaptation : Joël Jouanneau
- Mise en scène : Joël Jouanneau
- Avec : Jean-Quentin Châtelain
Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas - Photographies
- Oraison funèbre
Kaddish est le nom donné à la prière que les Juifs adressent à leurs morts.
C’est pour l’enfant auquel il n’a jamais voulu donner naissance qu'Imre Kertész prononce ici le kaddish.
Proférée du fond de la plus extrême souffrance, cette magnifique oraison funèbre affirme l’impossibilité d’assumer le don de la vie dans un monde définitivement traumatisé par l’Holocauste. Ce que pleure le narrateur, ce n’est pas seulement « l’enfant qui ne naîtra pas » : c’est l’humanité tout entière.
- La presse
« Un choc artistique, philosophique et émotionnel. Jean-Quentin Châtelain joue de toutes les notes pour exprimer les nuances subtiles du propos. Avec son drôle de phrasé traînant où perce l’accent suisse, il donne le poids d’une vie à chaque mot. Mieux, il parvient à exprimer l’indicible par la fièvre de son regard, par sa gestuelle crispée, s’agrippant de toutes ses forces aux feuilles de son manuscrit-prière. Puisque seuls survivent les mots, l’homme, lui, est à tout jamais un fantôme… Le public sidéré est plongé dans une transe tragique. Jean-Quentin Châtelain est salué comme il le mérite - triomphalement. On sort anéanti du théâtre, mais convaincu de la nécessité d’un tel spectacle. Pour soi, pour les autres. Pour dire encore et encore l’horreur qui nous menace, il est urgent d’aller voir ou revoir Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas au Théâtre de l’Oeuvre. » Les Echos
« Jean-Quentin Châtelain épouse avec puissance, finesse, et parfois humour, toutes les inflexions, les ramifications, les cassures. Entièrement habité, comme hanté, l'acteur porte ce texte à l'incandescence, exprimant ainsi l'amputation définitive de celui qui a connu les camps d'extermination. » Télérama
« L’absurdité de l’antisémitisme, la mécanique totalitaire, autant de thèmes essentiels rarement explorés avec autant de densité et d’acuité. Une œuvre à écouter d’urgence. » La Terrasse
« A voir absolument. » Le Figaro
« Avec l’intensité qu’on lui connaît, cette diction et ce jeu envoûtants, à la pesanteur si personnelle, Jean-Quentin Châtelain plonge de tout son être, de toute son âme dans le mal-être, les mots et maux de l’auteur miraculeusement revenu des camps de concentration, dont toute la famille fut exterminée. Tout simplement bouleversant. » Fous de théâtre
« Une grande claque littéraire et théâtrale. » Regart’s
« Le texte devient la pâte d’un orateur inspiré qui la sculpte devant nos yeux et nos oreilles. Ce qu’il effectue est admirable. Il nous bouleverse en nous faisant saisir comment l’écriture, pour l’écrivain hongrois, est synonyme de survie. » Spectacles Première
- Note d'intention
Ce nom, Kertész, je ne l’ai entendu prononcé qu’une fois nobélisé, j’ignorais tout de cet auteur, et ensuite j’ai vu son nom inscrit sur les murs du métro, en enfilade, une publicité de l’éditeur, trois textes dans un même coffret à offrir, et des trois j’ai choisi, pour commencer, le plus court, celui aussi dont le titre m’appelait.
Souvenir de la première lecture : la difficulté de l’accès aux pages d’entrée, comme si le livre se refusait à moi, ou me rejetait, j’y suis alors allé aux forceps, ensuite tout s’est ouvert, je me suis abandonné, la langue a fait le reste, j’ai lu en apnée.
Ce qui conduit à choisir un texte comme Kaddish, et à tenter de l’offrir au public, ne répond jamais à un seul critère. Le fait que je n’ai pas d’enfant joue évidemment un rôle : dans mes pièces, les enfants sont ou adoptés ou trouvés, ou morts, ou ils fuguent, c’est un constat que je fais. Il est vrai aussi que je suis né à quelques kilomètres du lieu où Pétain serra la main d’Hitler, et que, dans mon enfance, au village, le mot juif était tabou, imprononçable autrement qu’à voix basse. Reste que le choix de Kaddish est avant tout le choix d’une écriture d’exception.
J’ai commencé le théâtre dit « professionnel » avec une adaptation d’un roman de Botho Strauss : La dédicace. Je connaissais pourtant les pièces de cet auteur. J’ai depuis multiplié les adaptations, de Conrad à Dostoïevski, en passant par Walser et Jelinek, j’aime oui ce moment où je m’approprie la langue de l’autre, son rythme, ses pulsions, ses respirations, et de fait je crois que c’est ma manière à moi d’interpréter, en ce sens c’est un travail proche de celui de l’acteur, du moins tel que je le conçois. Pour Kaddish, je me suis contraint, dans un premier temps, à retaper tout le texte, et c’est dans le concret de la frappe que j’ai compris que la virgule n’était jamais là où je l’attendais, et que, si chaque phrase était noire, dans le détail ce pouvait être gai. Le tragique qui ressort de chaque page de ce livre sort renforcé par l’humour, un humour qui se cache justement entre les virgules, et la virgule a été l’axe du travail de Jean-Quentin.
Cette question encore qui souvent revient : pourquoi m’être moi, un goy, emparé de ce texte ? D’emblée je voudrais répondre, mais ce serait un peu sauvage : pour que cette question n’ait plus jamais lieu d’être, et ce n’est que par souci de préserver le dialogue que je préfère dire que je ne suis pas juif, certes, et que pourtant le goy que je suis a toujours vécu tout acte ou propos antisémite comme une atteinte à son intégrité physique, je dis bien physique, oui, je ressens cet acte, ou ce propos, comme une volonté de meurtre sur ma personne, et je ne sais pas l’expliquer, c’est ainsi.
Avec Châtelain on s’était promis l’un l’autre un tête-à-tête théâtral, mais sur quoi on ne le savait pas, c’était après Coriolan, il m’avait alors fait lire Angot, Léonore toujours, le récit d’une maternité, et je lui avais dit non, il pensait que je ne voulais pas de lui en mère, j’ai du lui expliquer que je ne m’étais jamais vu en père, que le penser ne m’était jamais venu à l’idée, le sentiment de paternité m’étant étranger, et je lui ai remis Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas, et lui, le père de trois enfants, dès sa première lecture, c’était clair qu’il devait porter ce texte.
La première fois que j’ai travaillé avec Jean-Quentin, c’était ma première mise en scène, au théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, dirigé alors par René Gonzales, j’adaptais donc, je l’ai dit plus haut, un roman de Botho Strauss, La dédicace, et Jean-Quentin y interprétait la scène de l’irruption de l’amant dans l’arène du mari, un monologue ahurissant d’une dizaine de minutes et, lors de la première répétition, il débita son texte tête en bas et pieds aux murs, c’était, comme on dit, une proposition. Pour le Kaddish il avait décidé d’apprendre le texte à l’envers, par la dernière page. Je n’avais aucune raison de lui dire non. Il le fît donc et de fait il ne sût la première page que lors de la générale, sur le fil. C’est aussi cela que j’aime chez lui : on ne sait jamais avant ce qui vous attend. Jouer est pour lui affaire de survie, comme pour d’autres écrire, mais on peut expliquer cela bien mieux, citons Kertesz : j’ai compris que tant que je travaille, je suis, que si je ne travaillais pas, qui sait si je serais, si je pourrais être ; ainsi donc les corrélations les plus sérieuses relient mon existence et mon travail.
Ce qui, très vite, disons dès la première lecture sur le plateau, m’est apparu : l’obscénité de toute mise en scène visible dans le travail à venir. Et ce fût comme une libération. Dès lors nous savions oui que le décor, les lumières, ne seraient que les traces de ces mêmes répétitions, que jamais on ne parlerait de déplacements, que de fait il fallait tout simplement incorporer ce texte, et que le corps-récepteur étant celui de l’acteur, le metteur en scène se devrait de s’effacer, voilà, et durant les petites semaines qui ont suivi, j’eus le sentiment, au premier rang, d’être une sage-femme assistant l’acteur-Châtelain à accoucher de son enfant-texte, mais n’utilise-t-on pas alors et fort justement le terme de « travail ».
Le nombre de fois surtout, lors des répétitions, où l’un ou l’autre disait : nous ne serons jamais prêts, et cela faisait rire, mais la veille de la première, (car tout de même il y eût une première) l’un et l’autre le savions : il nous manquait trois jours, ce qui fît moins rire, et cela fît peur, mais la peur, justement, est le moteur de cet acteur, un peu moins le mien je dois dire.
On ne pense plus autrement que montre en main, comme on déjeune, le regard fixé sur les bulletins de la bourse – on vit comme quelqu’un qui sans cesse « pourrait rater » quelque chose. Faire n’importe quoi plutôt que rien » -ce principe aussi est une corde propre à étrangler toute culture et tout goût supérieurs. Nietzsche, Le gai savoir.
Comme il m’était demandé, à la radio, pourquoi, après l’horreur des camps, l’antisémitisme perdurait en Europe, j’ai cité Kertesz : les antisémites ne peuvent pas pardonner Auschwitz aux juifs. C’est cette phrase qui m’a fait comprendre l’acharnement de certains à nier les chambres à gaz. Comme une dénégation. Tel l’assassin qui donne trente coups de couteau à sa victime, tentative pathétique d’effacer le premier, mais ça ne s’efface pas Auschwitz et ce n’est pas du passé, c’était hier et chez nous en Europe, et comme dit très bien Borges : c’est aujourd’hui hier et c’est demain.
Près de trois semaines après la première représentation du Kaddish, m’efforçant de passer à autre chose, cherchant donc un livre qui puisse tenir la route, comme on dit, et après quelques déconvenues heureux de croiser sur cette route un ex-yougoslave, David Albahari, L’homme de neige, relevant les lignes relatives à son arrivée pour un exil outre-atlantique : l’aéroport tout entier n’était qu’un ensemble de phrases, mais s’il n’y avait pas eu toutes ces phrases, je me serais écroulé depuis longtemps. Je tenais debout grâce aux mots, ce que je n’aurai jamais cru possible si quelqu’un me l’avait raconté. C’étaient les lettres, c’étaient les mots qui me soutenaient, les signes de ponctuation qui me permettaient de respirer, je retrouve malgré moi le survivant Kertesz, à la sortie du camp, découvrant que désormais son travail consistera, stylo à la main, à continuer de creuser sa tombe.
Et oui : travailler ce texte, c’était comme suivre une ligne de vie.
Joël Jouanneau. Le 5 décembre 2004.
Sélection d'avis des spectateurs - Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas
un acteur et un texte époustouflant Le 28 juin 2014 à 22h24
Rarement ressenti une telle émotion dans une salle de théâtre. un spectacle, ou plutôt une méditation, d'une rare puissance. a ne manquer sous aucun prétexte.
Par Diane N. - 1er juin 2014 à 21h21
transcendant
Moyenne des avis du public - Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas
Pour 2 Notes
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
un acteur et un texte époustouflant Le 28 juin 2014 à 22h24
Rarement ressenti une telle émotion dans une salle de théâtre. un spectacle, ou plutôt une méditation, d'une rare puissance. a ne manquer sous aucun prétexte.
Par Diane N. (3 avis) - 1er juin 2014 à 21h21
transcendant
Informations pratiques - Théâtre de l'Œuvre
Théâtre de l'Œuvre
55, rue de Clichy 75009 Paris
- Métro : Liège à 183 m (13), Place de Clichy à 309 m (2/13)
- Bus : Liège à 104 m, Place de Clichy à 228 m, Bucarest à 271 m
Plan d’accès - Théâtre de l'Œuvre
55, rue de Clichy 75009 Paris