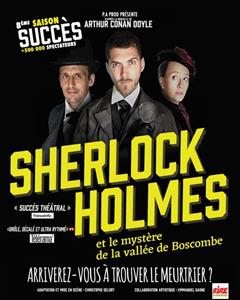L'ombre de Venceslao
L'ombre de Venceslao
- De : Copi
- Mise en scène : Jorge Lavelli
- Avec : Maryline Even, Miloud Khetib, Dominique Pinon, Joan Titus
Dans la littérature argentine du XIXème siècle, un auteur, Ricardo Güiraldès, et son livre, Don Segundo Sombra, ont cristallisé un langage culte pour exprimer la vie de l'homme dans son contact avec la terre, avec une nature rude, violente et indomptable.
C'est dans la solitude de la pampa et sa monotonie sauvage que se construit le caractère introspectif et sombre de son légendaire habitant. Il parcourt l'étendue infinie de la plaine et ne fait qu'un avec son cheval. Il hante ainsi le désert avec une soif permanente de liberté. Toute une littérature l'exalte comme le symbole de l'homme indépendant et lucide, combattant l'injustice et relevant tous les défis pour le bien de l'ordre moral. On l'appelle le " gaucho " et on lui attribue les authentiques vertus de l'homme juste. Ce mythe alimente la dramaturgie de cette pièce singulière où Copi met en scène des personnages solitaires, perdus dans l'adversité de la nature, des êtres sensibles, attachés aux exigences primitives de la sexualité et des sentiments, des hommes projetés dans une éternelle errance (comme tous les personnages de Copi) et cherchant à atteindre le bonheur. Il nous parle aussi de l'infortune et du ratage, et l'on dénombre beaucoup de morts... Les uns sont volontaires, les autres sont victimes, comme dans les tragédies.
C'est cet ingrédient " tragique " justement qui déclenche son contraire. Il ne peut y avoir d'humour que dans le vertige de la décadence et du malheur. Ainsi en va-t-il de ces histoires de gauchos errants à qui la grande ville volera le dernier soupir. La foule réserve aux pèlerins solitaires des turpitudes inattendues. Humour et sinistrose. Au désordre succède l'état de siège ; la vie dans sa voracité reste en suspens.
Jorge Lavelli
A la Cartoucherie de Vincennes, Jorge Lavelli met en scène une pièce inédite de Copi. Une traversée en carriole de l'Amérique latine.
Ecrite en espagnol, L'Ombre de Venceslao date de 1977, un an après le coup d'Etat militaire du général Videla en Argentine. C'est une des meilleurs pièces de l'auteur sud-américain, où l'on retrouve l'humour, la grâce et la noirceur qui sont la marque de son univers. L'adaptation et la mise en scène de Jorge Lavelli mettent en valeur l'originalité de cette oeuvre de son ami, aujourd'hui disparu.
Copi avait écrit L'Ombre de Venceslao en 1977, un an après la prise du pouvoir par la junte de Videla. Il l'avait écrite en espagnol. Une chose de lui qui restait, à ce jour, inédite. C'est l'une de ses plus belles pièces, d'un tissu un peu différent, et Jorge Lavelli, parce qu'il sauvegarde cette différence, donne ici l'une de ses plus grandes mises en scène. Aussi pouvez-vous vivre là un soir de théâtre d'un rare bonheur.
Différent, en ce que Copi, sans estomper si peu que ce soit l'aigu de sa sédition, l'inattendu de ses embardées, l'enfer et le ciel de son " théâtre du coeur ", son sourire aussi, a gravé cette fois-ci, d'une pointe plus frugale, plus candide, son grand retable du monde.
Né en Uruguay, puis passé en Argentine, comme Copi, le chef de famille de la pièce, ce Venceslao, qui va se pendre au dernier acte, est, dans une campagne sèche, vide, un traîne-misère au pas ra-pide, à l'humeur brusque. Une compagne, des enfants, un cheval qui ne tient pas debout, une car-riole, c'est la vie réduite à ses plus minces hasards, mais la vie quand même, en lancée, comme le jour, chaque jour, remorque la nuit. Il y a ici une telle précarité que les actes naturels, se verser un seau d'eau pour se doucher, ou déféquer, ou sexuellement s'accoupler, ou tirer tant bien que mal la tête ou les pieds de l'enfant qui va naître, oui, tout cela est du même allant, du même naturel à découvert, que des nécessités plus averties, comme savoir réparer la roue de la charrette, ou, épreuve mondiale, savoir lire.
Les femmes et les hommes de cette maison errante allient un naturel, un rudimentaire - accompagnements comme instinctifs d'une si stricte pénurie - à toute une manifestation de délicatesses, d'élégances de coeur, de présences d'esprit, de sautes d'humour pour chasser les coups de noir, de gestes et mots de rien qui aident à enjamber des gouffres. Pas surprenant : toute une hantise de Copi est là.
LE TANGO, CETTE MEMOIRE
Pièce de lui, différente aussi en ce qu'elle est sans coups de soleil, sans accents
vifs. Les figures sont juste profilées, les entreprises décomposées ; nous sommes, non
pas dans la chose, mais tout au moins dans l'esprit des premiers films muets. Les scènes
filent à la va-vite. Quelque chose de crucial manque, dans le sang, sous les pieds, sur
le chemin devant soi, alors l'action n'a pas lieu, pour de vrai, même si l'on tue ou
meurt.
Et, là, Jorge Lavelli, par tout un jeu de trouées d'ombre, de nuées, de rythmes syncopés, d'accessoires presque de parade foraine, par une métamorphose magique de la densité de l'espace, de la pesanteur des corps, par la poésie, il n'y a pas d'autre mot, d'une liberté d'action qui transfigure le théâtre, accompagne Copi comme s'il l'embrassait au-delà de la grande absence. Et lorsque l'on aime Copi, c'est émouvant.
Pourquoi se priver d'observer deux choses. Le tango, en Argentine, c'est beaucoup plus que le tango, c'est toute une mémoire, tout un monde. Et c'est passion-nant à contempler, lorsque c'est accompli avec autant d'art que sur ces planches de Lavelli. Mais les performances de tango sont là si nombreuses, si virtuoses, qu'elles décalent un peu l'oeuvre de Copi, peut-être. D'autre part, l'un des rôles essentiels de la pièce est un perroquet, qui a très souvent son mot à dire, et dont les interventions, cinglantes, atroces, comiques, stimulent et étayent l'action. Pour démarquer le re-gistre de la voix éraillée des perroquets, l'acteur Rosario Audras déforme les sons au point que le texte des répliques est inaccessible. C'est une faute à laquelle Lavelli devrait sans attendre remédier. Il a parfaitement orienté tous les autres comédiens, merveilleux.
Michel Cournot, Le Monde, 23 novembre 1999.
Lavelli s'amuse avec un inédit de Copi
Dans " l'Ombre de Venceslao ", Jorge Lavelli, qui connaît son Copi par
coeur, restitue avec maestria cette Argentine imprégnée du mythe du "gaucho",
indomptable jusqu'à en mourir.
Il y a des trombes d'eau qui dégoulinent, des grondements que l'on entend et des jurons que profère Venceslao (" Putain de merde, un orage, manquait plus que ça ", etc.). Il y a des brumes épaisses qui se lèvent, des inondations qui menacent et une charrette tirée à hue et à dia par le cheval "Gueule de rat". Il y a des coups de fouets qui cinglent, un perroquet qui gueule des insanités, l'eau des chutes d'Iguazù qui bouillonne, une radio qui balance des tangos à tue-tête, des corps à corps électriques, des voix qui déraillent. Il y a des morts violentes et des vies desespérées... C'est le chaos, sur la terre comme au ciel. Enfin, au Théâtre de la Tempête, appellation toute indiquée pour cette pièce de l'Argentin Copi (disparu en 1987), écrite en 1977 et jusque là inconnue. Avec L'ombre deVenceslao, l'auteur embarque son monde entre " rats des champs " et " rats des villes ", entre la réalité d'une nature hostile et la course folle au bonheur dont on ne sait sur quel mode le rêver : le sexe, l'argent ou la mort. Ses personnages gardent une innocence primitive, vulgaire et sublime, qui force les destins tragiques. Le metteur en scène Jorge Lavelli, qui connaît son Copi par coeur, restitue avec maestria cette Argentine imprégnée du mythe du " gaucho " indomptable jusqu'à en mourir. Là, il construit une mise en scène turgescente à l'extrême. Et si parfois les muscles lâchent un peu, c'est pour mieux reprendre de l'oxygène Venceslao vit dans un ranch du nord de l'Argentine, du coté de la pampa humide non loin du Brésil et du Paraguay, là où passe le fleuve Parana. Il a deux femmes. La légitime, Hortensia, dont on ne verra que la silhouette sans vie, dans son lit, et la maîtresse, Mechita. Avec la première, il a deux enfants : la belle China, qui rêve d'être danseuse, et Lucho, le fils, qui fait des études de médecine à Buenos Aires, la capitale (on ne le verra pas). Avec la seconde, il a un fils, Rogelio, qui trouve le moyen d'être tombé totalement amoureux de China, sa demi-soeur donc. Mais comme la maîtresse Mechita n'a pas manqué d'amants, le fils Rogelio sait mentir à China pour lui faire croire qu'ils n'ont pas le même père ! Au diable l'inceste, les deux jeunes tourtereaux se marieront, auront un enfant qui mourra rapidement, iront à Buenoe Aires, où ils se feront duper de façon tragi-comique. Venceslao, lui, partira sur sa charrette du côté d'Iguazu, en compagnie de Mechita et de son perroquet bavard, pour changer de vie. Ils y adopteront un singe et seront rejoint par le vieux Don Largui...
Fresque délirante.
Il y a tout Copi dans cette fresque délirante : la peur, la solitude, la violence, les
amours coupables ou trompés, la vieillesse, la mort. Sur le vaste plateau rustique de la
Tempête, Rodolfo Natale a construit un décor d'une efficacité exemplaire (les objets
sont accrochés aux murs alors que du fond vient la brume ou les images des chutes
d'Iguazù). Un parti pris qui survolte les scènes construites par Jorge Lavelli. Il y a
des tableaux merveilleux comme cette charrette et ses occupants perdus dans le brouillard
épais. Les comédiennes - Maryline Even (Mechita) et Joan Titus (China) - sont
époustouflantes. Sans retenues dans la folie respective de leur rôle, du début à la
fin. Les comédiens, l'autre soir, étaient encore un peu en retrait. D'un presque rien
pour Miloud Khétib (Venceslao), Diego Montès (Rogelio) et Dominique Pinon (Largui). Mais
quelle classe, ce Jorge Rodriguez en souteneur-danseur de tango (Coco Pellegrini) ! Du
grand Lavelli.
J.P. Bourcier, La Tribune, 23 novembre 1999
De la jungle à la ville
Fidèle en amitié, Jorge Lavelli exhume et monte une pièce inédite de Copi, disparu
il y a dix ans. Le texte n 'est pas vraiment convaincant, mais la mise en scène est
magnifique.
Un inédit de Copi, cet Argentin de Paris disparu il y a dix ans, mis en scène par son compatriote Lavelli : c'est une manière d'événement. Double : pour les fans du dessinateur de "La Femme assise " (récemment représentée sur scène à Chaillot) bien sûr, heureux sans doute de pouvoir découvrir un texte inconnu, écrit en espagnol en 1977, mais aussi pour ceux de l'ancien directeur du théâtre de la Colline, aujourd'hui sans attaches, et que l'on retrouve ici, en toute simplicité, au tout petit théâtre... de la Tempête, dans le bois de Vincennes.
On connaît l'ironie, l'amour de la dérision, la liberté provocatrice de Copi, jonglant avec burlesque et tragédie à travers de folles histoires de marginaux et de travestis, de " La Journée d'une rêveuse " (sa première pièce, montée en 1967, par Lavelli déjà, avec Emmanuelle Riva) jusqu'à " Une visite inopportune ", où il évoquait sa propre mort, peu avant sa disparition, et que Lavelli, toujours, avait créée à la Colline. On les retrouve ici à la fois exacerbés et un peu noyés dans une sorte de vaste fresque, ambitieuse, puisqu'il s'agit d'un destin d'une poignée de personnages solitaires, perdus dans l'adversité d'une nature, la jungle, et d'un pays, l'Argentine, également hostiles, cherchant en vain, bien sûr, à atteindre le bonheur. Plus ample, la pièce prend parfois l'allure d'une bande dessinée, aux dialogues simplistes (et, dans une traduction sans doute très fidèle de Dominique Poulange, vieille complice de Lavelli, singulièrement crue, voire scatologique, ce qui ne surprendra que ceux qui ignorent Copi). Elle conte l'histoire d'un paysan de la pampa, Venceslao, un homme d'origine uruguayenne qui a fait deux enfants, Lucho et China, à sa femme légitime, et un autre, Rogelio, à sa maîtresse Mechita. Laquelle est courtisée par un pauvre commerçant maladroit et peu viril (Copi, par le truchement d'un perroquet très mal élevé, formule cela autrement). China et Rogelio s'aiment, tant pis pour l'inceste, ils feront un enfant, qui mourra d'avoir ingéré un biberon à l'insecticide, comme sa grand-mère, déjà, tuée par la mort-aux-rats, et avant son père, empoisonné par un maquereau de Buenos Aires où le jeune couple était venu tenter sa chance...
Entre dérision et émotion
Inracontable, la pièce compte aussi un cheval fourbu et un singe buveur de maté,
beaucoup de jurons dont "Putain!" est le plus gracieux - et le plus fréquent -
et de longues, trop longues séquences de danse, sur des airs de tango bien sûr. Après
la fin, tragique - on meurt beaucoup, chez Copi - un épilogue onirique presque serein
émouvant, lui donne un peu d'unité. Mais l'ensemble ressemble plus à un squelette qu'à
une pièce de chair et de sentiments...
En revanche, la mise en scène de Lavelli, qui accomplit là, à l'évidence, oeuvre de mémoire fidèle, est époustouflante. Sur la grande scène, dans un décor campant avec humour - les rares meubles sont accrochés aux murs délabrés - l'extrême dénuement des personnages, il évoque aussi bien l'horreur d'une gigantesque inondation que celle d'une répression militaire, le foisonnement luxuriant de la jungle que la poésie inquiétante d'une ville la nuit, alterne dérision et émotion, et dirige magnifiquement des comédiens parfois très familiers (Dominique Pinon, émouvant en soupirant toujours éconduit, traversant la pampa à bicyclette pour les yeux d'une vilaine et ingrate belle, ou Miloud Khétib, Venceslao portant beau) parfois à découvrir, comme l'infatigable interprète de China, Joan Titus. Une curiosité, qui donne envie de retrouver Lavelli avec... un vrai texte. A. C.
Les échos, 23 novembre 1999
Un double bonheur
Il y a, au théâtre, un art de l'obscénité dont Shakespeare, Sade et quelques
autres offrent de nombreux exemples. C'est un désir gai qui s'épanouit dans l'excès et
la surenchère (comme le burlesque) et qui s'enivre de gros mots et de vilains gestes et
qui se moque des faux dieux, des fausses valeurs, et qui s'esclaffe et qui s'exhibe. Une
condition : si l'on rit, ce n'est plus vice ! Copi avait ce don qui a un peu disparu
aujourd'hui de la scène.
La provocation, le sacrilège et la scatologie sont des armes salutaires si on sait les manier : on est sur le fil, toujours à deux doigts de s'avilir - est vil ce qui est à vendre, ce qui ne vaut pas cher. Copi (1939-1987), c'était tout le contraire : je parle de l'homme, bien sûr, mais cette pièce qu'on ne connaissait pas lui ressemble. C'est une allégorie brutale, bourrue, naïve, avec des choses belles, inadmissibles et douces. Rien de bas, rien de vulgaire chez Copi : on connaît l'humoriste joyeux et désespéré. En voici un autre qui, cette fois, parait devant nous, humble et dénué, sans se travestir, sans se farder. Ni grelots ni talons aiguille : le fou est nu. Un Falstaff maigre.
Second bonheur : le travail de Jorge Lavelli - miraculeusement rajeuni, requinqué,
libre enfin, comme s'il avait renoncé à ces coûteuses machines, à ces grosses duperies
à quoi ressemblent certains spectacles, et retrouvé, Dieu soit loué ! la joie pure et
simple du jeu, de l'invention, de l'acte. Pure, oui, mais simple, vraiment ? Non, ce n'est
pas d'un coup de dés qu'on fait coexister des maquereaux, des anges et des perroquets
dans une constante audace alliant la poésie, la dérision, le mouvement.
Copi inscrit son fabliau dans la géographie rêvée de l'Argentine : là-bas, tout
s'émeut, tout conspire, la nature, l'espace, le sexe, la politique. Il dit la sauvagerie,
l'errance et la mélancolie de la pampa où l'homme n'épouse que son cheval et sa
solitude. Aucune nostalgie dans ces brutales réminiscences où les rêves ont le goût du
sang. Venceslao le patriarche se pend ; sa fille China meurt d'une balle perdue dans un
bal. Tout s'achève par un golpe dans la rubrique des faits divers.
Lavelli fabrique des îles, des forêts peuplées de singes et d'oiseaux, des chutes d'eau. C'est beau, une ville, la nuit - la Ville : Buenos Aires. Les comédiens, notamment Miloud Khétib, Joan Titus, Maryline Even, Jorge Rodriguez, s'installent dans un paysage et dans une langue ; ils sont magnifiquement accordés aux séductions de ce monde barbare et sensuel ; il émane d'eux un tourment indéfinissable, une ironie à la fois pudique et grinçante, une force humble et stoïque devant les fiascos de l'existence. Dans le tableau final, le héros mort revient sur terre et marche dans les avenues de la capitale à l'abandon. On trouve cela très normal. Frédéric Ferney.
Le Figaro, samedi 20 - dimanche 21 novembre 1999
Copi non conforme
Jorge Lavelli met en scène une pièce inédite, "L'Ombre de Venceslao",
l'errance d'Argentins en quête de merveilleux. Première mardi.
Jorge Lavelli dit les choses sans passion excessive mais avec la retenue d'un homme
blessé, qui sait se tenir. Pendant dix ans, il s'est consacré à la direction d'un
théâtre national, la Colline, dédié au répertoire contemporain. Une tache "
lourde, mais exaltante ", reconnaît-il. Pas une fois il n'a
quitté son théâtre pour aller travailler à l'étranger, consacrant toute son énergie
à faire de cette salle située dans le XXème arrondissement de Paris, un haut lieu de la
création.
" Je me suis passionné pour le projet. Cette responsabilité totale m'a plu ".
Pour récompenser cette exigence, le ministère l'a remercié - limite d'âge oblige - en
attribuant à sa compagnie " le méchant théâtre ", une subvention plutôt
modeste, 700 000 francs. " On m'avait promis un statut qui me permettrait
de travailler ". Déçu, Jorge Lavelli se débrouille avec les moyens du
bord. Grâce à Philippe Adrien qui l'accueille dans son théâtre de la Tempête, il met
en scène une nouvelle pièce de Copi, L'Ombre de Venceslao.
Vers les chutes d'Iguazu
" Je connais Copi et Philippe Adrien depuis trente ans. Philippe Adrien jouait
dans Le Mariage de Gombrowicz que j'ai mis en scène en 1963. Depuis, je l'ai accueilli à
la Colline où il a monté notamment Kinkali. J'ai rencontré Copi à Paris alors qu'il
travaillait à La Femme assise, une série de dessins qui l'a rendu célèbre. On était
sur la même longueur d'onde. J'aimais son honnêteté intellectuelle, sa liberté, son
sens de la fête. Il était comme mon frère ".
Quand Copi lui donne à lire L'Ombre de Venceslao, à la fin des
années 70, Jorge Lavelli prend peur : " La pièce pose beaucoup de problèmes. Il
est question d'un singe, d'un cheval, d'un perroquet. Copi plonge sans retenue dans la
mythologie argentine. La pièce m'avait semblé très difficile à monter. Je l'ai relue
avec plaisir et sa force m'a convaincu. Ce n'est pas une piécette de plus mais une grande
oeuvre de Copi qui avait la théâtralité dans la peau ".
Nous sommes en Argentine. Venceslao (Miloud Khétib), le métis, décide de partir avec sa
maîtresse Mechita (Maryline Even) vers les chutes d'Iguazu. En chemin, il croise un
singe, bavarde avec un perroquet, compatit au sort de son vieux cheval. A leur suite
galope à bride abattue don Largui (Dominique Pinon), l'amoureux transi de Mechita. Un
autre voyage conduit les enfants de Venceslao, China (Joan Titus) et Rogelio (Diego
Montés), vers Buenos Aires. Ces hommes projetés dans une éternelle errance, comme tous
les personnages de Copi, cherchent à atteindre le bonheur. En vain.
" Curieusement cette pièce me fait songer à Tchekhov, reprend Lavelli. Ces
hommes et ces femmes, apparemment d'une grande banalité, en quête d'autre chose, d'un
avenir radieux, me touchent beaucoup. Comme Tchekhov, Copi est multiple. Il n'est pas
l'auteur d'une idée, comme Beckett par exemple ".
Armando Llamas, grand connaisseur de l'univers de Copi, résume : " Les
personnages de Copi sont illimités car ils ne connaissent d'autres limites que celles du
théâtre. Tout, absolument tout, peut leur arriver. Ils sont des marionnettes dans le
doigt du fatum. Et ils ne sont nulle part plus grands que dans la déchéance ".
- Marion Thébaud
- Le Figaro, 15 Novembre 1999
Jorge Lavelli débusque un nouveau Prospéro pour la Tempête
Le metteur en scène présente une pièce inédite de son "frère" Copi au
Théâtre de la Tempête. Explications...
Fidèle à son esthétique particulière, à une éthique et à un engage-ment prononcés,
l'argentin d'origine italienne, ardent défenseur d'un théâtre libre d'auteurs vivants,
imposa en France quelques inconnus devenus inévitables : Gombrowicz, Copi ou Arrabal.
Aujourd'hui, Jorge Lavelli dirige notamment Dominique Pinon et Miloud Khétib dans L'Ombre
de Venceslao de Copi, pièce écrite en espagnol au milieu des années soixante dix,
à ce jour inédite en France.
- Copi écrit L'Ombre de Venceslao au milieu des années soixante dix. Pourquoi sa pièce nous est-elle restée si longtemps inconnue ?
Jorge Lavelli : Faute de traduction, la pièce a passé le barrage des éditeurs, elle est restée inédite. Dès qu'il l'a écrite, Copi est venu me lire son Ombre de Venceslao. J'avais déjà mis en scène La Journée d'une rêveuse, Les Quatre Jumelles ou L'Homosexuel... Mais à l'époque, je ne me sentais pas prêt. Je n'avais pas les moyens de m'attaquer à une pièce d'une telle envergure. Sa mère, il y a quelque temps, m'en a reparlé. Dominique Poulange et moi-même l'avons relue, puis nous avons décidé de la traduire.
- Raconter la destruction d'une famille, c'est une étrange manière de fêter la fin du millénaire...
J. L. : la pièce aborde un thème dont se nourrit toute la littérature argentine : l'aventure d'un individu isolé qui se confronte à l'obstacle de la nature et s'interroge sur les véritables raisons d'être de l'homme. Mais Copi reste Copi, avec sa cruauté, sa dérision, son regard ravageur. Il raconte l'histoire d'une famille disséminée dans les immensités de l'Argentine des années cinquante. Venceslao abandonne ses biens, part avec sa maîtresse vers le Nord, vers les frontières mythiques de l'Argentine, tandis que les plus jeunes, plus ambitieux, partent pour Buenos Aires. Tous finiront par rencontrer la mort. Dans une scène finale, onirique, le personnage principal revient, tel une ombre, pour se réconcilier avec ceux qui lui ont été fidèles. La destruction de la famille de Venceslao répond assez bien à notre époque de faillite idéologique et d'absence d'idées, où le grand idéal se résume à une monnaie unique... Cette pièce pose mille questions, interroge à nouveau les valeurs de base, comme la famille ou la société.
- Dix ans après la mort de Copi, que représente pour vous son Théâtre ?
J. L. : Son oeuvre me semble toujours aussi " irrécupérable ". Si l'oeuvre de Beckett est devenue une Bible institutionnalisée, le théâtre de Copi reste plus destructeur, plus libre. Aujourd'hui, le temps lui donne une perspective que nous n'avons peut-être pas su trouver il y a quelques années.
- On appelait Copi votre " frère "...
J. L. : Je ne l'ai pas connu à Buenos Aires mais à Paris, au milieu des années soixante. Il était alors un dessinateur notoire. Il est venu me montrer sa bande dessinée publiée par le " Nouvel Observateur ", Sainte Geneviève dans sa baignoire, et m'a demandé si j'y trouvais une quelconque théâtralité. Je l'ai aussitôt mise en scène. Il s'est par la suite consacré à l'écriture dramatique et romanesque. Son théâtre m'a toujours stimulé. C'est un théâtre en liberté, sans concession, une oeuvre de déraciné, d'exilé. Aujourd'hui, alors que je ne dispose plus d'espace ni de moyens, j'ai un peu le sentiment de revenir à mes sources, à mes débuts, à l'époque où je montais Gombrowicz, Arrabal ou bien sûr Copi...
Propos recueillis par Pierre Notte
La Terrasse, novembre 1999.
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Cartoucherie - Théâtre de la Tempête
Cartoucherie - Théâtre de la Tempête
Route du Champ de Manœuvre 75012 Paris
- Métro : Château de Vincennes à 1 km
- Bus : Cartoucherie à 174 m, Plaine de la Faluère à 366 m
-
Navette : Sortir en tête de ligne de métro, puis prendre soit la navette Cartoucherie (gratuite) garée sur la chaussée devant la station de taxis (départ toutes les quinze minutes, premier voyage 1h avant le début du spectacle) soit le bus 112, arrêt Cartoucherie.
En voiture : A partir de l'esplanade du château de Vincennes, longer le Parc Floral de Paris sur la droite par la route de la Pyramide. Au rond-point, tourner à gauche (parcours fléché).
Parking Cartoucherie, 2ème portail sur la gauche.
Plan d’accès - Cartoucherie - Théâtre de la Tempête
Route du Champ de Manœuvre 75012 Paris