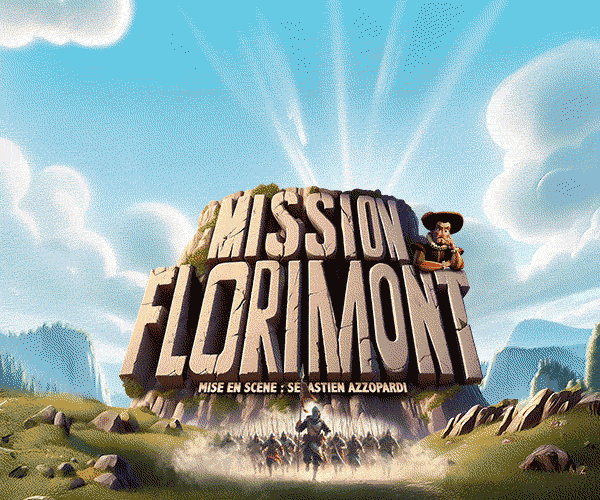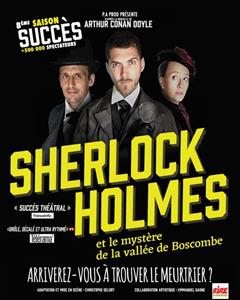La collection/L'amant
La collection/L'amant
- De : Harold Pinter
- Mise en scène : Patrice Kerbrat
- Avec : Jean-Pierre Cassel, Thierry Fortineau, Brigitte Fossey, Michel Voita
Le masque des mots
Les
présentations de la Collection et de l’Amant
Les critiques à la création en 1965
Héritier revendiqué de Beckett, d'abord comédien puis dramaturge, Harold Pinter a mis le feu au théâtre contemporain : chez lui, les mots ne servent pas à dire la vérité, mais à la cacher. Sous l'apparence de la plus extrême civilité, ils dissimulent des gouffres de sauvagerie, des océans de haine et de désirs cachés. Ils servent à dessiner le paysage de la banalité quotidienne en même temps qu'ils la dénoncent. Pour Pinter, l'homme est une bête féroce tapie derrière les chapeaux melons et les sandwiches au concombre. Dans ses pièces, " les relations que nous avons avec nos semblables sont fondées, soit sur le malentendu, soit sur l'agression. La critique de langage est combinée avec une conception radicalement pessimiste des rapports humains. Leur pouvoir comique repose sur un affrontement de forces indépendantes de toute idée de valeurs morales, sur une dialectique sournoise, dont les fins sont l'appropriation ou l'anéantissement de l'autre ". Le public rit parce qu'il croit reconnaître sous la cruauté un archétype familier, celui de " l'humour britannique ". Mais il y a plus que cela : un jeu subtil avec le langage. Les pièces de Pinter sont composées comme une partition musicale. On pourrait y mettre en évidence " un réseau compliqué de rapports, un enchevêtrement ordonné de correspondances entre les mots, correspondances fondées non plus sur le sens explicite, mais sur leur sens second ou caché, ou sur l'écho inquiétant qu'ils éveillent en nous. Les mots sont utilisés pour eux-mêmes, comme des notes de musique, et leur assemblage n'est plus tout à fait celui du discours mais celui de l'incantation. " *
Duo et quatuor de théâtre de chambre, proches par la date de leur composition et le milieu social qu'elles mettent en scène, L'Amant et La Collection déploient, sous le mensonge des vies ordinaires, le tumulte de passions primitives, assouvies ou rêvées. Mais ici, Pinter prend ses distances avec ses personnages et manie l'ironie en faisant, par exemple, d'un couteau à fromage, l'arme d'un possible crime. Puis, quand les eaux retombent et que le rire s'éteint, il les abandonne à leurs frustrations, à leur solitude et à leur détresse. Mais qu'en pense le chat ?
Patrice Kerbrat
* J. L. Curtis, préface à La révolution théâtrale actuelle en Angleterre de Daniel Salem.
Les présentations de la Collection et de l’Amant
Depuis leur création parisienne, les pièces de Pinter sont régulièrement représentées en France et dans les pays de langue française.
La pièce la plus souvent jouée est, sans conteste, l’Amant depuis sa création au Théâtre Hébertot le 27 septembre 1965, dans une mise en scène de Claude Régy et un décor de François de Lamothe, avec Jean Rochefort, Delphine Seyrig, Bernard Fresson. Une trentaine de compagnies l’ont présentée à Paris et en province, en Belgique (où Pinter a gagné ses lettres de noblesse avant la France elle-même), en Suisse et au Canada francophone. En 1982, l’Amant a été joué deux fois à Paris : d’abord au Fanal, par Anne-Catherine Ascione et Gilles Vernet, et surtout au Théâtre de l’Epicerie, où Philippe Ferran a dirigé Marie-Catherine Conti et François Siener (puis Nils Arestrup) dans une version quelque peu iconoclaste mais fascinante. Cette version a été présentée au Festival d’Avignon Off.
La Collection, créée également au Théâtre Hébertot en 1965 dans une mise en scène de Claude Régy, avec Jean Rochefort, Michel Bouquet, Delphine Seyrig et Bernard Fresson ; a été jouée depuis une bonne vingtaine de fois un peu partout, et notamment à Paris, où la présentation la plus remarquable a été donnée par un jeune comédien-metteur en scène, Eric Lorvoire, avec Rachelle Boulanger, Jean Viala et Claude Leblond, d’abord au café-théâtre de l’Odéon, puis au Bec Fin en 1980. Plus récemment , il convient de signaler la mise en scène de Jean-Pierre Miquel au Théâtre 13, en 1985, avec J-L Wolff, Gabrielle Forest, Alain Lenglet et Marc Michel.
Les critiques à la création en 1965
Le Nouvel Observateur, Robert Abirached : La réussite est complète.
S’il entrait dans le succès le moindre grain de justice ou de simple bon sens, le
Théâtre Hébertot ne devrait pas désemplir de toute la saison ; les deux pièces
de Harold Pinter qui s’y donnent depuis une semaine constituent le spectacle le plus
brillant, le plus sincère et le plus neuf qu’on puisse voir en ce moment à Paris.
Un texte admirable de subtilité et d’économie, une interprétation hors pair, un
décor qui joint à une élégance raffinée le mérite d’une commodité parfaite,
une mise en scène, enfin, où la main de Claude Régy s’est faite invisible à force
d’exactitude : la réussite est complète.
Quelle gageure pourtant ! C’est qu’on ne saurait rien imaginer de plus
anglais que l’œuvre de Pinter : cet humour froid, ce sens indéracinable du
concret, ce langage qui semble construit dans le seul but d’éluder ce qu’il y
aurait précisément à dire, ces maniaques subtilités du rituel social qui, à mesure
qu’il corsète le comportement , apporte à l’esprit un maximum de liberté,
tout est intransmissible ici et presque tout réussit à passer.
Le Monde, Bertrand Poirot-Delpech : Comme Albee et Genet…
Comme Albee et Genet, Pinter exploite volontiers les ressources dramatiques
des provocations homosexuelles (Caretaker).
Mais de ces héritages et de ces schémas reconnaissables naît une manière personnelle
et tout à fait neuve de suggérer en raccourci les personnages et leurs relations. Une
certaine façon étonnée de les faire s’entendre à demi-mot sur des sentiments ou
des élans finalement incertains, dans la connivence invérifiable de la litote et de
l’humour. Les Français ne sont pas préparés à apprécier cet équivalent
théâtral de l’Understatement.
La Croix, Henri Rabine : C’est du grand art.
Le jeu est subtil. A première vue on dirait du boulevard. Si vous voulez mon avis,
d’ailleurs, c’en est. Personnages, situations, décor, milieu, tout en
témoigne. Le dialogue lui-même, qui n’empreinte rien au délire poétique où
ronronne une certaine avant-garde. Les mots, ici, sont clairs. Mais ils sont rares. Ils
posent clairement des questions claires. Mais celui ou celle à qui elles sont posées y
répond… clairement, certes, mais jamais deux fois la même chose. Il y a alors de
longs silences où on se regarde, où chacun essaie de deviner l’autre, qui sourit
avec beaucoup d’amitié. Mais ne répond à rien. Sous ses visages et derrière ces
répliques également lisses, le mensonge bat. Où ? Ca !…
C’est un régal d’agacement. De la politesse au poignard. Un poignard
soigneusement ganté de velours. C’est du grand art.
Arts, Gilles Sandier
Car c’est bien de musique qu’il s’agit, une musique que la mise en scène
de Claude Régy fait magistralement et subtilement entendre : musique de chambre dont
l’insolite tempo a quelque chose de fascinant, comme un piège. Il a su faire des
silences le prolongement, l’orchestration de cette écriture de Pinter dont
l’aptitude à saisir le décousu, l’absurdité apparemment rigoureuse de la
conversation courante a quelque chose de stupéfiant : une écriture à la Beckett,
toute de litote, de précision terrible, d’ellipse inquiétante ; une écriture
au scalpel, dans laquelle les mots finissent, comme en se jouant, par mettre des couteaux
dans les mains des protagonistes.
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Chaillot - Théâtre national de la Danse
Chaillot - Théâtre national de la Danse
1, Place du Trocadéro 75016 Paris
- Métro : Trocadéro à 96 m
- Bus : Trocadéro à 31 m, Varsovie à 271 m, Pont d'Iéna à 297 m
Plan d’accès - Chaillot - Théâtre national de la Danse
1, Place du Trocadéro 75016 Paris