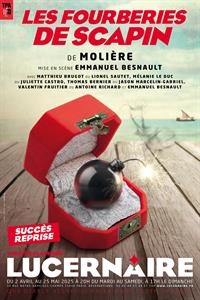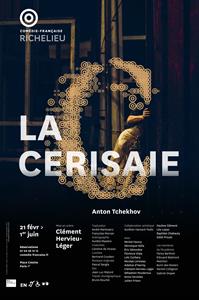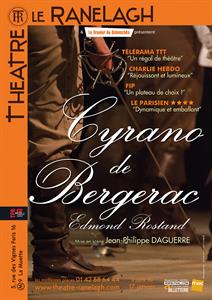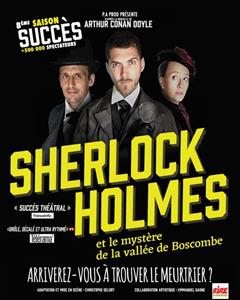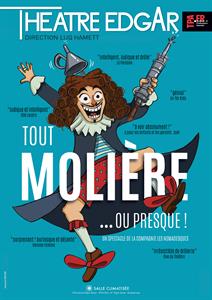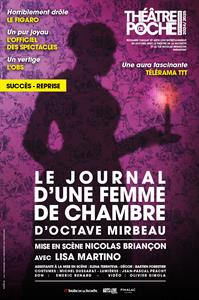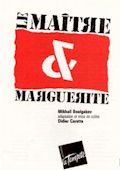
Le Maître et Marguerite
Le Maître et Marguerite
- De : Mikhaïl Boulgakov
- Mise en scène : Didier Carette
- Avec : Bruno Canredon, Didier Carette, Olivier Chombart, Cécile Cohen, Evgueniy Djurov, Georges Gaillard, Nicolas Grandhomme, Hubert Kruczynski, Steve Martin, Benoît Mochot, Anne Pintureau, Gérard Pollet, Valérie Régis, Gérard Rivière, Mathilde Robinet, Nathalie Vidal
Une farce tragique
Boulgakov et le diable
Satan, surgi dans un monde de morts-vivants accablés sous le poids du stalinisme, propose, comme en un miroir grossissant, l'image grotesque d'une Russie paralysée par le communisme. C'est aussi le magicien qui fait danser ce peuple de fantômes, torture les consciences abruties par le rationalisme socialiste et réveille paradoxalement l'image de Dieu. Une œuvre extraordinairement riche où se mêlent la poésie, la religion, la politique, la métaphysique.
Sous-tendue par une théâtralité multiforme, l'œuvre de Boulgakov se rattache directement à la tradition d'une culture populaire. Et justement, sans jamais se référer totalement à une quelconque réalité historique, il parvient à dénoncer d'un bloc les arrestations, les prisons, la délation, les interrogatoires, les meurtres politiques, les manipulations, le désespoir, la terreur multiforme, en restant d'un bout à l'autre de l'œuvre, et paradoxalement, drôle et sarcastique.
Quand Boulgakov condamne la révolution, ce déchaînement de haine, de violence et de bestialité, il tient toujours à se placer d'un point de vue éthique plutôt que d'un point de vue idéologique. Le roman évolue d'ailleurs selon deux plans, l'un dans le Moscou des années vingt, l'autre à Jérusalem pendant la confrontation Jésus-Pilate. Boulgakov évite donc largement la simple contestation politique et crée, grâce à ces deux univers, un cauchemar où toute logique est absente, une farce tragique et fabuleuse.
Didier Carette
Boulgakov et le diable
Boulgakov fut obsédé par le diable. Et, par là, il se situe dans l’héritage de
Gogol. Le diable et ses manigances, au delà du comique, sont une façon de nous montrer
le grotesque du nouvel ordre né de la révolution d’octobre, avec une outrance et un
grossissement qui nous offrent un tableau de la Russie relevant plus de l’absurde des
Marx-Brothers que du paradis social promis par les marxistes.
La comparaison avec les Marx-Brothers ne relève pas seulement du jeu de mots : la technique d’écriture de Boulgakov, où la mimique et le geste occupent une place importante, est véritablement cinématographique. Le rythme rapide, parfois heurté, le brusque découpage de l’action rappellent le cinéma comique du début des années 20.
Dans la plupart de ses œuvres, l’extrême rapidité de l’action, la succession échevelée des plans, illustrent la brisure vécue par ses héros : la rationalité censée être le maître mot d’une révolution qui milite contre la religion et la superstition, est éclatée en mille morceaux, il n’y a plus de cohérence au sein d’un système qui détruit les anciens rapports sociaux.
Boulgakov fut très vite frappé d’ostracisme aussi bien par les hommes du
pouvoir, zélateurs du “réalisme socialiste” que par les futuristes les plus
sincères. Qualifié de “contre-révolutionnaire conscient” ou
“d’émigrant de l’intérieur”, cela revenait à le condamner à mort
professionnellement.
En 1930, après avoir reçu de Boulgakov une lettre où il exprimait l’étouffement
dans lequel les autorités lui imposaient de vivre, Staline lui proposa de quitter
l’URSS, lors d’un coup de téléphone demeuré célèbre. Boulgakov préféra
rester, malgré son hostilité au pouvoir. Aucun de ses textes ne fut publié de 1928
jusqu’à sa mort en 1940.
Le Diable de Boulgakov est plutôt une espèce de Satan, un accusateur plus qu’un calomniateur, un farceur qui révèle non seulement le côté négatif, l’ombre de toute chose, mais aussi le néant que représente pour son auteur le chaos communiste. Il y a, dissimulée derrière ces débordements comiques et grotesques, une prise de position philosophique.
En nous montrant des personnages sans âme qui évoluent dans une société
fantomatique, car régie par l’absurde et le non-sens, Boulgakov rejoint Berdiaev
qui, dans son étude sur les Esprits de la Révolution écrite en 1918 envisage la
mascarade nihiliste comme un retour des “trognes et des gueules gogoliennes”.
Jeu constant entre le tragique comique, le religieux et l’anti-religieux, de
l’être et du non-être, nous assistons à un carnaval absurde et tragique, à
l’image de ce que fut l’Union Soviétique.
Bernard Kreise, postface de Diableries,
éditions Mille et une Nuits
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Cartoucherie - Théâtre de la Tempête
Cartoucherie - Théâtre de la Tempête
Route du Champ de Manœuvre 75012 Paris
- Métro : Château de Vincennes à 1 km
- Bus : Cartoucherie à 174 m, Plaine de la Faluère à 366 m
-
Navette : Sortir en tête de ligne de métro, puis prendre soit la navette Cartoucherie (gratuite) garée sur la chaussée devant la station de taxis (départ toutes les quinze minutes, premier voyage 1h avant le début du spectacle) soit le bus 112, arrêt Cartoucherie.
En voiture : A partir de l'esplanade du château de Vincennes, longer le Parc Floral de Paris sur la droite par la route de la Pyramide. Au rond-point, tourner à gauche (parcours fléché).
Parking Cartoucherie, 2ème portail sur la gauche.
Plan d’accès - Cartoucherie - Théâtre de la Tempête
Route du Champ de Manœuvre 75012 Paris