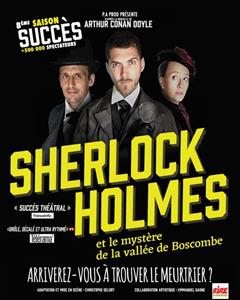Le journal d'une femme de chambre
Le journal d'une femme de chambre
- De : Octave Mirbeau
- Mise en scène : Jonathan Duverger
- Avec : Natacha Amal
- Quand la parole libre s'oppose aux journées de mutisme
En 1900, lors de sa parution, Le Journal d’une femme de chambre fit l’effet d’une bombe. Malgré la presse conservatrice, qui le passa sous silence, il connut un immense succès de librairie. C’est encore aujourd’hui le titre le plus célèbre d’Octave Mirbeau.
D’aucuns, hypocritement pudiques, le relèguent au second rayon, enfer des bibliothèques, parmi les opuscules croustillants ou sulfureux. C’est le dévaluer pour ne pas l’entendre. C’est refuser de le lire pour ce qu’il est : un cri de détresse et de colère, un appel à l’indignation que Mirbeau reprend à son compte. Célestine, c’est elle et c’est lui. Elle a son rire de satiriste, sa verve de pamphlétaire, sa fulgurance de poète.
Célestine est née à Audierne, dans une famille de pêcheurs. On n’y mange pas à sa faim. Par une nuit d’épouvante elle a vu, de ses yeux d’enfant, le corps sanglant de son père, fracassé par la tempête. A douze ans, elle n’est plus vierge. Comme beaucoup de jeunes Bretonnes, la voici, encore gamine, qui débarque à Paris pour s’y placer comme bonne. Et c’est, de « place » en « place », dans les beaux quartiers de la capitale ou chez les notables de province, un parcours d’humiliation, d’asservissement physique et moral.
Mais Célestine n’est pas douée pour la soumission. Sous le fard des bonnes manières elle a tôt fait de découvrir le hideux visage du cynisme et de la rapacité ; bafouée dans sa dignité de femme, d’être humain à part entière, cette « assommée » tient tête aux « assommeurs ». Elle rembarre les patrons qui se prévaudraient volontiers d’on se sait quel droit de cuissage. Quand son désir répond au leur, et seulement alors, elle court l’aventure, au risque d’y laisser des plumes. Quand survient l’amour, elle s’y lance éperdument, au risque de s’y broyer l’âme.
Les mentalités sont contagieuses. Dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu deviens. Célestine est une victime, mais une victime intoxiquée par les fallacieuses « valeurs » et la canaillerie secrète des maîtres et de leurs larbins. Comme Brecht, mais bien avant lui, Mirbeau accompagne son héroïne jusque dans ses aveuglements. Croit-elle trouver son salut dans une planche pourrie, il nous la montre ravagée de ce pitoyable espoir. La grandeur de ce livre est de ne pas rêver un monde où d’increvables orphelines survivraient à tous les outrages, à jamais immaculées. Le Journal d’une femme de chambre est un anti-mélodrame. Et c’est en quoi il nous atteint.
Voici bientôt cent ans que Mirbeau est mort. Les chambres de bonne sont devenues des « studettes » qui se louent à prix d’or. L’ère du petit personnel féminin, corvéable et jetable, n’est pas pour autant révolue. Nos assommées d’aujourd’hui sont caissières de supermarché ou « techniciennes de surface ». Le bureau de placement a changé de nom, mais on y fait toujours la queue. Dans les beaux quartiers, la nuit, fouillant poubelle après poubelle, des ombres vont la faim au ventre. Et l’espoir est toujours en crise.
Du Journal d’une femme de chambre Luis Buñuel a tiré la matière d’un film qui transpose l’action dans les années 30. La banalité de cette petite ville où Célestine est enlisée, la monotonie des alentours, le conformisme et la mesquinerie des uns, la brutalité, le dévergondage, l’intolérance et le fanatisme des autres composent le sombre tableau d’une province pousse-au-crime qui pourrait assez convenir à un roman de Simenon. Pour être fidèle à Mirbeau il eut fallu nous rendre témoins de ces heures enfiévrées où la femme de chambre, seule dans sa mansarde, reprend le fil de ses journées dans une prose vengeresse. Du matin au soir elle a dû répondre à un prénom qui n’est pas le sien, être « Marie » pour ses patrons comme celles qui l’ont précédée, n’exprimer rien de personnel, n’être qu’un meuble de plus, meuble à peine vivant parmi les meubles morts. Lorsque tout le monde est couché, rendue à elle-même, elle redevient Célestine et ne se refuse aucune violence d’expression, aucun sursaut de révolte. Le film en noir et blanc, glacial et incisif, ne pouvait laisser place à ces giclées de couleurs pures. Il y manque les coups de brosse rageurs d’un Munch, d’un Soutine ou d’un Bacon.
Mirbeau, proche de Zola, fut des plus ardents à le seconder durant l’Affaire Dreyfus. Mais il n’a jamais adhéré aux principes de l’école naturaliste. Il se veut, il se proclame subjectif. Pour épancher sa colère, exaltant celle de Célestine, ce n’est pas assez du roman. Il choisit donc le journal, l’espace ouvert du carnet intime, l’exutoire des sentiments personnels. Equivalent théâtral du journal : le soliloque. Non point monologue, toujours adressé au public, mais cette parole que l’on s’adresse à soi-même en parcourant la scène imaginaire des souvenirs chargés d’affects. Cette voix qui, le jour durant, s’est neutralisée pour n’émettre que des formules d’obéissance, cette voix blanche et captive prend la clef des champs, saute d’un ton à l’autre, s’émerveille de ses pouvoirs. Et ce corps qui, le jour durant, s’annulait sous l’uniforme, reprend possession de lui-même dans l’ivresse d’une résurrection.
Secrète revanche, mais combien savoureuse ! Les patrons faisaient figure de grands premiers rôles, « Marie » n’était qu’un accessoire dont ils jouaient négligemment. Le soir venu, convoqués par Célestine sur la scène de ses fantasmes, ils ne sont plus que des fantoches, des mannequins, cibles passives de sa « folie d’outrage ». Elle est protagoniste du monodrame, la star d’un one-woman-show.
Au centre du plateau, comme au cœur de son obsession, exhaussée sur un socle, la bicoque abhorrée, le « château » des Lanlaire. C’est une grande maison de poupées : deux mètres de long, un de haut. Quelques marches l’encadrent de part et d’autre : tapis rouge, tringles de cuivre. Fermée, c’est « l’immense bâtisse qui a l’air d’une caserne ou d’une prison » ; Ouverte, vue en coupe labyrinthique, c’est « la sale baraque que quatre domestiques ne suffiraient pas à tenir en état. Chacun de ses étages, chacune de ses pièces est synonyme de corvée. Tout est là, en modèle réduit, comme un concentré d’ennui, de besogne répétitive. Tout est là, miniaturisé, jusqu’à la baignoire quotidiennement récurée, jusqu’au pot de chambre de madame, ce précieux pot de chambre de porcelaine qu’il faudrait peut-être « envoyer à Londres quand il est fêlé »… ! Non mais … !
A toi de jouer Célestine !
Adaptation de Jonathan Duverger.
Sélection d'avis des spectateurs - Le journal d'une femme de chambre
Le journal d'une femme de chambre Le 17 octobre 2012 à 11h47
Natacha Amal, merci. Quelle comédienne ! Hier soir à Rouen, dès les premières phrases elle a su capter l'imaginaire du public pour l'emporter dans ce récit grave mais beau et tantôt presque léger. Son visage tellement expressif apporte beaucoup au rôle. Quel bonheur, car elle joue, jamais elle ne surjoue ! De plus le texte est une peinture (hélas) réaliste de la vie au sein des maisons bourgeoises du début du siècle passé.
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Le journal d'une femme de chambre Le 17 octobre 2012 à 11h47
Natacha Amal, merci. Quelle comédienne ! Hier soir à Rouen, dès les premières phrases elle a su capter l'imaginaire du public pour l'emporter dans ce récit grave mais beau et tantôt presque léger. Son visage tellement expressif apporte beaucoup au rôle. Quel bonheur, car elle joue, jamais elle ne surjoue ! De plus le texte est une peinture (hélas) réaliste de la vie au sein des maisons bourgeoises du début du siècle passé.
Informations pratiques - Théâtre de l'Ouest Parisien
Théâtre de l'Ouest Parisien
1, place de Bernard Palissy 92100 Boulogne Billancourt
- Métro : Boulogne Jean Jaurès à 460 m
- Bus : Église à 189 m, Rue de Billancourt à 346 m
Plan d’accès - Théâtre de l'Ouest Parisien
1, place de Bernard Palissy 92100 Boulogne Billancourt