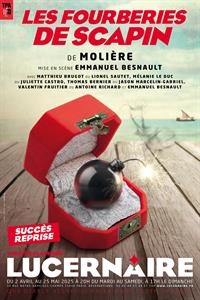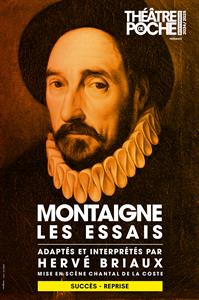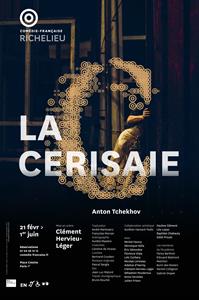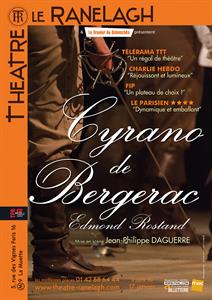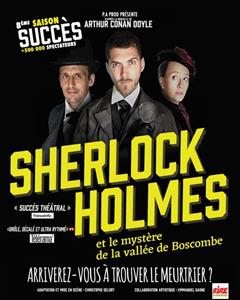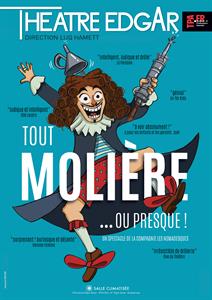Rodogune
Rodogune
- De : Pierre Corneille
- Mise en scène : Francis Sourbié
- Avec : Nadine Alari, Henri Deus, Dominique Chagnaud, Ann-Gisel Glass, Patrick Martinez, Jacques Roehrich, Philipp Weissert
La pièce
Pourquoi monter Rodogune?
Quel parti pris avez- vous choisi?
Pourquoi ces comédiens?
Créée pendant l’hiver 1644-1645, sous la régence d’Anne d’Autriche,
Corneille s’inspire, très librement, d’un épisode des guerres de Syrie pour
écrire Rodogune.
Sans doute l’auteur de cette tragédie traite-t-il des tactiques, des ambitions et de
manœuvres politiques, sujets qui émailleront l’ensemble de son œuvre, mais
il s’attache surtout à dépeindre deux caractères de femmes hors du commun,
dévorées et déchirées toutes deux par le désir du pouvoir : Rodogune, princesse
parthe et Cléopâtre princesse égyptienne et reine de Syrie.
Une tragédie sans un instant de répit où la haine succède à la soif de puissance et
où rien ne peut s’arrêter. Une tragédie où les passions s’affrontent, se
déchirent, jusqu’à la mort, dans toutes les zones d’ombres de l’âme
humaine. Une lutte où rien ne peut s’arrêter... jamais !
Cléopâtre, reine de Syrie, se voit contrainte de placer sur le trône l’aîné des jumeaux qu’elle a eu d’un premier mariage avec Nicanor, roi de Syrie. Ce dernier, prisonnier des Parthes, revient en son pays répudier Cléopâtre pour épouser Rodogune, soeur du roi des Parthes et ramener la paix entre les deux nations. Cléopâtre assassine son mari et garde Rodogune prisonnière. Elle décide de donner cette dernière à l’aîné de ses fils. Mais la folie du pouvoir s’étant emparée d’elle, elle conçoit une machination terrible qui doit voir la mort de ses enfants et de Rodogune, et lui conserver le pouvoir. Mais...
Sans doute parce que voici la pièce de Corneille la plus éclairante sur les " mécanismes " d’un pouvoir qui détruit tout. Parce que, plus encore que dans d’autres oeuvres, l’auteur va jusqu’au bout du traitement psychologique de l’ambition qui conduit à la folie humaine, fut-elle contre nature. Parce que " si l’on ne parle pas couramment Corneille dans le métro ", l’analyse de la folie du pouvoir qu’en fait un auteur du XVIIème siècle me parait parfaitement s’appliquer à une situation mondiale toujours présente et hélas, sans doute éternelle.
Quel parti pris avez- vous choisi?
Avant tout celui de privilégier le texte, de le détailler, de le ciseler comme une oeuvre musicale, voire peut-être comme un opéra. De respecter le côté baroque de l’oeuvre tout en le transposant dans un univers de grandeur et de rigueur. Je me suis laissé porter par l’écriture, les situations, les caractères pour inventer des costumes, un décor, un sens des éclairages, une musique et surtout, un postulat de jeu scènique qui prolongent " matériellement " mon approche et ma compréhension de l’oeuvre. A la fois folie et enfermement, apparat et misère, tyrannie et totalitarisme, cruauté et violence contenue. Comme le disait un de mes amis au sortir d’une représentation de la pièce il y a quelques années: " Je n’ai pas aimé parce que je n’ai pas eu peur ". Oui! cette pièce doit et ne peut que susciter en nous une réaction de peur...
Parce que ce sont des comédiens qui pratiquent leur art avec toute la simplicité, la dévotion et la force de l’amour. Parce que j’ai, au cours des années, travaillé avec eux souvent et que le bonheur de les réunir ici ne peut être qu’un atout majeur à la réussite de ce spectacle.
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Vingtième Théâtre
Vingtième Théâtre
7, rue des Plâtrières 75020 Paris
- Bus : Henri Chevreau à 66 m, Julien Lacroix à 190 m, Pyrénées - Ménilmontant à 392 m
Plan d’accès - Vingtième Théâtre
7, rue des Plâtrières 75020 Paris