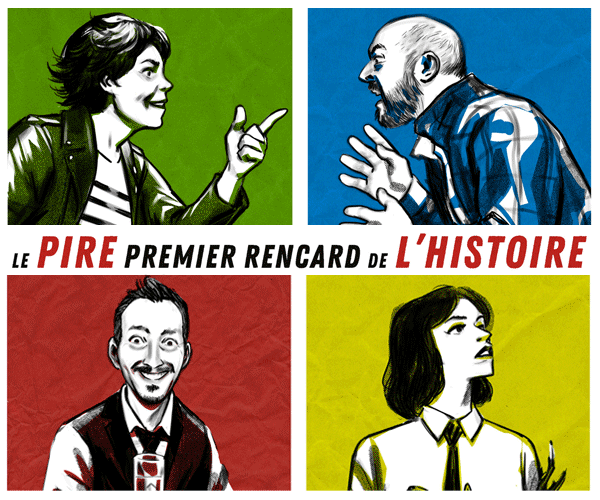The One Dollar Story
The One Dollar Story
- De : Fabrice Melquiot
- Mise en scène : Roland Auzet
- Avec : Sophie Desmarais
L’équipe de Roland Auzet traverse l’océan pour dévoiler ce projet de performance inouï après sa création à Montréal. Album de famille, enquête policière et quête initiatique, ce seule-en-scène confronte une actrice à sa solitude.
- Road trip américain
Jodie est comédienne à Portland dans l’Oregon et survit grâce à des petits boulots. Peu avant la mort de son père adoptif, elle apprend que son histoire n’est pas celle qu’on a bien voulu lui raconter. Elle se lance alors dans une enquête vertigineuse sur ses origines avec pour indice un mystérieux billet d’un dollar.
En toile de fond de ce road trip au travers des grands espaces américains, les années 70 et ses artistes iconiques de la Beat Generation comme Leonard Cohen. Une époque qui met en scène la liberté comme une production hollywoodienne. Tout est faux, tout est fake. Au fond, tout ce qu’elle raconte n’a peut-être jamais existé…
- Note d'intention
Je voue à certains écrivains américains une admiration bornée, lucide et pourtant sans limite. Je les aime jusque dans ce que je n’aime pas d’eux ou de leurs livres. Je pense à Brautigan ou Kerouac, Plath, Carver ou Roth. Jeune adulte, mon cœur s’est tourné vers eux, à la faveur d’accidents de lecture ou de rencontres amicales.
Un jour d’hiver, il y a une vingtaine d’années, François Négret m’a le premier parlé de Richard Brautigan, dans un café parisien, Place de la République.
Enzo Cormann m’a conseillé la lecture des Souterrains.
Je ne sais plus comment je suis arrivé aux poèmes de Sylvia Plath, mais j’ai écrit une pièce qu’elle hante de bout en bout et hanté à mon tour, j’ai été frappé un jour à la porte de la maison londonienne où elle se suicida, la tête dans un four.
Julie Vilmont, qui fut ma professeure de théâtre, me jeta dans les nouvelles de Carver, écumées cent fois depuis. J’ai découvert Portnoy et son complexe à 16 ans, attiré par la couverture du livre en format poche, pensant qu’il s’agissait là d’un roman érotique. À chacun de ces auteurs, je pense comme on nourrit pour des oncles et tantes américains une affection fantasmée, dopée à l’ailleurs, au lointain, à des paysages dont on rêve parce qu’on ne les a pas bus.
Je ne sais pas grand-chose de l’Amérique. New-York, San Francisco, Chicago, ce n’est pas grand-chose. Mais l’infini des fictions produites par ce pays irrigue les yeux et le cortex du commun des mortels ; me voilà des grandes villes et des grands espaces l’amoureux colonisé. J’avoue : j’ai consenti et je consens encore à prendre de plein fouet le flux des films, poèmes, romans, nouvelles, que l’Amérique déverse dans les canaux de nos perceptions. La fange et les splendeurs. Les merdes innombrables, les produits manufacturés, et les perles sauvages. Je suis fait de ça comme de la poésie d’Yves Bonnefoy, je suis fait de ça comme de certains romans de gare qui m’ont autorisé à lire.
The One Dollar Story n’est pas un hommage à la littérature américaine. C’est un voyage à l’intérieur d’une femme qui connaît l’Amérique mieux que moi. Un récit-théâtre, écrit pour être habité à voix haute par un corps en mouvement, une femme enfermée dans l’enquête qu’elle a choisi de mener sur elle-même, et qui pour la résoudre, décide de prendre l’espace.
Chez mes oncles et tantes américains, ce qui me bouleverse, jusque dans l’enfance que je charrie, c’est peut-être ça : leur façon de prendre l’espace.
Je pense à cette chanson du groupe belge Deus, One advice ? Space. Prendre l’espace. Les grands espaces, les petits, l’espace de soi, l’autre en tant qu’espace à prendre. Je sens quand je me mets à ma table que l’écriture s’apparente à cela : une façon à soi de prendre l’espace, les espaces qui nous sont offerts, tous les espaces possibles. Jusqu’au silence, l’espace qui les contiendrait tous.
The One Dollar Story raconte l’épopée intime d’Emily Casterman, entre Oregon et Colorado.
Il est ici question de mensonge et de vérité, d’héritage et de punaises de lit, de l’extraterrestre de Roswell et du massacre de Ludlow. Leonard Cohen est partout. Pourquoi ? Parce qu’il est partout. Au centre de l’enquête littéraire et théâtrale qu’on est invité à mener, un mystérieux billet d’un dollar et une question qui est le fondement de tout individu : est-ce que je vis bien la vie que je suis censé vivre ?
La réponse est toujours non.
Fabrice Melquiot
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Les plateaux sauvages
Les plateaux sauvages
5 rue des Plâtrières 75020 Paris
- Bus : Henri Chevreau à 46 m, Julien Lacroix à 140 m
Plan d’accès - Les plateaux sauvages
5 rue des Plâtrières 75020 Paris