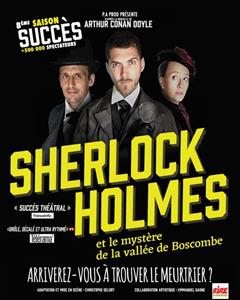Tout ce souffle que je retiens nourrit le feu
Tout ce souffle que je retiens nourrit le feu
- De : Peter Turrini
- Mise en scène : Charlie Brozzoni
- Avec : Anny Vogel, Claude Gomez, Sylvain Stawski, Thomas Desfossés
Présentation
La Compagnie Brozzoni
Extrait
du discours "Des artistes contre Waldheim", (Vienne, Volkstheater 1986)
Ce moment poétique et musical retrace l'enfance tourmentée de Peter Turrini, tiraillé entre l'image d'un père absent et d'une mère trop présente. Dès son plus jeune âge, il souffre en tant qu'étranger, fils d'ouvrier italien, de la difficulté à s'intégrer et du manque de respect de ses camarades – d'autant plus qu'il est gros, différent des autres. Né en 1944, il fait partie de cette génération d'enfants que la deuxième guerre mondiale a traumatisée. Quelques-uns d'entre eux vont se battre contre le silence des anciens qui refusent d'endosser la responsabilité de l'Autriche dans le conflit mondial. Toute son œuvre tend à dénoncer l'hypocrisie fondamentale, qui commence par l'amabilité de chacun, et s'étend à celle de toute une société. Il cherche à travers la prise de parole à changer l'homme, le monde et à défendre une littérature populaire.
Trois voix et un musicien évoquent en une heure et quart la vie et les fondements de la pensée d'un auteur, dans une attitude frontale et directe avec le public dont la forme, qui rappelle les cabarets expressionnistes, articule chants et paroles en un rythme enlevé. Ce souffle permet aux spectateurs réunis de mieux respirer les idées maîtresses, de mieux se saisir des images véhiculées par chacun des textes.
La Compagnie tente chaque jour d'élaborer un théâtre populaire contemporain, qui part à la recherche d'une poésie fondatrice de notre humanité. Un théâtre qui provoque, convoque les puissances archaïques de nos êtres, pour faire chaque fois un pas de plus vers l'homme, qui est le départ et l'aboutissement de tout art théâtral, un homme en cheminement vers la poésie totale.
1999 "Tout ce souffle que je retiens nourrit le feu" d'après Quelques pas en
arrière de Peter Turrini et les musiques et chansons d'Etienne Perruchon.
1998 "Sous un ciel, Mémoire des hommes d'aujourd'hui" de Véronique Laupin,
musique de Léo Plastaga.
1997 "La liberté ou la Mort" d'après l'œuvre de Nikos Kazantzaki, musique
d'Etienne Perruchon.
1996 "Eléments moins performants" de Peter Turrini, musique d'Etienne
Perruchon.
1994 "La Grande Parade au Cabaret de l'Ange Bleu" d'après "Grand'peur et
misère du 3ème Reich" de Bertolt Brecht, musique d'Etienne Perruchon.
1992 "Don Quichotte ou le voyage ou le voyage des rêveurs" d'après Miguel
Cervantes, adaptation Charlie Brozzoni, musique d'Etienne Perruchon.
"Quijote !" de Dominique Poncet, musique d'Etienne Perruchon.
1991 "Le Moine" de M.G. Lewis, adaptation d'Isabelle Famchon, musique de Gérard
Maimone.
1990 "Bouchaballe" d'après Max Jacob, musique d'Etienne Perruchon.
1989 "Paradis sur Terre" de Tennessee Williams, musique de Gérard Maimone.
La compagnie Brozzoni est en résidence de création à Annecy en partenariat avec la Ville d'Annecy, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, Bonlieu Scène nationale Annecy et avec le soutien du Conseil Général de Haute-Savoie.
Extrait du discours "Des artistes contre Waldheim", (Vienne, Volkstheater 1986)
J'ai grandi dans un village carinthien, après la guerre. Mon père était un travailleur immigré d'Italie. Le premier visage de cette République nouvelle qu'il me fut donné de voir fut celui des notables à la table réservée de l'auberge. Aucun deuil, aucun effroi ne se reflétait dans leurs mines face aux horreurs que le monde venait de vivre, aucun aveu de culpabilité de la part de ceux qui étaient co-responsables de ces horreurs. Au contraire, contents d'eux et intouchables, ils se partageaient le nouveau pouvoir au nom de fonctions nouvelles. Le Orts-gruppenleiter se mua en bourgmestre, l'instituteur national-socialiste devint directeur de l'école.
Mon père, ils le méprisaient. Il venait d'un pays où le soldat allemand, une fois de plus, avait été trahi. Ce mépris, qui nous frappait de la même façon, nous autres enfants, et que j'avait bien du mal à comprendre à l'époque, m'a chassé du pays. Comme ailleurs, il n'y avait que des étrangers et de l'étrangeté, je me suis bâti un pays littéraire, j'ai écrit contre les états de fait et imaginé des conditions dans lesquelles je pouvais me sentir chez moi. A la fin des années soixante, j'ai débarqué à Vienne, débordant d'idées et de pièces drues jetées sur le papier. J'ai de nouveau rencontré les habitants de la table réservée. Sûrs d'eux, inattaquables comme toujours, ils étaient installés dans les bureaux de l'administration de la culture et me firent fuir, moi et toute une génération d'écrivains, en Allemagne fédérale.
Depuis, les habitants de la table réservée ont beaucoup appris. Des agences de publicité leur ont conseillé de tailler plus court la touffe de chamois sur leur chapeau et dans leur tête, et de considérer avec plus d'ouverture sur le monde les vapeurs de bière de leur environnement. Ils ont libéralisé leur langage, mais pas leur être.
Je suis prisonnier de ma biographie. Ces gens, pendant tant d'années, m'ont tellement méprisé que moi, aujourd'hui, je les méprise.
Kurt Waldheim est un habitant de la table réservée, même s'il troque cette table contre une multitude de bureaux, voire le bureau mondial. En lui et derrière lui reparaissent les habitants des tables réservées de mon enfance, resurgit le visage de l'intouchable contentement de soi. S'il est possible de bannir de ce visage la culpabilité et le deuil, il est impossible d'en effacer l'hypocrisie et le refoulement.
Dans le village où j'ai grandi, il y avait aussi d'autres gens, et autre chose. C'est à la périphérie du village qu'habitaient, dans des baraquements la plupart du temps, les "rouges". Chaque jour, ils se rendaient en ville pour "travailler". Ils étaient exclus des rituels de la paysannerie et de l'église, ou s'en excluaient eux-mêmes.
Dans ces baraquements habitaient également des mutilés de guerre et des buveurs, des gens psychiquement et physiquement inaptes à participer à "la reconstruction". Un bibliothécaire alcoolique me racontait le mouvement ouvrier, son passé, son avenir. L'abrutissement et la désolation de la vie de ces gens étaient en contradiction criante avec ses récits. Néanmoins, je me suis senti attiré par ces gens-là, à contrecœur d'abord, puis de plus en plus intensément.
Cette attirance, dont l'origine n'était peut-être rien d'autre que ce sentiment commun d'être exclus par les paysans habitants de la table réservée, s'est muée au cours du temps et des années en appartenance politique et littéraire. Je suis parti du mouvement ouvrier et j'ai toujours compris mon travail comme la tentative d'œuvrer contre le déclassement humain, matériel et culturel des travailleurs. Ce déclassement, la social-démocratie qui est au gouvernement, en porte une grande part de responsabilité. Elle a acheté son entrée dans la bourgeoisie à un certain prix et avec une promesse.
Le prix, c'était l'abandon de l'identité culturelle et idéologique des travailleurs, la promesse, l'accès à la société de consommation. Le prix était trop élevé : les bibliothèques d'ouvriers fermèrent, un désert culturel se répandit et se répand dans la tête des travailleurs. L'abandon idéologique a fait émerger une espèce de fonctionnaire de parti ou de syndicat exempt de fondement et purement opportuniste. Le travailleur a renoncé à la réflexion – se défendre, se battre font également partie de la réflexion – au profit de ses fonctionnaires, et ceux-ci préfèrent y renoncer, de crainte d'être horrifiés par eux-mêmes.
Et la promesse ? A court terme elle fut tenue, grâce à des pavillons avec jardinet bâtis durant les week-ends ; aujourd'hui elle ne tient déjà plus. Le bref et menu bonheur des travailleurs n'a pas duré vingt ans. Nombre d'entre eux se retrouvent aujourd'hui dans leur pavillon, et incapables de rembourser les crédits. Même si l'on promet à présent, pour des raisons de stratégie électorale, la garantie de l'emploi, cela ne correspond plus aux possibilités et donc pas non plus à la vérité.
Je suis un prisonnier de ma biographie. Les habitants de la table réservée, je les méprise, et je désespère de l'état où se trouve la social-démocratie. Moi qui par principe n'ai pas de pays où me sentir chez moi, j'ai trouvé un zeste d'appartenance à la périphérie du village, plus tard dans des entreprises, lors de lectures publiques, de discussions avec des délégués syndicaux, d'actions communes, avec des apprentis du plus grand groupe sidérurgique en Autriche, et ainsi de suite. Mon pays n'a jamais été un lieu géographique. Il fut toujours, pour autant qu'il en eut un, un espace politique.
Peter Turrini
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Fontenay-en-scènes
Fontenay-en-scènes
166, boulevard Galliéni 94120 Fontenay-sous-Bois