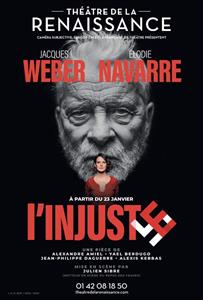Un Siècle d’industrie
Un Siècle d’industrie
- De : Marc Dugowson
- Mise en scène : Paul Golub
- Avec : Jean-Yves Duparc, Stéphanie Pasquet, Anne-Sophie Pommier-Dupré, Rainer Sievert, Brontis Jodorowsky, Yves Lecat, Xavier-Valéry Gauthier
Ce spectacle peut être vu à partir de 14 ans.
Pourquoi j’ai écrit cette pièce
La mise en scène
1918 - Aujourd’hui
Histoire et fiction
Entretien
La presse
En racontant l’histoire et la vie d’une entreprise allemande qui fournissait les camps d’extermination nazis en fours crématoires durant la deuxième guerre mondiale, Un Siècle d’industrie confronte le spectateur au processus de mise en œuvre politique, idéologique et technique du génocide des Juifs et à la participation des individus à ce processus. Pourtant cette entreprise qui s’était placée au cœur du dispositif de destruction des Juifs d’Europe, n’appartenait pas aux organisations criminelles d’Etat de l’Allemagne nazie.
L’implication criminelle de pans entiers de la société civile aux côtés des organisations criminelles d’Etat interroge l’ensemble de l’Humanité en ce qu’elle signe, à chaque génocide, la faillite du genre humain. Tel fut aussi le cas pour le génocide des Arméniens, tel est maintenant le cas pour le génocide des Rwandais tutsis, à tel point qu’on a pu parler pour ce dernier de génocide de « proximité ».
S’il s’inquiète du présent, Un Siècle d’Industrie s’inquiète aussi de l’avenir.
Marc Dugowson
“Un Siècle d’industrie est une pièce que j’aurais aimé avoir écrite mais je ne le pouvais sans doute pas, il fallait que ce soit un auteur qui n’ait pas les deux pieds dans le Xxe siècle. Le courage de Marc, sa solitude, son exigence, sa lucidité, font de lui un auteur du XXIe siècle. Vous qui vivez et vivrez dans ce XXIe siècle, suite absurde et logique de notre siècle d’industrie, que pourrez-vous dire à vos spectateurs ? L’œuvre de Marc Dugowson apporte une réponse. Je me réjouis de voir publier sa pièce, je me réjouirai davantage encore quand elle sera montée. Parmi la pléthore d’ouvrages qui cherchent à arrondir les angles, son Siècle d’industrie se révèle une entreprise qui n’a rien à voir avec l’industrie, fût-ce celle du spectacle.”
Jean-Claude Grumberg, extrait de la préface du texte édité à l’Avant-Scène Théâtre, collection Les Quatre-Vents.
Rigoureusement documentée, cette pièce remarquable, jamais montée jusqu’alors, révèle par petites touches le processus quotidien par lequel l’être humain peut arriver à participer activement à une entreprise d’extermination.
En effet, Un Siècle d’industrie part d’un fait réel entendu par l’auteur à la radio : la revendication, après la chute du mur de Berlin, d’un des ayant droits de la firme TOPF und Söhne, fabricants des fours crématoires, de restitution de ses “biens” mis sous séquestre par les communistes. Le personnage principal Otto Krüg est lui aussi inspiré d’un personnage réel, celui de Kurt Prüfer, chef ingénieur de cette même firme.
Utilisant une économie de moyen et une langue ciselée au burin, la pièce traverse 80 ans d’histoire en 34 saynètes. Bien que l’écriture s’ancre dans la réalité quotidienne des personnages, le passage du temps donne un relief historique à l’action et confère au texte sa théâtralité.
Le plus souvent le choix d’un texte ou d’un projet de mise en scène se fait pour moi après beaucoup d’hésitations et de doutes. Il me faut du temps avant que l’idée naissante et informe d’un projet se transforme en évidence et nécessité. Dans le cas d’Un Siècle d’industrie, chose rare, cette nécessité est née dès la première lecture. Voilà, me suis-je dit, un texte qui parle d’un sujet important, mais avec une évidente jubilation qui est propre seulement au théâtre : une langue ciselée au burin, des personnages forts et fortement dessinés, et une trame qui, d’un coup de baguette magique, télescope l’histoire de toute une époque avec celui des individus qui le composent dans un seul coup de poing narratif.
Avant tout il me semblait - comme il me semble toujours aujourd’hui - que ce texte, tout en parlant d’événements passés, réussissait à invoquer notre présent et notre avenir. La pièce pose la question : comment ces hommes et ces femmes ont-ils pu devenir complices de tels actes ? Et, en la posant, elle entraîne son corollaire : dans quelles conditions pourrions-nous devenir complices à notre tour ?
A deux semaines de la première le sens du projet se confirme à chaque répétition. Ma conviction solitaire est maintenant celle de toute une équipe et notre enthousiasme est sans faille. Chaque jour est un combat joyeux entre pour le bien du spectacle. Mais, la confrontation au plateau, aux costumes, au maquillage, au travail du son et de la lumière, nous rapproche inexorablement de la réalité de l’incarnation et de celle de notre rencontre imminente avec le public. Soudainement, le projet nous prend par les tripes et on se demande : peut-on vraiment mettre en scène et jouer les lâches, les criminels, ceux qui ont rendu possible le génocide nazi ?
Je pousse les comédiens à jouer sur le fil du rasoir, sans emphase, ni excès émotionnel, mais au plus près de leurs personnages, jusqu’à les défendre coûte que coûte, en se donnant à l’ironie noire du texte, sans jugement. Faire confiance au texte et au public.
Avec Un Siècle d’industrie on est à des années lumières d’un art officiel qui veut penser nos réactions pour nous : le texte nous met dans l’inconfort de nos propres sentiments et responsabilités, et c’est en cela qu’il est important.
Je voudrais pour toutes ces raisons saluer tous ceux qui ont eu le courage de nous soutenir dans ce voyage et plus particulièrement Pierre Pradinas et l’équipe du Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin, ainsi que Marc Jeancourt et le Théâtre Firmin Gémier - scène conventionnée d’Antony.
Un Siècle d’industrie suit la montée en puissance d’Otto Krüg, vétéran de la guerre de 14-18, dans la firme Kolb, firme d’ingénierie spécialisée dans le traitement des déchets. Au second plan se trament les histoires personnelles et quotidiennes de l’entreprise, et notamment l’histoire d’amour entre Krüg et Gertha Kolb, la femme du directeur.
Durant les années 20, l’entreprise Kolb échappera de peu aux crises économiques qui déferlent sur l’Europe et l’Allemagne en particulier. En 1937, Krüg préservera son emploi et assurera le développement de la firme en ramenant un nouveau marché : celui des fours crématoires utilisés pour l’incinération les corps des opposants du régime nazi, mort “naturellement ” lors de leur détention dans les camps de concentration.
Entre temps, Gertha Kolb annonce à Krüg qu’elle est enceinte de lui, tandis que le contremaître Ritter œuvre au sein de l’entreprise pour la sauvegarde “de l’honneur et du sang allemands” pour finalement rejoindre les rangs des SS.
Les années de guerre et la politique de destruction des Juifs et des Tziganes menée par les nazis à travers l’Europe conduisent à une accélération frénétique du travail. La SS demande des performances techniques de plus en plus hallucinantes à Krüg. L’ingénieur est amené à accroître la capacité des fours crématoires et à collaborer à la mise au point des chambres à gaz des camps d’extermination, devenant ainsi activement complice du génocide. Mais les Russes et les Américains gagnent du terrain. Krüg sent bien que la “guerre contre les Juifs” est perdue. Kolb se suicide. Krüg disparaît dans le Goulag.
La pièce fait ici un saut radical dans le temps passant directement de 1944 à 1972. Dans la rue, Hilde Hartmann, ancienne salariée de la firme, reconnaît Hans Ritter, l’ancien contremaître nazi, à la fois son violeur et l’homme qui fit déporter son amant juif. Quand elle l’accuse, il prétend être quelqu’un d’autre, lui disant, de toute façon “Vous n’y changerez rien.”
Dans la dernière scène, après la chute du mur de Berlin, Gertha Kolb, qui est maintenant une très vieille dame, parlant à elle-même (ou peut-être au public) : « Aujourd’hui que notre nation est réunifiée, je réclame la restitution de nos biens abusivement mis sous séquestre par les communistes. Mon mari a donné du travail et des emplois. Il est mort. Les Soviétiques ont liquidé l’ingénieur. Il y a eu toutes ces histoires avec les juifs. Des exagérations monstrueuses. Les crématoires c’étaient seulement quelques pour cent du chiffre d’affaires. Nous avons assez payé comme ça. Les rouges ont perdu. Erfurt réintègre la nation allemande. On ne doit plus terroriser l’Allemagne avec l’histoire des juifs. Lieselotte n’était qu’une enfant. Mes petits-enfants n’étaient même pas nés. Ce soir, nous partons en famille dans le Tyrol. Pourvu qu’il fasse beau. »
Paul Golub, décembre 2005
Par définition, la fiction est contradictoire avec l’Histoire : raconter des histoires, ce n’est justement pas faire l’Histoire ; en outre, dans sa dimension théâtrale, la fiction répond à des exigences, comme l’unité de temps et l’unité de lieu, qui obligent aux raccourcis que l’historien cherche justement à prévenir dans sa recherche et son enseignement.
On peut alors se demander en quoi la fiction théâtrale peut constituer une médiation légitime dans la transmission de la Mémoire et de l’Histoire, quelle exploitation pédagogique il convient d’en faire… En fait, il s’avère que les contraintes de condensation et de déplacement auxquelles le théâtre doit répondre peuvent donner prise à une réflexion qu’un cours d’histoire aura peut-être plus de mal à susciter. En effet, l’exagération propre à la représentation théâtrale permet de mettre en évidence les aspects les plus problématiques des événements.
On pourra rester interdit à la lecture de la pièce de Marc Dugowson. De ce sentiment, de la réaction quelle qu’elle soit, qu’elle aura provoqué en nous, peut, doit surgir une interrogation, qui déborde des questions historiographiques par ailleurs nécessaires à la remise en contexte de l’action : comment, pourquoi cela a-t-il été possible, cela est-il possible ? Comment la cruauté, le cynisme le plus insoutenable, peuvent-ils être le fait de gens par ailleurs « ordinaires », pas même des soldats, pas même des décideurs, mais les maillons d’une trame mortifère, que la conscience peu à peu évidente de leur complicité à un crime abject, ne semble pas ébranler ?
On pourra retenir plusieurs axes de réflexion : l’inhumanité est ici représentée comme étant en germe en chacun de nous ; et en effet, seule l’humanité est susceptible de produire son contraire, au-delà de ce que serait une « simple » régression à la brutalité animale. Ainsi cette inhumanité ne peut être considérée comme l’apanage de la pathologie, d’une folie meurtrière, thèse confortable consistant dans la mise hors de soi de comportements qui échappent à notre compréhension. Bien au contraire, la pièce nous invite à refuser un tel déni, et à entrevoir plutôt cette possibilité au cœur de nos quotidiens.
Un autre aspect du texte suggère le rôle déterminant des conditions extérieures, d’un environnement social (chômage), politique et idéologique (un Etat qui incite à la haine et au crime au lieu de les interdire), qui constitue le terreau propice au développement de ce germe d’inhumanité qui est en chacun. Pour autant, et c’est un point essentiel qu’interroge ici la pièce, cela doit-il nous empêcher de considérer la responsabilité pleine et entière de ces intermédiaires, de ces rouages qui finalement semblent bien profiter de la situation pour laisser libre cours, dans un sentiment d’impunité alimenté par le pouvoir, à leur fascination pour la mort ? Celle-ci étant d’ailleurs traitée comme le pendant d’une sexualité livrée à l’expression des désirs les plus bruts, et de leurs réalisations les moins scrupuleuses…
Le style même du texte évoque cette brutalité, ce défaut de sentiment chez les protagonistes. Tout se passe comme si chacun cherchait à se mettre à distance de ses actes, à se déshumaniser pour rendre possible sa participation à la barbarie. Le malaise même que suscite ce contraste de mots « blancs », d’un verbe atonal, avec la violence des actes, peut donner matière à une approche des plus réflexives de ces heures sombres de l’Histoire des hommes, qui ne sont pas sans faire écho à des événements plus proches de nous.
Johanne Theate, professeur de philosophie, détachée au service éducatif du Centre de la Mémoire d’Oradour.
Jeudi 13 octobre 2005, Gabor Rossov du Théâtre de L’Union mène l’interview croisée de Marc Dugowson, Paul Golub et Philippe Marioge.
Gabor Rassov (GR) Quelle est l’idée première qui vous a amené à l’écriture de Un siècle d’industrie ?
Marc Dugowson (MD) Ce n’est pas une idée, c’est un fait. Quelques, années après la chute du mur de Berlin, nou savons été informés par les médias qu’une partie (j’insiste) des ayants droit de l’entreprise allemande TOPF und Söhne qui fournissait les camps de concentration et d’extermination, en fours crématoires réclamait la restitution de ses biens fonciers et immobiliers. J’ai été choqué. Je me suis dit que j’allais écrire une pièce sur cette demande en restitution en me posant la question de savoir ce qui pouvait germer dans la tête d’un ayant droit pour qu’il en arrive à réclamer la restitution des biens fonciers d’une entreprise qui s’était peu à peu placée au centre d’un génocide, celui des Juifs et des Tziganes. Je voulais commencer par l’évocation de ce fait pour pouvoir l’expliquer et en définitive j’ai écrit une pièce qui y aboutit. J’ai écrit une pièce qui aboutit à son commencement !
GR C’est un peu le secret de la pièce.
MD Il m’a fallu deux bonnes années pour remonter dans la généalogie de ce processus et d’un nouveau sens commun constitué autour d’un système de valeurs fondamentalement négatif. Comment le seuil d’empathie s’était-il abaissé au cours des années à partir de l’instant où l’entreprise s’était mise à rentrer progressivement dans un processus de criminalisation, à l’image de toute une société ? Comment ce processus avait-il cheminé jusque dans les esprits de certains des ayants droit en cette fin de 20e siècle ?
GR En choisissant d’écrire sur un tel sujet, avez-vous rencontré des difficultés plus générales quant à l’écriture de la pièce et à sa possible représentation ?
MD Oui. Je me suis dit tout de suite qu’il fallait écrire pour le théâtre et non rédiger une thèse. Ce que je souhaitais c’était montrer des situations et des personnages puis rendre compte, sans point de vue, d’un processus, ou comme le dit l’historien chercheur Jacques Sémelin, rendre compte d’un « continuum de faits » qui au bout du compte construit un processus génocidaire. Il fallait trouver une forme dramaturgique, c’est ce qui m’a pris le plus de temps. D’une part il fallait rendre compte de la vie de cette entreprise. Ce qui est éminemment théâtral. Comment faire vivre l’entreprise en tant que telle ? Comment faire vivre les personnages à la fois en tant que salariés, dans un lien de subordination salariale et encore dans le cadre de relations inter-personnelles ? D’autre part, comment faire évoluer des logiques extérieures à l’entreprise, des processus idéologiques et politiques qui impulsent des logiques économiques et de décisions au sein de l’entreprise ? Comment ces logiques influent-elles sur les personnages? Et comment en influant sur les personnages, influent-elles sur leurs relations. Encore fallait-il que cette démarche soit claire, dynamique, informative, pédagogique et non didactique.
GR Quand vous dites pédagogique, la démarche a donc été celle de « montrer » ?
MD C’est montrer. Quand on parle du génocide, ne consiste pas à se poser la question du « pourquoi ? » On pourra se la poser pendant 10 000 ans. Ce qui me semble essentiel d’un point de vue pédagogique, c’est de se poser la question du « comment ? ». S’il y a une volonté pédagogique, c’est celle de montrer « comment » et pas d’essayer d’expliquer « pourquoi ». J’y renonce et en plus je n’y tiens pas parce qu’expliquer pourquoi, c’est d’emblée trouver des raisons. De bonnes ou de mauvaises raisons, mais en tous cas des raisons.
GR Et dans quel espoir, ce « comment pédagogique » ? Dans l’espoir que les gens puissent s’identifier ? Dans l’espoir que l’histoire ne se reproduise pas ?
MD C’est du théâtre, une forme d’expression artistique, mais effectivement, il y a quand même une volonté pédagogique de montrer comment, parce que c’est en montrant comment que l’on peut éventuellement éviter de rentrer dans une logique quotidienne de duplicité. Ça va vite, c’est vite fait. Histoire d’un Allemand de Jean Haffner montre très bien comment une société se criminalise. Comment elle se criminalise à différents niveaux, comment les personnes participent à cette criminalisation et en fait, comme le disait une partie civile au procès Papon, comment elles acceptent que le crime fasse loi. « Le crime c’était la loi » disait-elle. Je trouve ce raccourci remarquable. On assiste là au renversement des valeurs étant entendu que la clé de voûte du système de valeurs est la mort et non la vie.
GR Est-ce qu’il s’agit d’écrire et de montrer de façon différente ?
MD La façon différente, consistait à ne pas mettre les victimes en présence des criminels. Je ne voulais pas qu’il puisse y avoir d’effet d’identification avec des personnages sur scène. C’est le meilleur moyen de dévier du propos. Je voulais un face à face le plus directe possible avec les criminels. Parce que dans ce cas là, il n’y a plus qu’une possibilité, celle de s’identifier ou de rejeter ou les deux à la fois. Cela contribue à la pièce inconfortable.
GR Y a-t-il un risque particulier pour un auteur dramatique à convoquer une période de l’histoire dès lors qu’elle peut encore rencontrer des témoins ? La confrontation à l’histoire est-elle plus périlleuse lorsqu’elle est récente ?
MD J’avais la préoccupation d’écrire une pièce qui ne choque pas les déportés, les survivants au sens très large, c’est-à-dire toute personne ayant survécu à la volonté politique d’extermination des nazis.
GR Cela vous donne une responsabilité particulière en tant qu’auteur ?
MD Tout à fait, j’ai mis cinq ans à écrire cette pièce, entre le moment où j’ai entendu l’information et celui où j’ai terminé de l’écrire et puis je me suis fait une liste de choses à ne pas faire. J’ai tenu à ne pas représenter la violence des criminels ni la souffrance des victimes parce que cela risquait ou de produire un effet de soupape soulageant ou de placer le public en situation de voyeurisme et de jouissance perverse. Il s’agit uniquement pour moi de mettre les spectateurs en face d’un processus, de personnes qui se criminalisent allègrement, progressivement, tranquillement et qui commencent à prendre conscience de leurs crimes au moment même où elles se sentent menacées. C’est un peu inconfortable, forcément ! Le but n’est pas de choquer, mais c’est peut-être en rendant les choses inconfortables, que « quelque chose » pourra peut-être avoir lieu. Je cède les droits aux metteurs en scène en demandant le respect absolu de deux choses : Qu’au moment des saluts, ne figurent sur scène aucun emblème, uniforme, effigie, portraits de dignitaires nazis, et que dans le spectacle, le viol sur lequel se termine une des scènes ne soit pas représenté.
GR Paul Golub, en tant que metteur en scène racontez-nous le cheminement qui vous a conduit à monter Un siècle d’industrie.
Paul Golub (PG) Je connais l’écriture de Marc Dugowson depuis 10 ans à peu près. A la lecture de Un siècle d’industrie, j’ai été frappé par le sujet et par la manière dont Marc le traite. La manière d’utiliser la langue, de construire les scènes et les personnages, de parler du monde ; de suggérer les situations tout en n’étant jamais explicatif. Il y a une rareté dans cette pièce puisqu’elle parvient, à travers des situations historiques, à nous impliquer dans le monde qui nous entoure aujourd’hui. Ce n’est pas une pièce qui parle seulement d’un fait dans le passé, même si la démarche pourrait être louable. La pièce parle d’un processus potentiel qui existe autour de nous et qui peut se déclencher à tout moment.
GR Est-ce que le fait que la pièce soit autour de ce sujet-là induit une émotion particulière ?
PG Absolument. Je fais de la mise en scène depuis 15 ans maintenant et chaque projeta un sens personnel et particulier pour moi. Ce qui m’intéresse le plus c’est quand je suis face au texte d’un auteur contemporain qui parle du monde qui nous entoure et qui essaie d’aborder quelque chose du présent avec force et originalité. Donc c’est vrai que l’excitation est liée à la manière dont je peux aborder ce sujet-là, un sujet potentiellement difficile, pour toucher le plus grand public possible.
GR En fait ce qui vous intéresse, c’est le présent.
PG Oui. Comme le disait Marc Dugowson, l’écriture est concrète, informative et non didactique. Il est important pour moi -par le biais des comédiens, de la scénographie, des costumes, du son, de tous les éléments de la mise en scène en somme- d’essayer de fournir des outils de compréhension, de poser des questions sur les comportements dans l’entreprise entendue comme une communauté d’êtres humains pas si différents en fin de compte de vous ou de moi. C’est à partir de ces comportements-là que peuvent naître des situations potentiellement toxiques. Ou pas. Mais mon travail est de rendre les situations concrètes et d’ancrer les personnages dans leur humanité, c’est-à-dire dans l’expression d’un véritable choix, d’une véritable responsabilité et pas d’en faire des caricatures.
GR Philippe Marioge, que peut-on montrer sur scène ?
Philippe Marioge (PM) D’abord, j’ai été impressionné, à la fois par le récit, mais aussi par la forme de l’écriture. Quelques mots suffisent à signifier les problèmes d’argent, la faillite, le chômage. L’expression est précise, tranchante. Ce qui m’a frappé également, c’est que rien ne nous est donné à voir de l’usine elle-même, du bureau. A aucun moment n’est évoquée une couleur de mur, une matière de sol, une lumière. Rien ne nous est donné à voir. Je pense que c’est très important de rester dans cette abstraction-là, de façon à pouvoir encore mieux s’identifier et encore mieux pouvoir dire : « ces gens-là sont comme nous, après tout ».
GR Ce qui vous semble important, c’est l’identification avec l’humanité aujourd’hui.
PM Sans doute. Progressivement nous avons senti que le lieu n’avait pas d’existence, pas d’influence sur le mécanisme et donc il n’y avait pas de décor entre guillemets à mettre autour de cela. Ce sont des corps qui vivent des événements par petites séquences très courtes. Les fonctionnements des personnages sont indépendants de l’environnement architectural.
GR Aucune spécification du contexte allemand ?
PG Les costumes si.
PM Nous nous sommes vraiment posé la question du contexte historique. Est-ce qu’il faut le suggérer, le donner à voir ? Pour ma part, il m’a semblé important de montrer qu’il y avait la vie ordinaire qui se déroulait devant nos yeux, et derrière, en même temps, un génocide en train de se fabriquer, ce dont nous ne prenons conscience qu’à la fin de la pièce. Nous avons donc scindé en deux l’espace scénique. Le camp d’Auschwitz est signifié en fond et nous le faisons apparaître par transparence à travers le mur de l’entreprise, (un rideau). Ce fond par transparence nous montre que cette fumée abstraite que l’on a vue depuis le début finalement, c’est la réalité monstrueusement concrète d’Auschwitz. La vie quotidienne, l’insouciance sont devant et en même temps, de façon parallèle, le crime se construit.
GR Est-ce que le théâtre est un endroit favorable à ce genre de questionnement, ou est-ce que c’est un endroit parmi d’autres, parce qu’il faut les occuper tous ? La fiction pose-t-elle un problème particulier ?
MD J’ai changé le nom de l’entreprise et de ses, salariés. La pièce n’est pas un documentaire mais un spectacle de théâtre. Je ne dis pas que cela ne m’a pas posé des questions.
GR Comment relier cette problématique inconfortable avec la notion de spectacle ?
PG Dès lors qu’il est question d’un spectacle, d’une représentation théâtrale, il est question de plaisir. Comment va-t-on raconter cette histoire ? Quelle sera la place du jeu ? Qui seront les comédiens et comment interprèteront-ils leur rôle ? La résolution de ces problèmes n’est pas obligatoirement simple, mais elle est potentiellement jouissive, génératrice de plaisir à l’intérieur de l’équipe. Ce plaisir communicatif entraîne à son tour le public vers la découverte, le questionnement, l’identification émotionnelle. Ainsi, le spectateur sera amené à se poser des questions sur l’histoire racontée et à la rendre sienne. Il n’est pas question en tous cas d’imposer une notion de « devoir de mémoire », mais d’associer les spectateurs à une réflexion sur eux-mêmes par rapport au monde dans lequel ils vivent. La compréhension d’une pièce n’est pas seulement intellectuelle, analytique. Elle passe par les émotions, les rires, les corps en mouvement des comédiens. Un regard sur la société, une réflexion, n’empêchent en aucun cas le plaisir de la représentation, si la pièce est bien écrite, avec de vrais personnages, de vraies situations dramatiques qui nous interpellent, nous interrogent, nous font potentiellement rire ou pleurer, sans lourdeur et sans emphase, comme c’est le cas avec Un siècle d’industrie.
Haut de page
« Cette pièce très forte, et superbement écrite, bénéficie d’une excellente mise en scène de Paul Golub (…) Les scènes courtes et multiples s’enchaînent sans aucun répit. Cette intensité dramatique traduite par une brillante équipe - très homogène - d’acteurs exerce une effet de fascination sur le public, pour le moins bouleversé, ému, au terme de la représentation. Cette création majeure mérite d’être vue par le plus grand nombre, toutes générations confondues. » Jacques Morlaud, L’Echo de la Haute Vienne, samedi 14 janvier 2006
"Stéphanie Pasquet, Xavier-Valéry Gauthier, Jean-Yves Duparc et Brontis Jodorowski tiennent ave intensité, comme suspendus au-dessus d'un gouffre, les rôles principaux de ce spectacle d'une admirable lumière noire." G.C., Les Echos, 19 janvier 2006
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - L'Azimut - Théâtre F. Gémier / P. Devedjian
L'Azimut - Théâtre F. Gémier / P. Devedjian
13, rue Maurice Labrousse 92160 Antony
- RER : Antony à 191 m
- Bus : Théâtre - Mairie à 103 m, Gare d'Antony à 157 m, Antony RER à 215 m, Marché à 372 m
-
Voiture : par la N20. Après la Croix de Berny suivre Antony centre puis le fléchage.
15 min de la porte d’Orléans.
Stationnement possible au parking Maurice Labrousse (gratuit à partir 18h30 et les dimanches), au parking du Marché (gratuit pendant 3h après validation du ticket de parking à la caisse du théâtre) et au parking de l’Hôtel de ville (gratuit pendant 1h15).
Plan d’accès - L'Azimut - Théâtre F. Gémier / P. Devedjian
13, rue Maurice Labrousse 92160 Antony