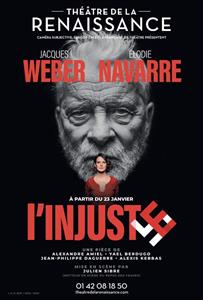Une sorte d'Alaska
Une sorte d'Alaska
- De : Harold Pinter
- Mise en scène : Ulysse di Grégorio
- Avec : Dorothée Deblaton, Marinelly Vaslon, Yves Penay
Une sorte d'Alaska - Photographies
- Un réveil brutal
Déborah, plongée dans un coma qui a duré plus de treize années, se réveille d’une manière brutale grâce à une injection et découvre tout un monde dont elle ne fait plus partie et dans lequel elle peine à peindre les décors...
- La presse
« Un condensé de délicatesse. » Marianne.fr
- Note d'intention
La mort de Pinter a été pour moi l’occasion de redécouvrir son oeuvre, de me plonger dans ses écrits et films. J’avais d’abord travaillé le rôle d’Edward dans Une petite douleur, dans le cadre de ma formation théâtrale, avant d’interpréter celui de Duff dans Paysage à l‘Aktéon en 2011. Pour cette troisième mise en scène (après Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès au théâtre 13 et Voix du sang d'Harold Pinter au théâtre de Ménilmontant), ce qui m’a principalement séduit, c’est l’évocation de ce réveil, après une longue période de sommeil. Comment retrouver sa place au sein d'un monde que l'on ne possède plus ?
Le temps est au centre de ce texte. En particulier sa relativité, directement liée à la perception de la réalité qu’en ont les personnages. Les fractures temporelles font écho aux fractures relationnelles entre les êtres… L’action a beau se dérouler dans une seule unité de temps, la perception qu’en a le personnage principal (Deborah) est faussée.
Le rapport d’âge est également au coeur de ces pièces. Le sommeil soustrait à la conscience du vieillissement et brise les liens familiaux : amour pour une jeune femme qui annihile toute autre réalité, complexité de recréer des liens brisés par l’absence, etc.
C’est cet aspect de confrontation à la jeunesse insouciante, oublieuse du temps et créatrice de réalités nouvelles que ce spectacle voudra mettre en lumière. Quand on aime, quand on dort, quand on est mort, dans quelle autre réalité temporelle est-on ? Dédouané, libéré des inquiétudes, des devoirs, des échéances ?
Fuit-on alors la réalité ou s’échappe-t-on de la prison d’une temporalité finalement suggestive ? Telles sont les questions que cette pièce soulève en chacun de nous…
Ulysse Di Gregorio
- Note de mise en scène
La mise en scène que je propose sur Une sorte d'Alaska est volontairement minimaliste, afin de mettre en avant les tempêtes intérieures. L’attention doit être focalisée sur les rapports entre les personnages et non pas détournée par des effets stylistiques.
Je demande la plus grande rigueur en terme de diction. Un texte comme celui de Pinter est totalement inexistant sans une diction parfaite. Chaque mot a une résonance particulière et le sous-estimer serait faire grand tort à son auteur.
En terme de direction d’acteur, j’ai pris le parti d’un jeu très épuré. Toute fioriture, toute mimique, tout superflu ne ferait que diminuer le rapport complexe de ces personnages et les situations d’une extrême intensité dramatique. Les déplacements sont ainsi réduits au minimum, tant chaque pas, chaque souffle, doit être parfaitement maîtrisé, et d’une puissance et sensibilité émotionnelles aiguës.
Les grands sentiments se jouent dans la plus grande concentration, il n’y a donc pas de ballade ni de mouvement anecdotique.
Toujours dans cette optique de minimalisme, le décor est réduit à l’essentiel : une table, quelques chaises, un lit.
Extraits
Deborah : Alors, pendant combien de temps j’ai dormi ?
Hornby : Vous avez dormi pendant vingt-neuf ans.
Deborah : Vous voulez dire que je suis morte ?
Hornby : Non
Deborah : Je ne me sens pas du tout morte.
Deborah : Alors vous dites que vous êtes ma soeur ?
Pauline : Mais oui.
Deborah : Eh bien vous avez changé. Beaucoup. Vous avez pris un nombre d’années...substantiel. Qu’est-ce qu’il vous est arrivé ?
Hornby : Quel âge avez-vous ?
Deborah : J’ai douze ans. Non. J’ai seize ans. J’ai sept ans. Je ne sais pas. Si. Je sais. J’ai quatorze ans. J’ai quinze ans. Mes jolis quinze ans.
Hornby : Je vous ai réveillée grâce à une injection.
Deborah : Adorable injection. Oh, comme je l’adore. Et est-ce que je suis belle ?
Hornby : Très belle.
Deborah : Et vous êtes mon prince charmant. N’est-ce pas ?
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Déchargeurs
Déchargeurs
3, rue des Déchargeurs 75001 Paris
- Métro : Châtelet à 29 m
- RER : Châtelet les Halles à 242 m
- Bus : Rivoli - Châtelet à 94 m, Rivoli - Pont Neuf à 96 m, Châtelet à 180 m, Pont Neuf - Quai du Louvre à 265 m, Châtelet - Quai de Gesvres à 335 m, Châtelet / Coutellerie à 399 m
Plan d’accès - Déchargeurs
3, rue des Déchargeurs 75001 Paris