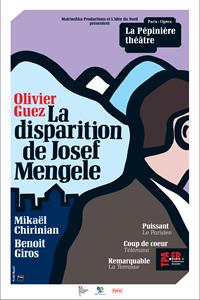Je danse toujours
Je danse toujours
Coup de cœur CONTEMPORAIN Le 1er octobre 2013
- De : Timothée de Fombelle
- Mise en scène : Etienne Guichard
- Avec : Clémence Poésy
- Ecrire une vie qu'on n'aura pas
Une jeune femme tape à la machine. Elle semble écrire les souvenirs d'une autre femme, beaucoup plus âgée, qui raconte une vie entière. Cette vie enjambe la guerre, elle se déroule avant et après les combats, elle englobe une histoire d'amour, des joies, des larmes, l'intensité des jours. Mais, lentement, on comprend la réalité de ce qui se joue devant nous. C'est l'hiver 1942.
La jeune femme qui écrit se sait condamnée parce que l'homme qu'elle attend n'est pas venu lui dicter les journaux clandestins qu'elle doit taper à la machine.
S'il n'est pas là, c'est qu'il a été arrêté et qu'elle doit fuir. Mais, parce qu'elle l'aime en secret, elle décide de rester et d'écrire la vie qu'elle n'aura pas. Elle va faire exister cette femme tout près d'elle. Cette femme qu'elle ne sera peut-être jamais.
- Note d'auteur
En écrivant Je danse toujours j’ai voulu mêler la densité d’un polar poétique à une plongée dans les beautés et les fragilités de la vie. La théâtralité de la pièce repose sur un compte à rebours, une attente inquiète du dénouement. Mais ce temps suspendu est gonflé de vie, c’est le souffle des souvenirs réels ou rêvés qui le tient en apesanteur. « J’ai des souvenirs d’avance », dit le personnage de Claire. Cette provision de souvenirs échappe à la nostalgie parce qu’elle est inventée au présent, elle est dans la tension, l’impatience du présent. Pour moi le théâtre est cet art du présent et de l’urgence. Quelqu’un peut entrer à tout moment, il est urgent de résister par les mots, de dire ce qu’auraient été des enfants remontant de la plage, les lèvres violettes, de raconter ce que seraient les retrouvailles, les petites blessures qui tiennent en vie, les nuits d’été, la vieillesse…
J’écris pour le théâtre quand les histoires ne pourraient pas être racontées ailleurs que sur une scène, dans l’incarnation d’un corps et d’une voix, par la rencontre avec d’autres artistes. Le début du travail avec Clémence Poésy, et le metteur en scène Étienne Guichard montre que la magie de cette rencontre est possible. Ils ont compris ce que devait être cette pièce, jamais une rêverie vaporeuse autour de la mémoire, mais une histoire d’amour, de guerre, de suspens. Et cette émotion aura pour seules armes une voix et un plateau de théâtre.
Timothée de Fombelle
- Note d'intention
Timothée de Fombelle nous offre un texte court, magnifiquement ciselé. Une bouleversante déclaration d’amour au coeur de la guerre. Il fallait fuir. Claire choisit de rester, de dire, d’aimer. De faire comme si, l’homme qui doit venir la rejoindre sera bien celui qu’elle aime et qu’il viendra la disputer comme un amant qui a eu très peur pour elle. Elle écrit sur la même machine qui lui servait pour transcrire les messages de résistance qu’il lui dictait. Elle confie à cette machine, à ces feuilles de papier, ce qu’elle ne se donnait pas le droit de lui dire dans ce contexte de résistance. Sait-elle exactement ce qu’elle fait ? Il fallait fuir, se sauver. Est-ce un acte de résistance, d’amour, de désespoir ou plutôt d’espoir insensé.
Dans le silence de l’attente, les craquements du parquet, les rumeurs de la rue, les crépitements du poêle, les pas dans l’escalier de l’immeuble et … celui du bruit des frappes sur la machine à écrire.
Ces frappes qui deviennent rythme, musique de la valse lente des jours heureux rêvés. Les mots se posent dessus… Après, après la guerre… Il y a dans l’espace quelques éléments agencés comme un piège. La chaise, la petite table avec le paquet de feuilles, la machine à écrire et surtout la porte derrière elle. Cette porte fermée sur l’espoir d’un effleurement qui l’annoncerait, lui l’homme aimé.
Parfois des déplacements rapides, de la table au poêle, à la porte, à la fenêtre, coupés par des temps de suspensions. Des immobilités de bête à l’affût. Son présent est prisonnier de l’attente. Claire se parle ce présent là pour conjurer la peur insidieuse. Écrire, faire exister ce passé si récent, le début de leur histoire, son glissement dans la résistance, la cruauté des actes, la perte des proches et cette envie de vivre, de vivre simplement.
Quand le crépitement des frappes sur le clavier devient valse lente, elle peut alors se lever, danser comme une très vieille femme fragile et gracieuse qui contemple la vie pleine qu’elle a vécu. Elle vient au plus près du public, regarder comme dans un miroir, la vie qu’elle vient de faire exister. La porte s’ouvrira. On ne verra pas le visage de l’homme ennemi. Se sauver, il fallait se sauver. Dans un cercle de lumière : la machine à écrire. Quelques feuilles couvertes de mots ont glissé sur le plancher. Le bruit des frappes doucement à nouveau comme un coeur qui ne veut pas s’arrêter de battre…
Etienne Guichard
Je danse toujours – Bande-annonce
Sélection d'avis des spectateurs - Je danse toujours
A découvrir Par Helwa - 28 octobre 2013 à 09h48
Un texte somptueux, une mise en scène simple et efficace. Un seul en scène à voir.
Moyenne des avis du public - Je danse toujours
Pour 1 Notes
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
A découvrir Par Helwa (8 avis) - 28 octobre 2013 à 09h48
Un texte somptueux, une mise en scène simple et efficace. Un seul en scène à voir.
Informations pratiques - Pépinière Théâtre
Pépinière Théâtre
7 rue Louis Le Grand 75002 Paris
- Métro : Opéra à 185 m (3/7/8), Pyramides à 342 m (7/14)
- Bus : Petits Champs - Danielle Casanova à 96 m, Opéra - 4 Septembre à 116 m, Opéra - Rue de la Paix à 208 m, Opéra à 256 m, Sainte-Anne - Petits Champs à 313 m
Plan d’accès - Pépinière Théâtre
7 rue Louis Le Grand 75002 Paris