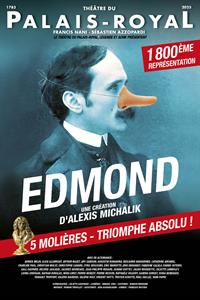La Maison de Bernarda Alba
La Maison de Bernarda Alba
- De : Federico Garcia Lorca
- Mise en scène : Carole Lorang
- Avec : Sylvie Jobert, Bach-Lan Lê-Ba Thi, Rita Bento Dos-Reis, Jérôme Varanfrain, Camille Grandville, Nina Krasnikova, Véronique Nosbaum, Renelde Pierlot, Anne Lévy, Nina Ros
À partir de 15 ans.
- Un drame oppressant
Imagine-t-on la pièce qui se termine par « Silence ! » ? Dans l’Espagne rurale et bientôt franquiste, Federico García Lorca nous mène au coeur d’un drame oppressant, où les pulsions de vie et de mort se croisent et se chevauchent. Bernarda Alba, dont la féminité terrible condamne toutes autour d’elle à l’enfermement, est au coeur de la pièce. Autour d’elle, sa cour, ses ménines, ses prisonnières. Autour d’elles, la Maison, véritable personnage qui grince, joue et amplifie les sons de l’emprisonnement. La musique, c’est la Maison : la Maison sera le décor sonore du drame. Dans le blanc, le noir et le rouge de rigueur, une danse d’amour et de mort.
Traduction et adaptation : Mani Müller
Musique originale composée par Franz Leander Klee et Florian Appel.
- Une histoire de femmes dans un petit village andalou des années 1930
Dans un petit village andalou, vers le milieu des années 1930, Bernarda Alba, une femme d’une soixantaine d’années, crainte et respectée de tous, vient de perdre son mari et se prépare à huit ans de deuil, comme l’exigent la tradition et la bienséance qu’elle suit religieusement. Bernarda est aussi une mère tyrannique qui oblige ses cinq filles célibataires, pourtant adultes, à suivre à la lettre la moindre de ses consignes. Elles aussi portent le deuil et restent chez elles à longueur de journée. Il en va de même de toutes les habitantes de la maison – on n’y compte plus que des femmes depuis le décès de Senior Alba –, alors que la propre mère de la maîtresse, la fantasque Maria Josefa, est mise à l’écart dans une chambre fermée à double tour. Bernarda décide de marier l’aînée de ses filles, Angustias, à un jeune homme du village. Issue d’un premier mariage, celle-ci est aussi riche que laide.
Appâté par sa dot, Pépé le Romano, un bel homme, fier et sûr de lui, demande Angustias en mariage et obtient l’autorisation maternelle de parler à « l’élue », le soir venu, devant la grille de sa fenêtre. Or, Pépé étant l’objet de convoitise de toutes les soeurs Alba, prend l’habitude – une fois qu’il a rendu sa visite quotidienne à Angustias – de rejoindre, à l’abri de la nuit, la plus jeune soeur, la belle et séduisante Adela, qui l’attend dans la cour. Convaincue qu’elle ne doit plus supporter les frustrations que sa mère lui impose, elle est la seule à faire encore naturellement confiance à la vie. Elle n’a pas envie de rester enfermée plus longtemps, mais c’est sans tenir compte de la jalousie de Martirio, une autre de ses soeurs, également amoureuse de Pépé et qui la surveille, avec l’aide d’une servante.
Finalement, Adela ne peut empêcher que le manège de ses rendez-vous nocturnes avec Pépé ne soit découvert et se décide à révéler l’amour impossible au grand jour, devant toute la famille. Bernarda sait qu’en tant qu’autorité, elle doit sortir indemne de cette histoire, si elle veut maintenir son pouvoir. Pour devancer les réactions des villageois et garder la face, elle chasse Pépé le Romano en tirant sur lui à la carabine. Mais Adela, craignant de ne plus jamais revoir son amant, crie à tout le monde qu’elle ne laissera « personne [la] courber », avant de s’enfermer à clé dans une chambre. Elle finit par s’y donner la mort. Face au drame, Bernarda impose le silence à tout le monde.
- Note d’intention
La Maison de Bernarda Alba combine un système des personnages original à un sujet étonnamment contemporain : d’une part, le drame, qui se noue dans un microcosme rural, propose exclusivement des portraits de femmes, d’autre part, le carcan familial représente, de façon emblématique, un monde de plus en plus stérile et inhumain, où s’affrontent différentes stratégies de survie, face au règne sans partage d’une idéologie autoritariste. Pour nous, cette pièce contient des personnages exceptionnels, tantôt attachants, tantôt inquiétants, qui sont des êtres humains pris au piège d’une vie que, pour la plupart, ils n’ont pas choisie, avant d’être des femmes opprimées.
Le texte, non dépourvu d’accents poétiques sobres, est une réponse riche, éminemment concrète et dramatique, à nos interrogations les plus fondamentales sur la liberté individuelle : on y entend le gémissement, le cri de désespoir des unes, prisonnières d’une condition sociale ou d’une tradition qui cache son vrai visage, le rire jaune des autres, anxieuses ou jalouses, incapables d’assumer la responsabilité qu’exigerait d’elles la liberté qu’elles fuient. Il y a Adela, la rebelle qui refuse la double morale, qui affirme ses désirs, sa différence, enfin son besoin de liberté. Sa jeunesse, son tempérament font qu’elle a encore cette envie de croquer la vie à pleine dent, cette confiance simple dans son destin de personne libre. Mais, en face, il y a Martirio, la jalouse, la frustrée. Prise en otage, entre un monde ancien qui la protège, mais exige en retour des sacrifices douloureux, et la perspective d’un monde nouveau plein de promesses, mais aussi d’inconnus, elle n’arrive pas à se décider. Elle ne se retrouve ni dans le conformisme de sa mère ni dans l’audace de sa soeur Adela. Finalement, son indécision fait d’elle un personnage emblématique du drame d’une génération qui, dans sa grande majorité, a laissé faire les tyrans et surtout, comme on dit, les hommes forts. Martirio qui va laisser sa soeur se sacrifier, nous renvoie la même image d’impuissance et de lâcheté que les irresponsables – décrits par Hermann Broch dans le roman prémonitoire du même nom – et dont la passivité, si elle reste un comportement juridiquement non coupable, a pourtant permis les crimes totalitaires. Ensuite, il y a Magdalena, d’un naturel flegmatique et d’un caractère versatile, qui a tendance à s’évader dans la nostalgie. Il y a Olga, un nouveau personnage, une employée de maison polonaise, considérée comme servante par la mère. Les quatre soeurs, surtout Martirio la traite plutôt comme leur petite soeur adoptive. Et finalement, il y a Angustias. Elle s’est tellement bien accommodée des règles du jeu qu’une remise en question n’est plus possible. Opportuniste, elle s’est fondue dans le moule, et sa mère, quand elle la choisit pour épouser Pépé, récompense aussi cette loyauté qui, à un certain niveau, relève de la collaboration. Parfaitement à l’aise avec les codes sociaux et les coutumes locales, elle est devenue la première bénéficiaire du système qui l’a produite. Ce personnage sera incarné par un homme, afin de souligner à quel point l’être humain est capable de faire abstraction de sa véritable nature et d’assumer, dans cet oubli de soi, une fonction qui, au fond, ne lui était pas destinée. Même en jouant à la perfection le personnage féminin, le comédien masculin introduira le décalage subtil qui nous intéresse. En se déchirant tout au long de la pièce, la fratrie montre comment le pouvoir tyrannique conduit les personnes dépendantes qui lui sont soumises et qu’il a, en quelque sorte, éduquées à l’impuissance, à raisonner uniquement en termes égoïstes, toutes les fois qu’elles se sentent menacées. En refusant de reconnaître l’origine de leur souffrance, les soeurs renforcent le pouvoir pervers qui est censé les « protéger ».
À nos yeux La Maison de Bernarda Alba n’est pas seulement un drame rural ou un mélodrame familial, mais plutôt un drame emblématique – une allégorie, si l’on veut – où García Lorca fait résonner, avec un savoir-faire unique, le grondement menaçant du monde extérieur : les voix des mâles, physiquement absents de scène, les cris d’une jeune mère infanticide, les cloches de l’Église toute-puissante... Pour échapper à l’anecdotique et transformer la maison d’une famille de la campagne andalouse en un microcosme reflétant un rapport à la société et au monde dans son ensemble, l’auteur a créé des personnages tout aussi remarquables que les soeurs et la mère Alba. Il s’agit de la grand-mère, « vieille folle » séquestrée par ses propres enfants, un personnage de l’entre-deux, puisqu’elle ne fait partie entièrement ni de la famille, où elle dérange trop, ni du monde extérieur qui, chez elle, n’est plus qu’imaginaire. La « vieille folle » exprime son désir de liberté sous une forme métaphorique dans des scènes d’un onirisme marqué, qui contraste avec le franc-parler et le réalisme de la Poncia, elle-même tournée vers l’avenir et le monde extérieur qui évolue, tandis que, dans la maison des Alba, le temps semble s’être arrêté. Dès la première scène de l’Acte I, la Poncia encourage la servante à se servir dans les plats préparés pour les invités de l’enterrement du père Alba : il faut nourrir les enfants de la servante qui ont faim. Cette remarque de simple bon sens est tout un programme de politique sociale, car la Poncia sera, dans les limites du silence qui lui est imposé régulièrement par Bernarda, la porte-parole des besoins réels et élémentaires de chacun, au mépris de toute idéologie, de toute tradition, de tout privilège supposé. Elle a le même âge que Bernarda, sa patronne, mais contrairement à elle, la Poncia incarne l’alternative progressiste, l’avenir des droits de l’homme, face aux droits du sol, de l’héritage ou de la famille, face à un immobilisme qui s’est avéré destructeur.
- A propos
Écrite en 1936, l’année où éclate la Guerre civile espagnole, La Maison de Bernarda Alba, la pièce qui se termine sur « Silence ! » – le cri terrible d’une mère tyrannique –, est un texte prémonitoire à bien des égards, ne serait-ce que parce qu’il restera comme la dernière oeuvre dramatique du poète andalou, jeté en prison et exécuté par les franquistes à Grenade quelques mois plus tard. Faisant partie de « la trilogie rurale », avec Noces de sang (1932) et Yerma (1934), cette pièce, inspirée d’événements vécus par l’auteur dans sa jeunesse, propose une thématique – la mère abusive, la privation de liberté, la double morale, le lynchage et la révolte – qui dépasse largement le cadre du mélodrame familial ou du drame rural, parce qu’elle est directement liée au destin contemporain d’un peuple tout entier.
Jouée pour la première fois en 1945 au Teatro Avenida de Buenos Aires, elle a été longtemps exclue des oeuvres complètes de García Lorca et ne fut montée en Espagne qu’en mars 1950, au Teatro de Ensayo La Catátula à Madrid, dans une version censurée. Elle est aujourd’hui une de ses pièces les plus jouées à travers le monde, alors que le théâtre de Lorca, faisait remarquer son traducteur André Belamich il y a vingt ans déjà, connaît en France, et plus particulièrement à Paris, une étrange éclipse. Il serait temps de réparer cette injustice.
Carole Lorang et Mani Muller
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Théâtre Suresnes - Jean Vilar
Théâtre Suresnes - Jean Vilar
16, place Stalingrad 92150 Suresnes
- Tram : Suresnes Longchamp à 2 km (T2)
- Bus : Stalingrad à 18 m, Place de Stalingrad à 82 m, Stresemann à 191 m, Place de la Paix à 331 m, Les Mazurieres à 387 m
- Transilien : Suresnes Mont Valérien à 2 km (L/U)
-
Navette gratuite Paris - Suresnes : Une navette est mise à votre disposition (dans la limite des places disponibles) pour vous rendre aux représentations du Théâtre.
Départ de cette navette 1h précise avant l’heure de la représentation (ex. : départ à 19h30 pour une représentation à 20h30), avenue Hoche (entre la rue de Tilsitt et la place Charles de Gaulle-Étoile), du côté des numéros pairs. À proximité de la gare Suresnes-Longchamp (Tram 2), la navette peut marquer un arrêt sur le boulevard Henri-Sellier (à l’arrêt des bus 144 et 244 (direction Rueil-Malmaison), 25 minutes environ avant la représentation. Faites signe au chauffeur.
La navette repart pour Paris environ 10 minutes après la fin de la représentation, et dessert, à la demande, l’arrêt Suresnes-Longchamp, jusqu’à son terminus place Charles de Gaulle-Étoile.
Plan d’accès - Théâtre Suresnes - Jean Vilar
16, place Stalingrad 92150 Suresnes