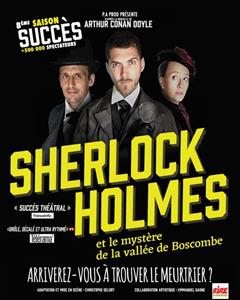La nuit de l'enfant caillou
La nuit de l'enfant caillou
- De : Caroline Marcadé, Michel Vittoz
- Mise en scène : Caroline Marcadé
- Avec : May Bouhada, Julie Denisse, Nicolas Martel, Sophie Mayer, Nathalie Nell, Eric Rulliat
La Nuit de l’enfant caillou est un conte. Comme la plupart des contes, il commence par " il était une fois… " .
Donc, il était une fois une mère et ses trois enfants. Ils vivaient dans une petite maison à l’écart d’une grande ville.
Une nuit, le frère aîné rêve qu’il frappe sa jeune sœur parce que, du moins le croit-il, elle ne veut pas cesser d’être une enfant. Il la frappe comme dieu frappe les hommes dans sa colère. Maintenant, il tient une hache dans sa main, la hache va s’abattre, il va la tuer.
La scène pourrait s’appeler : " on tue un enfant " . Mais le rêve s’arrête là. La hache reste en l’air, le meurtre reste en suspens.
Et c’est le jour.
La petite sœur gémit, elle se traîne sur le sol comme un animal blessé. Elle a le visage en sang. On ne sait pas, elle, ce qu’elle a pu rêver cette nuit-là mais elle en porte une trace douloureuse.
La douleur, en plein jour, d’un enfant qui ne veut pas mourir.
La douleur d’un enfant est pour une mère comme un coup de hache en plein cœur, une douleur qu’elle connaît. C’est la sienne et elle la porte depuis longtemps.
Alors la mère explique ou, plutôt, raisonne sa douleur, son corps plié, soumis aux exigences de la vie parce que c’est comme ça, parce qu’on ne peut pas vivre autrement. Parce que, pour grandir, il faut un jour ou l’autre tuer l’enfance qu’on porte en soi.
Et c’est déjà le soir.
Le fils cadet rentre de la ville. D’habitude il se débrouille toujours pour trouver à manger. Ce soir-là il revient les mains vides. Ce qu’il a vu ressemble à un cauchemar. Dans les rues, les gens s’entre-tuent, se coupent en morceaux comme on coupe le bois avec une hache, comme si c’était un travail, une nécessité.
Et c’est de nouveau la nuit.
Une nuit imaginaire où la mère retrouve son enfance vieillie, celle qu’elle croyait avoir tuée. Une nuit où les enfants grandissent et ne meurent que de façon transitoire. Une nuit qui dure au moins quatre saisons, le temps de tous les passages. Le temps peut-être d’imaginer des jours nouveaux.
Michel Vittoz
Peut-être suis-je mort sur le ventre de ma mère en naissant ? Les nouveau-nés arrivent du néant, ils sont des petits vieillards ensanglantés. L’air déplie sauvagement leurs poumons. Ils poussent leur premier cri, ils l’entendent et ils apprennent à cet instant qu’ils sont condamnés à mort. Le monde et la vie sont leur chambre d’exécution. Nous sommes tous des nouveau-nés en train de mourir. Une main de géant nous prend, nous accueille, nous dépose sur un sein. La main tremble, elle est hésitante mais son tremblement même suffit à nous rassurer. La main fait avec nous ce qui est juste. La main d’une mère est comme la main de Dieu. On appelle ça de l’amour : ce serait cela la vie. C’est peut-être autre chose. L’amour nous fait croire à la vie. C’est la première histoire que notre corps nous raconte. Nous allons vers la mort et une histoire d’amour nous raconte que nous allons vers la vie, nous aimons cette histoire et nous croyons aimer la vie.
Le mouvement de la main est juste, l’amour est juste et nécessaire, mais l’histoire est fausse. Quand nous nous en apercevons, il est trop tard : nous sommes déjà devenus des assassins.
Michel Vittoz
Ca bouge tout le temps sous mes pieds. La terre probablement. Comme je ne peux pas rester en place, je bouge. Tout le monde fait comme moi. Tout le monde bouge sur la terre. Tout le monde a le mal de terre. J’ai décidé de m’allonger une bonne fois pour toutes, j’entends mieux à plat. Les histoires qu’on vit, on ne s’en relève pas. Elles nous collent à la peau. Chacun a son corps collé à sa peau. On ne va pas en faire toute une histoire. Sauf au théâtre. Les acteurs le savent, ils sont toujours prêts à décoller. Allongés les yeux au ciel, je les ai vus voler.
Caroline Marcadet
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - La Colline (Théâtre National)
La Colline (Théâtre National)
15, rue Malte Brun 75020 Paris
- Métro : Gambetta à 73 m
- Bus : Gambetta - Pyrénées à 53 m, Gambetta à 57 m, Gambetta - Cher à 144 m, Gambetta - Mairie du 20e à 150 m
-
Station de taxis : Gambetta
Stations vélib : Gambetta-Père Lachaise n°20024 ou Mairie du 20e n°20106 ou Sorbier-Gasnier
Guy n°20010
Plan d’accès - La Colline (Théâtre National)
15, rue Malte Brun 75020 Paris