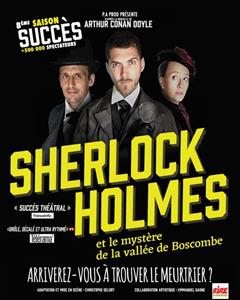Le bout de la route
Le bout de la route
- De : Jean Giono
- Mise en scène : François Rancillac
- Avec : Eric Challier, Charlotte Duran, Jean-Pierre Laurent, Tommy Luminet, Tiphaine Rabaud-Fournier, Anita Plessner, Emmanuèle Stochl
Du regain au retrait...
Un espace « outre-noir »
Extrait
Première pièce de Giono (1931), qui en écrira bien d’autres (Lanceurs de graine, La Femme du boulanger, Le Voyage en calèche, Domitien, Joseph à Dothan, Le Cheval fou,…), Le Bout de la route est sans doute aussi la plus belle. Simple comme une tragédie grecque, ample comme un roman, elle déploie une langue incroyable, à la fois concrète, charnue et lyrique, goûtant à pleine bouche l’humus et l’air vif des montagnes, sans pittoresque aucun, avec des mots qu’on dirait trouvés le long du sentier comme des trésors d’humanité, gros des rires et des larmes de toute vie d’homme et de femme, de la naissance à la mort.
Nombre de romans de Giono d’avant-guerre, contemporains du Bout de la route (1931), racontent une re-naissance. Que ce soit un village abandonné qui se repeuple grâce à la rencontre d’un paysan et d’une « fille de rien » (Regain), une famille desséchée par la honte qui reprend vie grâce à l’amour fou d’un ouvrier agricole pour la « fille perdue » de la maison (Un de Baumugnes), ou tout un plateau provençal désertifié peu à peu réinvesti par la nature, les cultures, les animaux et les oiseaux grâce à l’enthousiasme d’un poète acrobate (Que ma joie demeure), etc. - Chaque fois il s’agit d’une victoire de la vie sur la mort : L’eau re-circule dans les veines de la terre, le désir irrigue à nouveau les corps, et c’est un recommencement.
Il en est d’abord ainsi dans Le Bout de la route : la ferme, où Jean atterrit un soir, au hasard de sa marche, est comme tétanisée par le deuil. Le maître de la maison a brutalement péri, il y a quelques années, et tout récemment sa petite soeur, fracassée par une roche dévalant la montagne. Depuis, la Grand’mère s’est cloîtrée dans une chambre, geignant nuit et jour sa douleur comme une folle. Depuis, la maîtresse de maison, Rosine « la Sauvage », s’est enfermée derrière un masque d’autorité et de dureté pour supporter la charge de toute la maisonnée. Tout autour de la ferme, c’est la nuit (quasi omniprésente dans la pièce), une nuit froide, cristallisée d’étoiles et de silence…
La seule petite herbe malingre, qui réussit à pousser bon gré mal gré dans ce monde minéralisé par la mort, est l’amour encore informulé de Mina (la cadette) et du jeune forestier, Albert, qui descend chaque mardi de ses hauteurs pour partager un moment avec la jeune fille, jusqu’à ce que Rosine le mette dehors.
C’est alors que débarque cet étrange étranger qu’est Jean, à la voix douce, au sourire triste, à la poigne solide et au verbe haut. Avec lui, c’est une bouffée d’air et de lumière qui rentre dans la salle « voûtée et noire ». Sa bonté profonde, sa franchise inébranlable, son absence totale de peur, son regard pénétrant vont déstabiliser les habitants de la ferme, les obliger à parler, à se reparler, à secouer la cendre qui étouffait les langues et les coeurs. Ce « raconteur d’histoires » (est-ce un hasard s’il porte le prénom même de l’écrivain ?), ce nouvel Orphée fuyant son Eurydice, sait, par son art de la parole, frayer de nouveaux passages aux puissances du désir dans les terres les plus arides, les coeurs les plus desséchés. Alors c’est Albert qui ose enfin déclarer son amour à Mina. Alors c’est Rosine qui accepte contre toute attente de recevoir l’étranger, et s’autorise à nouveau l’humour et la tendresse. Et c’est la Grand’mère qui se glisse hors de sa chambre pour parler avec Jean. Et c’est Jean lui-même, blessé à mort par la trahison de sa femme, qui redevient comme un enfant en buvant le verre de lait offert par Albert, Jean qui baptise son hôte « maman Rosine », et qui est comme ré-accouché par la Grand’mère, au coeur de la nuit, en réussissant enfin à pleurer toutes les larmes retenues depuis des jours et des jours de marche aveuglée…
Ce « regain », provoqué par l’arrivée de Jean, ramène le soleil dans la pièce de Giono (tout le deuxième acte se passe durant une chaude après-midi d’automne éblouie de lumière et de verdure) et semble même contaminer tout le village (incarné par le vieux garde-champêtre Barnabé et la jeune Mariette), lui aussi « réveillé » par la bonté et le franc-parler de cet homme singulier, qui passe ses journées à travailler pour les autres, à aider. Pendant que le pain cuit dans le four banal, les filles et les garçons dansent au pied du chêne la fête de la vie…
Si ce n’est que Jean n’est pas de la partie… comme il semble ne pas voir tous les signes, les appels que lui fait Mina, tombée folle amoureuse de lui… Car, cet homme qui réveille autour de lui les corps, les coeurs et les langues, semble s’être lui-même absenté du monde des vivants… En fait, si Jean ne peut recevoir l’amour de la jeune fille, c’est qu’il est lui-même secrètement amoureux, mais… d’un fantôme !
Le texte est publié aux Éditions Folio/Gallimard.
La scénographie de Jacques Mollon
D’emblée, avec Jacques Mollon, nous nous retrouvons sur un constat : pour que puisse vibrer la pièce de Giono, il faut absolument épargner au spectateur tout naturalisme redondant, toute reconstitution sur scène d’une ferme alpine ! Ils font donc le pari d’une scénographie aussi dépouillée que possible, d’un espace plutôt « mental » où les différents lieux seront plus suggérés que représentés.
Puis, au fil de leurs échanges, des axes forts apparaissent : Jean débarque dans une maison tétanisée, fossilisée par le deuil. Ici, la vitalité de la nature, si chère à Giono, n’a plus sa place : on est du côté du minéral, du charbon, de la mort. Très vite est évoquée l’oeuvre de Pierre Soulages et son obsession de « l’outre-noir » : Ses tableaux recouverts d’une pâte épaisse et pétrolifère sont comme peignés, striés, donnant à son noir uniforme une dynamique et une profondeur incroyables, apportées par la lumière qui vient caresser les sillons tracés sur la toile. Et selon chaque état de lumière, selon chaque point de vue, surgit un nouveau tableau… De là à rêver un espace théâtral d’un noir absolu qui évoluerait selon la lumière qui le révèle, il n’y a qu’un pas, vite franchi (avec la complicité de Cyrille Chabert, qui créera les lumières du spectacle) ! Les corps des acteurs, les quelques objets incontournables flotteront dans cet espace nocturne, devenus étranges à leur tour…
Jean lui-même est dans la nuit : trahi par la femme de sa vie, il s’est engouffré dans la forêt pour y mourir… Avant de s’accorder un hypothétique sursis dans cette ferme de Tréminis. Cette famille est donc un refuge où il va tenter de survivre un temps, de se reconstituer un peu. À l’abri de ces murs, il va d’abord s’abrutir de travail pour ne plus avoir à penser. Derrière le masque de la bonté, il va se protéger des autres, se caparaçonner contre leur envahissement affectif. La scénographie doit suggérer ce repli sur soi, cette protection si nécessaire à Jean, alors que les autres lui font signe du dehors, l’invitant à sortir, à les rencontrer… Mais jamais Jean ne franchira le seuil de sa porte, de sa peau. Tout est donc question de fermeture et d’ouvertures possibles, de limites et de seuils à franchir : Jacques Mollon imagine ainsi une immense paroi de la même matière et couleur « soulagienne » que le sol, qui pourra clôturer sinon boucher l’espace de jeu, mais qui pourra aussi s’entrouvrir, se séparer, pour laisser des fentes, des portes apparaître, pour offrir à Jean des lignes de fuite et de sortie possibles (c’est alors l’apparition derrière le noir de lumières vives, de couleurs intenses – avec cette fois Le Corbusier pour référence).
Au fur et à mesure du spectacle, la paroi va donc bouger, se reconfigurer, ouvrir de nouvelles perspectives, jusqu’à se recomposer à l’acte III, quand on revient dans la salle de ferme du début de la pièce. Mais cette fois, le mur sera très à l’avant-scène, rendant l’espace presque asphyxiant, de même qu’étouffe cette famille où les désirs et les espoirs réveillés par Jean ne trouvent définitivement aucune échappatoire…
François Rancillac
Rosine : Qu’est-ce que c’est que cette chanson-là ?
Jean : C’est la chanson d’un homme seul. Il n’est pas seul celui qui peut toucher une bête ou un arbre, ou s’approcher avec ses yeux du brouillard bleu ou du soleil. Il n’est pas seul celui qui a goût au jour. Celui qui a un nez, une bouche, des yeux, des oreilles, une bonne chair d’animal. Tout lui tient compagnie. Il y a de grosses joies qui passent dans l’air du temps comme des poissons enflammés. Je n’ai plus rien.
Rosine : Regarde-moi un peu, toi. Qu’est-ce que c’est que ton goût de bouche ?
Jean : Cendres, maintenant.
Rosine : J’entends assez. Mais avant ?
Jean : Avant ? Une soupe de vie.
Rosine : Alors, le changement, ça vient de quoi ? Tu as fait comment pour tout perdre ?
Jean : J’ai tout donné à une femme. (À un mouvement de Rosine.) Attendez. Je veux tout de suite vous dire, et ça doit se voir que ça n’est pas une chose à la jeunotte, et je te regarde, et je te souris, et je te lèche, et je te lèche. On n’a pas fait de la confiture de framboises avec elle. On a mangé la soupe de vie en plein, à grosses gueulées solides, saines, on l’avalait pas triturée, pas écrasée, les pommes de terre, les choux, les carottes, tout ça entier. On sentait son bonheur de vivre qui grondait là-dedans comme un feu de chaudières. Je lui ai tout donné, sans savoir, mais en plein. Autour de moi, maintenant, c’est sans couleur, sans goût, sans rien.
Rosine : Parce que…
Jean : Elle en aime un autre.
Rosine : De son point de vue à elle ça se défend.
Jean : C’est ça le terrible.
(Acte I, scène II)
" En prenant le parti de la sobriété, le metteur en scène François Rancillac a tout misé sur les acteurs (féroce Emmanuèle Stochl !). Il a eu raison. On sort ébloui par cette prose qui se tord comme le corps des vieux ou exulte avec légèreté pour chanter le désir. " Emmanuelle Bouchez, Télérama
" Rancillac et ses comédiens se gardent de tout naturalisme déplacé (nulle trace d’accent paysan ou de décor de ferme). Ils jouent les situations plutôt que les sentiments, (…). Ils se laissent happer par une langue aussi concrete qu’inattendue ( pas une phrase de Giono don’t on ne puisse deviner comment ellle va finir). Et ils parviennent à transmettre aux spectateurs un état de surprise : une joie qui demeure. " René Solis, Libération
" La langue est drue, viandeuse à point, chargée des saveurs et des senteurs natales de la région de Manosque. Giono invente un lyrisme virgilien propre à toucher au coeur en toute simplicité. " Jean-Pierre Léonardini, L’Humanité
" La lumière, la musique, les comédiens ammenés par Eric Challier, tout concourt à faire de ce spectacle un moment rare et presque une confidence. Giono serait heureux. " Laurence Liban, L’Express
" Une très belle mise en scène, affûtée, précise et sensible qui restitue au plus juste la langue de Giono, et l’âpre affrontement entre désir de vivre et absolu renoncement. " Agnès Santi, La Terrasse
" Parce qu’il s’appuie sur la scénographie de Jacques Mollon, épurée, superbe, le metteur en scène laisse tout simplement les mots de Giono pénétrer la scène, son lyrisme y respirer, ses images en dessiner le décor. Tout en retenue, jusqu’au bout. " Tania Brimson, evene
Le bout de la route – Bande-annonce
Sélection d'avis des spectateurs - Le bout de la route
Le bout de la route Le 15 février 2010 à 17h38
Bonjour, Un texte magnifique porté par des acteurs dont la richesse sert ce qui a été écrit. Des décors et mise en scène dans le même élan. Bravo à tous, acteurs, c'est une merveille.
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Le bout de la route Le 15 février 2010 à 17h38
Bonjour, Un texte magnifique porté par des acteurs dont la richesse sert ce qui a été écrit. Des décors et mise en scène dans le même élan. Bravo à tous, acteurs, c'est une merveille.
Informations pratiques - Théâtre de l'Aquarium - La vie brève
Théâtre de l'Aquarium - La vie brève
La Cartoucherie - Route du Champ de Manoeuvres 75012 Paris
- Bus : Cartoucherie à 103 m, Stade Léo Lagrange à 618 m
-
En voiture : A partir de l'esplanade du château de Vincennes, longer le Parc Floral de Paris sur la droite par la route de la Pyramide. Au rond-point, tourner à gauche (parcours fléché).
Parking Cartoucherie, 2ème portail sur la gauche.
Plan d’accès - Théâtre de l'Aquarium - La vie brève
La Cartoucherie - Route du Champ de Manoeuvres 75012 Paris