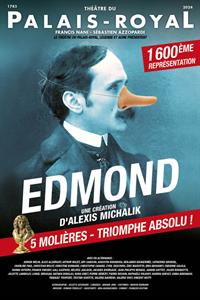Les insoumises
Les insoumises
Coup de cœur CONTEMPORAIN Le 28 septembre 2016
- De : Lydia Tchoukovskaïa, Virginia Woolf, Monique Wittig
- Mise en scène : Isabelle Lafon
- Avec : Isabelle Lafon, Johanna Korthals Altès, Marie Piemontese, Vassili Schémann
Les insoumises - Photographies
Les samedis et dimanches, les trois spectacles sont proposés en intégrale, et du mardi au jeudi en alternance : Deux ampoules sur cinq le mardi, Let me try le mercredi et L’Opoponax le jeudi.
- Un projet en trois temps
« Mais nous sommes des insoumises, n’est-ce pas ? » C’est depuis cette phrase issue des Notes sur Anna Akhmatova qu’Isabelle Lafon envisage son cycle de trois pièces. Dans un dispositif simple, original et audacieux, la metteure en scène adapte des textes littéraires de Lydia Tchoukovskaïa, Virginia Woolf et Monique Wittig. Avec Les insoumises, elle fait résonner, par le biais de l’enfance, de la politique, de la création ou de l’intime, ces trajectoires de femmes libres et actrices de leur destin.
Deux ampoules sur cinq, inspiré de Notes sur Anna Akhmatova de Lydia Tchoukovskaïa, avec Johanna Korthals Altes et Isabelle Lafon.
Let me try, d’après le Journal 1915-1941 de Virginia Woolf, avec Johanna Korthals Altes, Isabelle Lafon, Marie Piemontese.
L’Opoponax de Monique Wittig, avec Isabelle Lafon.
Par la compagie Les Merveilleuses.
- La presse
« Leur quotidien est un enfer, mais elles savent être drôles, surtout Anna Akhmatova, tyrannique et irrésistible, avec sa frange brune, ses saillies et sa mauvaise foi. A cette femme, Isabelle Lafon offre, outre sa frange, sa manière unique d’être dans la vie, à chaque instant. Peu de comédiennes ont une telle intensité. Peu de metteurs en scène savent, comme elle, faire naître le théâtre de la nuit, avec pour seule lumière celle des mots. » Brigitte Salino, Le Monde, 28 septembre 2016
« Mon envie n’était pas de faire un spectacle sur Akhmatova et Tchoukovskaïa mais avec Akhmatova et Tchoukovskaïa. Pour cela, il faut les éclairer et protéger leurs zones de silence, d’obscurité et restituer la clandestinité de leurs entretiens. » Lydia Tchoukovskaïa, femme de lettres, arrive pour la première fois chez la grande poétesse russe Anna Akhmatova le 21 novembre 1938. Lydia décide de transcrire ces entretiens avec Anna et de tenir le journal de leurs rencontres quasi quotidiennes qui vont se poursuivre pendant vingt-cinq ans. Nous sommes en pleine purge stalinienne. Anna est alors interdite de publication, son fils est emprisonné dans les camps, le mari de Lydia a été arrêté... Continuer à se parler, c’est se sauver. Prolonger le poème, c’est tenir envers et contre tout. Aussi les deux femmes parlent, de poésie, de littérature, de fourchettes introuvables et plus tacitement de leur époque et du régime. Anna Akhmatova, risquant sa vie en gardant chez elle les poèmes qu’elle écrit, les fait apprendre par coeur à Lydia avant de les brûler.
Pour approcher l’urgence de dire qu’ont connu ces deux femmes, leur clandestinité, leur peur, leur résistance, Isabelle Lafon et Johanna Korthals Altes utilisent un dispositif remarquablement simple : assises à une table recouverte de livres, elles apparaissent au bon vouloir des spectateurs qui, équipés de lampes torches, les éclairent. La mission confiée à l’auditoire consolide son écoute, qui renforce à son tour la portée du dialogue entre les deux femmes. C’est le théâtre qui jaillit, dans ce qu’il a de plus élémentaire et irremplaçable : une parole qui prend son sens d’être éclairée et entendue par ceux venus la recueillir en silence.
« Les pierres hurlent, les roseaux se mettent à parler et vous dites que les gens ne voient pas, n’entendent pas ! Ce n’est pas vrai, ils ont fait semblant. Ils avaient tout intérêt à faire semblant, devant les autres, devant eux-mêmes. Mais vous, vous aviez tout compris, déjà à l’époque. » Anna Akhmatova
Lydia Tchoukovskaïa, Notes sur Anna Akhmatova, trad. Bronislava Steinlucht et Isabelle Lafon, Éditions Vremia
Et là où l’on fabrique les rêves
Il n’y avait plus pour nous de choix
Il n’y en avait qu’un. Mais sa force
Était comme l’arrivée d’un printemps.
Anna Akhmatova, Leningrad, traduction Jean-Louis Backes, Éditions Poésie Gallimard, 1960
« Fallait-il noter nos conversations avec Anna Akhmatova ? N’était-ce pas risquer sa vie à elle ? Alors ne rien écrire ? C’était tout aussi criminel... Dans le trouble, je racontais ici plus franchement, là à mots plus couverts... mais tout en reproduisant nos conversations j’omettais ou je camouflais l’essentiel... »
Lydia Tchoukovskaïa, Notes sur Anna Akhmatova, trad. Bronislava Steinlucht et Isabelle Lafon, Éditions Vremia
Virginia Woolf voulait dans son journal, (1915-1941) « saisir les choses avant qu’elles ne se transforment en oeuvre d’art ». Un pari à fleur de peau où alterneront réflexions sur son travail, doutes, descriptions féroces et pleines d’humour de ceux qui l’entourent, moments saisis dans le vif d’une discussion ou à la vue d’un paysage... très discrètement sa « folie », ses rapports avec Léonard... des réflexions bouleversantes sur l’écriture. Exigence extrême, pudeur, descriptions à fleur de peau de personnes, de lumières, interrogations, colère, peur, enthousiasme... Il y a dans ce journal l’idée de se sentir libre d’essayer sans le cacher, de toucher l’intime sans jamais s’avachir sur ses intimités. Trois femmes sont là devant cette masse, ce journal. Qui sont-elles ? Ce qui les lie visiblement, c’est le rapport très différent de chacune d’elles au Journal. Il ne s’agit pas alors d’un journal à trois voix mais bien de trois femmes hantées, attirées, happées par une oeuvre. Laquelle est Virginia Woolf ? Que font-elles là ? Se connaissent-elles ? Ou peut-être préparent-elles un spectacle sur le Journal de Virginia Woolf ?
8 Mardi 19 juin 1923
Mais moi, qu’est-ce que je ressens à propos de mon travail d’écrivain – c’est-à-dire ce livre, oui, Mrs Dalloway, si c’est bien son nom ? On doit écrire à partir des sentiments les plus profonds. Est-ce mon cas ? Ou est-ce que c’est seulement à partir des mots que j’aime tant, que je crée ?
Non, je ne crois pas. Pour ce livre, j’ai déjà presque trop d’idées. Je veux tout dire sur la vie et la mort, la raison et la folie ; je veux critiquer le système social, et montrer son fonctionnement, dans toute son implacabilité – mais là, peut-être que je pose un peu. J’ai l’impression de m’être dépouillée de toutes mes robes de bal et de me tenir debout, nue, ce qui, si je me souviens bien, était fort agréable. Est-ce que ce sont de profondes émotions qui ont donné naissance à Mrs Dalloway ? Mais il y a aussi le problème des personnages. Les critiques disent que je ne sais pas en inventer – ou que je ne l’ai pas fait dans La Chambre de Jacob – qui existent vraiment. J’en conviens : « C’est vrai. Je n’ai peut-être pas le don de « réalité ». J’immatérialise, en grande partie volontairement, car je me méfie de la réalité – de sa banalité. »
Mais allons plus loin. Ai-je le pouvoir de retranscrire la vraie réalité ? Ou est-ce que je n’écris que des essais sur moi-même ? Même si je réponds à ces questions dans le sens le moins favorable, il ne m’en reste pas moins ce profond désir d’écrire.
Pour en revenir à Mrs Dalloway, j’ai le pressentiment que ça va être une terrible bataille. Le thème est si singulier, si puissant. Je suis constamment obligée de puiser dans ma propre substance pour m’y adapter. J’aimerais y travailler avec acharnement, à toute vitesse, sans jamais, jamais m’arrêter. Inutile de dire que c’est impossible. Dans trois semaines, je serai à sec.
The Diary of Virginia Woolf, traduction Micha Venailles, Édition Harcourt Brace
« Tu dis qu’il n’y pas de mots pour décrire ce temps, tu dis qu’il n’existe pas. Mais souviens-toi. Fais un effort pour te souvenir. Ou, à défaut, invente ». Monique Wittig
« Mon Opoponax, c’est l’exécution capitale de quatre-vingt-dix pour cent des livres qui ont été faits sur l’enfance. C’est la fin d’une certaine littérature et j’en remercie le ciel. » Marguerite Duras, postface de L’Opoponax
L’Opoponax commence au premier jour de Catherine Legrand dans une école dirigée par des religieuses à la campagne, elle a environ 5 ans. Le livre se termine alors que Catherine Legrand est interne, adolescente ; elle a grandi, elle doit avoir 14 ans. Rien dans le livre ne dit explicitement quand Catherine Legrand grandit.
On suit cela. On est avec Catherine Legrand comme une caméra pourrait filmer à hauteur de visage la petite fille qui entre dans cette école religieuse et, au fur et à mesure, se rehausserait pour toujours rester à hauteur du visage de l’enfant qui grandit. On est très près de ce qu’elle rencontre, de ce qu’elle voit : la campagne, l’école, les soeurs, les autres enfants. Mais ce n’est pas tant l’histoire racontée que l’écriture même de Monique Wittig qui nous propulse dans ce monde. Le « on » est omniprésent dans le texte comme si ce « on » nous incluait et nous obligeait à entrer dans l’histoire par la langue de l’enfance, par cette langue qui débusque tout à mesure qu’elle le voit. « On » est entraîné avant même de se demander quel âge a Catherine Legrand. En quelle classe est-elle ? On le sait comme 11 secrètement, on le sait par ce qui est vu et décrit par Catherine Legrand. On s’imagine que c’est peut-être nous qui manions la caméra
« On », c’est Catherine Legrand, c’est Valérie Borge, c’est Denise Causse, c’est Vincent Parme, c’est Anne-Marie Losserand ou Laurence Bouniol, c’est Madame La Porte (qui a un chignon), c’est Mademoiselle, c’est tout ce monde qui est nommé et qui surgit par le fait même d’être nommé. N’est-ce pas aussi le propre du théâtre que de nommer pour faire apparaître ?
« C’est celui qui dit qui est », disent les enfants dans la cour de récré et la langue de Monique Wittig procède de cette façon. Dire ce texte, c’est déjà le jouer et se laisser entraîner au triple galop par la langue de l’auteur. C’est une machine de guerre qui vous entraîne, on n’a pas le temps de jouer les personnages évoqués et, si on accepte de la suivre, ça se joue tout seul. Il suffit de la laisser parler, d’en saisir le rythme et, sans se poser la question de l’incarnation, on est Catherine Legrand, on est Mademoiselle face à Catherine Legrand, on est le soleil qui se couche... Comme dans les cours de récréation où on fait les plus grands, les plus joyeux, les plus violents « voyages » avec un simple morceau de craie, ici ce sera un batteur, un micro, une comédienne. Un récital. La batterie donne le rythme du récit, le provoque pour donner la chance à Catherine Legrand, au paysage, à la campagne, aux événements, d’apparaître et de disparaître. Juste cette utopie.
On entend que Denise Causse dit, l’opoponax c’est Catherine Legrand. Anne-Marie Brunet Valérie Borge Marielle Balland Sophie Rieux Julienne Pont Marie Démone Anne Gerlier Laurence Bouniol Marguerite-Marie Le Monial Marie-José Broux se tournent vers Catherine Legrand et la regardent. Catherine Legrand devient toute rouge et fait non avec la main puis elle éclate de rire et Valérie Borge qui la regarde dit, non ce n’est pas Catherine Legrand. Marguerite-Marie Le Monial dit qu’on peut torturer tout le monde jusqu’à ce qu’on sache qui est l’opoponax. Manche Balland Nicole Marre et une autre, peut-être Denise Causse, disent que c’est une bonne idée. Valérie Borge dit que dans ce cas il faut commencer par Marguerite-Marie Le Monial étant donné que c’est elle qui a eu cette idée et que d’ailleurs ce n’est pas malin parce que tout le monde va dire qu’il est l’opoponax.
Monique Wittig, L’Opoponax, éditions de Minuit, 1964
- Calendrier
Les spectacles sont présentés en alternance du mardi au jeudi en alternance.
Mardi : Deux ampoules sur cinq
Mercredi : Let me try
Jeudi : L’Opoponax
samedi et dimanche : intégrale
Les insoumises – Bandes-annonces
Sélection d'avis des spectateurs - Les insoumises
les insoumises Par ThierryB - 5 octobre 2016 à 08h58
en tout point remarquable
Moyenne des avis du public - Les insoumises
Pour 1 Notes
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
les insoumises Par ThierryB (4 avis) - 5 octobre 2016 à 08h58
en tout point remarquable
Informations pratiques - La Colline (Théâtre National)
La Colline (Théâtre National)
15, rue Malte Brun 75020 Paris
- Métro : Gambetta à 73 m
- Bus : Gambetta - Pyrénées à 53 m, Gambetta à 57 m, Gambetta - Cher à 144 m, Gambetta - Mairie du 20e à 150 m
-
Station de taxis : Gambetta
Stations vélib : Gambetta-Père Lachaise n°20024 ou Mairie du 20e n°20106 ou Sorbier-Gasnier
Guy n°20010
Plan d’accès - La Colline (Théâtre National)
15, rue Malte Brun 75020 Paris