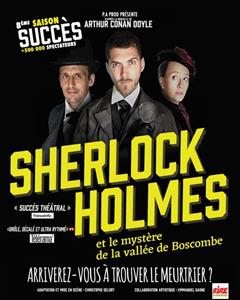Les joyeuses commères de Windsor
Les joyeuses commères de Windsor
- De : William Shakespeare
- Mise en scène : Jean-Marie Villégier, Jonathan Duverger
- Avec : Geneviève Esménard, Karine Fellous, Didier Niverd, Alain Trétout, Jean-Marie Villégier
Falstaff chez les bourgeois
Aborder Shakespeare
Un Falstaff recyclé, mais toujours remontant
Infidèle fidélité, entretien avec Jean-Marie Villégier
Sir John Falstaff est gentilhomme, et déjà vieux. Quoique seul de son âge parmi les chenapans dont le prince héritier, futur Henri V, fait sa compagnie ordinaire, il est le plus glouton des gloutons, le plus filou des filous, le plus menteur des menteurs. Le plus insouciant, le plus vif : un barbon d'incorrigible jeunesse. Boute-en-train, âme damnée, génie anarchiste de cette scandaleuse cohorte, il est, plus souvent qu'à son tour, pris à ses propres pièges : voleur volé, dupeur dupé, rosseur rossé.
Paradoxe de Falstaff : volé, dupé, rossé, il triomphe encore par la seule magie du verbe, car le Matamore est poète de l'universelle dérision. Devenu roi, désormais garant de l'ordre moral, le jeune prince se fait une vertu en reniant le compagnon de ses débauches : « je ne connais pas cet homme ». Entendons : « je ne connais pas cet homme qui me connaît jusqu'au tréfonds ».
Falstaff, semble-t-il, n'a plus qu'à battre en retraite et à se faire oublier. Va-t-il quitter la scène ? Que non ! Il a trop de vie pour renoncer au théâtre. Puisqu'il le faut, adieu aux champs de bataille, adieu à ce monarque naguère tutoyé, mais bonjour la comédie !
Voici donc Falstaff déraciné et replanté. Arraché au drame historique et greffé en milieu bourgeois. Gentilhomme toujours, mais désargenté, parmi ces manants confortables. Renard dans le poulailler. Passer près de ces petites dames, lancer l'éclair d'un billet doux dans le petit jour de leur petit ménage, cela devrait suffire à les rendre folles. On a beau être vieux et gros, un peu plus encore que naguère, on en reste pas moins « Sir ». Hors normes. Légendaire. Auréolé.
Hélas, pauvre Falstaff, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Un jeune roi vous a jeté à la poubelle de l'histoire ; une Madame Ford et une Madame Page vous cacheront dans le panier à linge sale et vous feront choir dans les eaux grasses. Vous croyez encore aux fées, aux lutins, aux revenants ; vous êtes seul à y croire. Vous rêvez d'amours en délire, d'adultères sauvages, de bonnets jetés par dessus les moulins et de coffres-forts éventrés ; vous ne troublerez que d'une ride, vite effacée, le règne absolu du bon sens. Bourreau des coeurs, vous ? Allons donc, gros bêta ! Le petit jeune homme épousera la petite jeune fille, les bourgeois coucheront avec leurs bourgeoises, et vous serez le cocu du happy end.
Jean-Marie Villégier
Après une longue et belle promenade dans le dix-huitième siècle (Les Philosophes amoureux, de Destouches, 1729), le dix-neuvième (Les Deux Trouvailles de Gallus, de Victor Hugo, 1869 ; Victor et Juliette, d’après des lettres et récits de Victor Hugo et Juliette Drouet), et le vingtième siècle (Le Mariage de Le Trouhadec de Jules Romains, 1925), la compagnie revient aux temps pré-classiques : mais quel retour, puisqu’il s’agit d’aborder enfin Shakespeare !
Les Joyeuses Commères de Windsor sont une énigme. Titre célèbre mais peu joué en France, elles sont la seule véritable comédie farcesque du grand Will. Œuvre mineure, composée, paraît-il, en moins de deux semaines, à l’arraché. Œuvre ébauchée, brouillonne, et plus burlesque encore que farcesque. Œuvre devant laquelle les commentateurs, souvent réservés, ne reconnaissent qu’à demi la patte du maître.
C’est que Shakespeare, dans sa hâte, nous y laisse plus que jamais entrevoir ses sources, son arbre généalogique. Il s’inscrit dans la tradition de la Renaissance italienne, celle des contes facétieux ou de la « comédie érudite », et, en remontant plus loin dans le temps, dans la tradition latine, celle de Plaute et Térence. La jeune fille aux trois soupirants forme l’intrigue de la Casina. Falstaff est miles gloriosus. Les Nuits de Straparole fournissent à Shakespeare la situation de l’amant qui confie sa bonne fortune au mari de sa maîtresse. Une nouvelle de Fiorentino lui fournit le panier à linge. Sources directes ou indirectes : bon nombre de ces thèmes avaient déjà été repris et adaptés par des conteurs anglais. (…)
Suivant la tradition, c’est la reine Elizabeth qui, requérant les services de Shakespeare à l’occasion d’une fête de cour, lui aurait suggéré de rendre Falstaff amoureux. Chevalier gourmand, paillard, voleur et hâbleur dans les deux parties d’Henry IV, il n’en était pas moins compagnon du futur roi, son précepteur sur le chemin du vice, son inséparable négatif. Silène de ce Dionysos, il tirait quelque grandeur de sa noble fréquentation. Le voici bien changé : exilé parmi les bourgeois de Windsor, Falstaff n’est plus qu’un aventurier, naguère de haut vol mais tombé désormais dans les mesquineries du terre-à-terre, réduit à un quotidien banal, un poisson hors de l’eau. Incorrigible Matamore, s’il rêve encore de prouesses, elles ne relèveront plus de Mars, mais seulement de Cupidon.
Prouesses, d’ailleurs, intéressées. Falstaff, dans sa disgrâce et son exil, n’a plus de quoi soutenir son rang. S’il fait la cour à deux bourgeoises, c’est que leurs maris sont riches et qu’il espère bien, usant de son prestige et de ses charmes, détourner une part du magot. Goujaterie pure où la sensualité, accessoirement, pourrait trouver son compte : rien, semble-t-il, que de grossier et de révoltant.
Or nos deux bourgeoises, ulcérées par un assaut d’amour dont elles soupçonnent les motifs, insensibles aux prétendus attraits de ce poussah, et peut-être plus encore furieuses d’être simultanément convoitées, vont faire preuve d’une rare imagination dans la mise en œuvre de leur vengeance. Epouses fidèles, portant la culotte, elles mènent par le bout du nez leur volumineux séducteur et le font choir d’humiliation en humiliation.
C’est alors que le trompeur trompé, le séducteur berné, sans nous devenir sympathique, peut arriver à nous toucher. L’imposteur chevronné n’est qu’un enfant candide en regard de ces dames. Encore mouillé d’eau savonneuse, à peine a-t-il reçu sa première correction que le voici tout disposé à se reprendre au piège. Sa naïveté est prête à rebondir d’échec en échec. Toujours perdant, jamais il ne quitte le jeu. Toujours bafoué, jamais il ne désespère de lui-même. Narcisse éperdu, il rassemble instantanément les éclats de son miroir brisé et reverdit en plein hiver. La vieillesse le rattrape, il le sait, il ne veut pas le savoir. D’où sa sottise. D’où sa grandeur. Son examen de conscience, vers la fin de la pièce, n’est qu’une parodie : il est trop tard pour se convertir aux bonnes mœurs. Quelque chose d’increvable, d’indomptable, s’obstine en lui à vouloir vivre. Il n’est plus Falstaff, gentilhomme florissant naguère, aujourd’hui décrépit. Il est le Don Quichotte et le Cervantes d’un roman à nul autre pareil : le sien. Il est le désir même.
Dès lors, peu importe que les moulins à vent ne l’emportent en plein rêve que pour le jeter dans la boue. Rien ne peut lui advenir que de grandiose. A-t-il été embarqué sous un monceau de linge sale ? A-t-il, déguisé en sorcière, reçu une volée de coups de bâton ? L’épopée, travestie, est encore en vers ; l’ordure est transfigurée par le poème. Gloire et dérision vont de pair.
Les Joyeuses Commères de Windsor sont une journée des dupes. Deux pédants, prétendant à se battre en duel, ne font que se donner en spectacle, pauvres clowns. Un jaloux fonce tête baissée dans le chiffon rouge dont on leurre ses yeux hagards. Une entremetteuse fait son beurre des illusions dont elle berce trois galants. Un grippe-sou tente de faire passer son sot neveu pour un parti sortable. Profitant de la mascarade finale, Monsieur et Madame Page voudraient se jouer l’un de l’autre. Ils seront joués l’un et l’autre.
Car il est un jeune gentilhomme désargenté qui a su plaire à leur fille. S’il a conté fleurette à cette petite héritière, ce ne fut d’abord que pour redorer son blason. L’amour s’en est mêlé, réciproque. Il surmonte tous les obstacles et déjoue tous les complots : Anne Page, enlevée par Fenton, l’épouse au nez et à la barbe de tous. Floué, moqué, rossé, c’est encore Falstaff qui triomphe - par procuration. Anne et Fenton : les vengeurs du désir.
Jean-Marie Villégier - Janvier 2004
Jean-Marie Villégier, comment est apparue la nécessité de l’adaptation des « Joyeuses Commères » ?
Nous avons d’abord lu la pièce, Jonathan Duverger et moi, dans la traduction de François-Victor Hugo
- la plus fréquemment reproduite. Et nous avons senti d’emblée qu’il nous fallait chercher ailleurs : le texte de François-Victor est malaisé à mettre en bouche, peu dynamique, peu verveux. Peut-être fallait-il le retravailler ? Commander une version nouvelle ? Mais, à la vérité, par-delà ce que nous ressentions comme des faiblesses de traduction, c’est la pièce elle-même qui nous posait problème. Problèmes, plutôt, au pluriel. Comment ne pas se noyer, et noyer le public avec nous, dans ce flot de jeux de mots, de traits d’esprit aujourd’hui indéchiffrables ? De références à l’héraldique, aux fêtes de la Cour, à la topographie de Windsor ? D’allusions aux petits scandales qui faisaient jaser les contemporains ? Il y avait là de grosses difficultés de transposition.
Mais il y avait plus grave encore, ou plus troublant. Shakespeare n’est pas, on le sait, l’homme des pièces « bien faites » et nous n’étions pas à la recherche d’une mécanique bien huilée. Il nous plaisait et nous amusait fort de le voir engager tels de ses personnages dans des querelles absurdes qu’il ne se donne même pas la peine de dénouer « proprement ». Nous étions séduits par la fantaisie de ce bouquet varié, hâtivement rassemblé, où les fleurs d’un comique à la Molière se mêlent aux herbes folles d’un burlesque échevelé. Mais il nous semblait qu’en bien des endroits l’action s’ensablait dans la surabondance, le sur-développement. Et nous en venions à comprendre que les connaisseurs, les érudits, les grands amateurs de Shakespeare l’aient pudiquement oubliée ou l’aient traitée par le mépris. Voyez, par exemple, les quelques lignes que lui consacre W. H. Auden dans son livre récemment traduit.
Nous étions dans ces perplexités quand nous avons eu connaissance du Quarto de 1602, que Giorgio Melchiori reproduit en appendice de son édition dans la fameuse collection Arden. De ces Joyeuses Commères, comme d’autres pièces de Shakespeare, il existait donc deux états. Celui, posthume, du Folio, que les traducteurs choisissent toujours. Et celui-ci, paru quelques années seulement après la création de la pièce, mais souvent tenu pour un « mauvais Quarto ». La savante introduction de Melchiori nous incitait cependant à y regarder de plus près. Ce « bad Quarto » vaut bien mieux que sa mauvaise réputation. Il est plus nerveux, plus direct que le Folio, plus dynamique. Il mène l’action de façon plus claire, éliminant certaines incohérences et certaines obscurités. Où le Folio s’éternise, il va droit au but : son volume ne représente que les deux tiers de celui du Folio.
Publié du vivant de l’auteur, et peu d’années après la création de la pièce, ce texte peut-il prétendre à l’authenticité ? Ni plus ni moins que celui du Folio. L’un et l’autre sont des « reconstructions », l’une plus élaborée sans doute, l’autre plus hâtive mais plus proche de ce que Melchiori appelle « an acting version for the public stage », une version « grand public » débarrassée des sophistications élitaires dont le Folio est encombré. Notre décision fut vite prise : il fallait traduire le Quarto.(…)
Quels ont été vos partis pris dans le détail de la traduction ?
Au risque de l’anachronisme, j’ai transposé des facéties devenues pour nous mystérieuses dans un univers de références communément reçues aujourd’hui. N’oublions pas que la présence de Falstaff, contemporain d’Henry IV, dans un contexte en tous points élisabéthain est elle-même un anachronisme. Un exemple de transposition : Shakespeare, pour évoquer les restrictions auxquelles Falstaff est contraint, parle de « régime français », de « diète française ». J’ai choisi en cet endroit d’évoquer « ce mot d’ordre français : dégraisser le mammouth ! » : ne s’agit-il pas de procéder au licenciement de Nym et de Pistoll en s’autorisant de notre exemple ?
Des transpositions du même ordre s’observent également dans les choix de mise en scène. Jonathan Duverger et moi avons demandé à Patrice Cauchetier de concevoir ses maquettes d’après des archétypes d’aujourd’hui (bandes dessinées, personnalités médiatiques, vedettes du cabaret, de la chanson, du cinéma) ou d’hier (commedia dell’arte, romans d’aventure). (…)
Propos recueillis par Christiane Vigneau
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Athénée Théâtre Louis-Jouvet
Athénée Théâtre Louis-Jouvet
Square de l'Opéra-Louis Jouvet, 7 rue Boudreau 75009 Paris
- Métro : Opéra à 162 m, Havre-Caumartin à 189 m, Madeleine à 298 m, Saint-Lazare à 398 m
- RER : Auber à 40 m, Haussmann Saint-Lazare à 314 m
- Bus : Auber à 24 m, Opéra à 105 m, Havre - Haussmann à 167 m, Capucines - Caumartin à 217 m, Gare Saint-Lazare - Havre à 301 m, Pasquier - Anjou à 360 m, Madeleine à 394 m
Plan d’accès - Athénée Théâtre Louis-Jouvet
Square de l'Opéra-Louis Jouvet, 7 rue Boudreau 75009 Paris