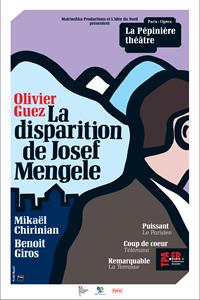Madame on meurt ici !
Madame on meurt ici !
- De : Louis-Charles Sirjacq
- Mise en scène : Joël Jouanneau
- Avec : Fabrice Bénard, Roland Bertin, Sébastien Eveno, Christelle Tual
Un mot de l'auteur
Un mot du metteur en scène
Roland Bertin : faire confiance à ce qui vient
J’ai écrit une première version de cette pièce un peu après la mort de Pasolini, à la fin des années 70. J’étais jeune et un peu déçu des réactions des milieux intellectuels qui parlaient de complot, d’assassinat politique.
On peut mourir pour des idées, mais pas d’amour, semblaient-ils dire. Je me suis souvenu de Joe Orton dont j’avais vu Le locataire avec Madeleine Robinson et lu des pièces. Il s’était fait fracasser le crâne par son compagnon. Mort d’amour.
Je me suis attaché à son histoire, comme une version d’All about Eve gay et tragique et j’ai écrit une pièce dont je fis une lecture au Jeune Théâtre national, alors dirigé par Patrick Guinand avec le concours de Jacques Cousinet, qui y croyait. Elle s’intitulait Romance. J’en refis une lecture au festival d’Avignon. La pièce m’effraya, peut-être. Je la rangeai dans mes tiroirs.
Douze ans plus tard, à l’occasion d’un concours de pièces sur le thème de la trahison, j’en fis une deuxième version, dégagée de l’histoire d’Orton, car entre temps était sorti le film de Stefan Frears Prick up your ears, adapté de la biographie de John Lahr par Alan Bennett. On me reprocha, paraît-il, de m’inspirer d’un film, qui fut réalisé quatre ans après l’écriture de ma pièce.
Je la rangeai dans mes tiroirs.
Elle dormait, comme d’autres. Je la regardais dormir, c’est à dire, je l’amendais, j’essayais de me dégager de l’anecdote, du fait divers.
Huit ans plus tard, elle fut lue en allemand par les comédiens du Burg Theater dans une traduction de Heinz Schwarzinger. Les gens pleuraient.
J’aime les rires.
Je la laissai tranquille, moi aussi, il faut continuer à vivre.
Je l’avais oubliée.
Pas Jouanneau qui s’en souvenait et me demanda à la relire.
Il tournait autour. Un jour il me remit mon texte dans lequel il avait coupé.
Rien ne me fait plus plaisir qu’une coupe.
Nous en avons parlé, lui comme d’un futur, c’est à dire avec intérêt, moi comme du passé, c’est à dire avec indifférence.
Lui avait un grand désir de travailler avec Roland Bertin et avait projeté sur lui la figure de Francis.
Le projet devenait réalité.
Il y eut enfin des séances de lecture à Théâtre Ouvert, avec les acteurs. Brusquement ces corps dans l’espace ont bousculé la fiction. Il me fallait absolument réécrire, adapter, la démonstration du metteur en scène était claire : le théâtre s’écrit - pour sa plus grande partie - dans le théâtre.
J’ai donc réécrit une nouvelle version au mois de juillet 2002. C’est devenu comme l’adaptation du texte d’un autre, un jeune homme des années soixante-dix.
Voilà, c’est une pièce écrite en 1980, terminée en 2002.
Louis-Charles Sirjacq
Un duel. Entre deux amants. L’un jeune encore, l’autre plus, et depuis longtemps. Duel aussi entre deux auteurs de théâtre. L’un en devenir, le second en panne. Les deux vont connaître les gouffres. De la passion. De l’écriture. Jusqu’à l’épuisement. Puis la mort.
Un texte au couteau de Louis-Charles Sirjacq où s’affrontent deux conceptions de l’amour et de l’écriture dramatique. Lui Sirjacq, écrivain sur le fil, entre les deux, une violence extrême, obscène parfois, mais une langue ténue et des situations au scalpel.
Je voudrais régler cela, ce duel, comme un combat de boxe, avec ses règles et ses coups bas. Souvent au-dessous de la ceinture. Ses crochets, ses uppercuts. La recherche du coup fatal. Je voudrais travailler au corps à corps avec les acteurs. Surtout ça. Ce corps à corps là. Sans autre appui pour chacun que le corps de l’autre. Lumière crue. Décor minimal. Le public comme arbitre.
Joël Jouanneau
Sociétaire de la Comédie Française de 1983 à 2001, Roland Bertin a toujours alterné les pièces de répertoire et les créations de textes contemporains. Rencontre de cet acteur généreux pendant les répétitions de la pièce de Louis-Charles Sirjacq, Madame on meurt ici ! créée à Paris en ce début d’année 2003, à Théâtre Ouvert, dans la mise en scène de Joël Jouanneau.
Vous avez joué les plus grands textes classiques et contemporains, avec les plus grands metteurs en scène, quelles sont les expériences qui ont été les plus fortes ?
Le premier moment fort, ce fut avec André Steiger dans Grand’peur et misère du IIIème reich, de Brecht. Après, ce fut Yvonne, princesse de Bourgogne, de Gombrowicz, le premier spectacle que j’ai joué à Paris, avec Jorge Lavelli, en 1965 (1).
Ensuite Chéreau, et Chéreau toujours, au théâtre et au cinéma. J’ai travaillé avec lui pour la première fois en 1968, pour Le Prix de la révolte au marché noir, de Dimitriadis avec Michelle Marquais. C’était presque un happening, nous avons beaucoup improvisé, et avec deux chaises, trois tréteaux, il a créé un monde fabuleux… C’était inouï d’invention, d’audace. Ensuite il y a eu La Dispute de Marivaux, Quartett de Müller… Au cinéma, j’ai tourné deux fois avec lui, notamment L’Homme blessé (2).
Pour moi, Patrice Chéreau a été la plus grande rencontre. Il est peintre, architecte, poète, sorcier, enfant. Il a tous les âges. Il parle admirablement de la vieillesse, de la mort. On l’a taxé, parfois, de morbidité, de complaisance, alors qu’il n’y a aucune complaisance dans son travail. Il est d’une exigence, d’une rigueur… ! Avec lui, on entre tout de suite dans un univers. Il a l’art de vous prendre par la main et de vous faire faire des voyages. Avec lui personne n’a besoin ni de s’alcooliser, ni de se droguer. Il n’y a qu’à suivre ses chemins, emprunter tous les souterrains, et se frotter au lierre de ses décors, de ses châteaux en ruine comme dans La Dispute.
Je crois à certaines choses. Je crois qu’on ne rencontre que ceux que l’on doit rencontrer. Rien ne se fait comme ça, ou alors le hasard est un merveilleux hasard… Là je vois en face de moi le Moulin Rouge et les ailes qui tournent… Il y a comme ça une roue de la fortune, une roue du destin. Il ne faut pas, voyez-vous, quand on travaille avec de grands créateurs, des grands artistes, chercher à renouveler éternellement les expériences. Je pense qu’il faut considérer le travail avec des metteurs en scène que l’on rencontre -surtout s’ils sont exceptionnels- comme des moments qui ne peuvent pas perdurer. Il faut savoir les quitter, même si, alors, on quitte un royaume, sans savoir ce que l’on va trouver après…
J’ai travaillé aussi avec d’autres très grands : Lucian Pintillé avec qui j’ai joué Tchekhov et Ibsen ; Claude Régy, Antoine Vitez, Jacques Lassalle.
Ma rencontre avec Nathalie Sarraute et Claude Régy pour la création de Elle est là, a été fulgurante. On peut dire que si j’avais été écrivain, j’aurais voulu écrire comme Nathalie… Immédiatement, j’en ai épousé l’inquiétude. C’est une écriture qui questionne de manière obsessionnelle, souvent avec drôlerie, et qui ne supporte pas le mensonge. On ne triche pas, avec Nathalie Sarraute. Ce n’est pas une ascèse qui vous dénude, ou alors si elle vous dénude, c’est pour révéler l’essentiel. J’aime bien la démarche de Claude Régy parce qu’il ne triche pas lui non plus.
Il y a eu des moments de grâce avec Antoine Vitez dans sa dernière mise en scène : La Vie de Galilée de Brecht. Tant d’intelligence, de culture… Vitez vous donnait avec bonheur et simplicité, il vous apprenait et vous donnait envie d’apprendre, avec tendresse. C’était un enchantement de travailler avec lui.
J’ai eu des belles rencontres avec des gens assez romanesques, comme par exemple Jacques Lassalle. C’est un personnage étonnant, fort et vulnérable à la fois. Un personnage de roman ; j’ai travaillé trois fois avec lui (3). Il a aussi été mon administrateur à la Comédie Française. C’est quelqu’un pour qui j’ai beaucoup de tendresse, et je ne pardonnerai jamais à ceux qui l’ont évincé de son poste d’Aministrateur.
Je veux aussi citer, pour le bonheur qu’ils m’ont donné : Jean-Louis Benoît avec Schéhadé et Gogol, Catherine Hiegel avec Molière et Pinter, Georges Lavaudant avec Genet, Jean-Pierre Vincent avec Becque, Yves Gasc avec Brisville et Lesage, Philippe Adrien et Jean-Michel Ribes avec Grumberg, Jean-Luc Boutté avec Hugo, Beaumarchais, Molière, Rosner avec Gombrowicz, et puis Luca Ronconi, Benmussa, Zerki, Bourseiller, et tout dernièrement Yves Beaunesne avec qui j’ai joué La Princesse Maleine de Maeterlinck, avec Dominique Valadié et Audrey Bonnet.
Là en ce moment, je travaille Madame on meurt ici ! de Sirjacq avec Jouanneau dont j’admire beaucoup le travail. J’avoue que j’ai de la chance. J’ai quelques projets qui m’excitent assez.
Qu’est-ce qui vous a séduit dans le projet de Madame on meurt ici !
D’abord c’est une « mise en abîme », et j’adore ça. Si le personnage plonge dans des abîmes, dans les ténèbres, je suis obligé de le suivre. C’est bien d’ausculter presque de manière chirurgicale ce genre de personnage malheureux, j’allais dire « homme blessé »… Je pense que cela rappelle de manière un peu lointaine l’aventure de Joe Orton, l’auteur anglais, qui avait eu une expérience malheureuse, douloureuse, tragique, avec un jeune amant. Là, je joue avec un jeune comédien, Fabrice Bénard, qui interprète cet auteur doué pour le boulevard, pour la facilité, alors que le personnage que je joue est un poète. Quand il publie quelque chose, c’est à petit tirage.
C’est une pièce sans complaisance. Ces deux êtres se déchirent, mais ils ont besoin l’un de l’autre. Le personnage de Ted, ce jeune écrivain, sait très bien le talent rare du personnage que je joue, mais c’est lui qui a la gloire, le public, l’argent. J’imagine que mon personnage
-il faut bien rêver aussi, tout n’est pas donné par le texte- a un argent personnel qui lui permet de vivre dans l’écriture avec une certaine pureté.
Je suis très heureux de travailler avec Jouanneau qui est un homme qui sait regarder, écouter, qui a l’énergie et la délicatesse nécessaires pour diriger des comédiens.
Comment expliquez-vous le dénouement tragique de la pièce ?
Rencontrer quelqu’un de plus jeune que vous, homme ou femme peu importe, et le rencontrer très charnellement, comme une sorte d’éblouissement, je pense que c’est tragique. Il rit à un moment donné d’un ami qui est amoureux d’un « cardinal aux yeux bleus » et qui après se convertit presque. Il y a chez cet homme que j’interprète un sens du péché très aigu, il y a une détestation de lui-même, du chemin que lui fait parcourir son homosexualité. Il a rencontré l’être qu’il ne devait peut-être pas rencontrer mais c’est comme ça : il est beau, il est un peu le bourreau qu’il attendait et en même temps, naturellement, qu’il refuse. Ce sont des liens qui ne peuvent se défaire qu’avec la mort. On ne peut pas être « séparé » véritablement. On ne peut pas oublier. Tout d’un coup il faut qu’il y en ait un qui tue l’autre. C’est du théâtre… donc on tue plus facilement, heureusement, que dans la vie ! Souvent dans la vie, on se contente d’être très malheureux.
Avez-vous l’impression que vous poursuivez une quête, en faisant votre métier de comédien ?
Une quête, oui, certainement mystique, un goût de l’absolu. Ca fait du bien de se quitter soi pour rencontrer l’autre. C’est pesant d’être toujours avec soi-même, ça ne va pas très loin… On s’ennuie… c’est répétitif sa fréquentation ! Avec le théâtre, on est obligé de se renouveler, de vivre des vies rêvées que l’on organise.
Et vous avez trouvé quelque chose ?
Rien du tout ! J’ai trouvé simplement que si je ne faisais pas ce métier, je serais devenu fou. Ou alors il aurait fallu que j’aille véritablement à une ascèse. Que j’entre dans un ordre, un ordre rude.
Parce que ce n’est pas facile de jouer ?
Non, c’est très difficile. Souvent je me dis « est-ce que je vais être à la hauteur de l’auteur, du personnage que je dois interpréter ? ». C’est quand même très prétentieux d’aller sur le plateau faire croire à quelque chose, faire réfléchir, etc. ; je n’ai pas d’avis sur ce que le théâtre doit être : un divertissement, un lieu de réflexion, ou je ne sais quoi encore… Je pense que, au mieux, cela peut être un lieu de désordre, qui certes ne peut toucher que ceux qui viennent, mais peut-être d’une manière plus forte que le cinéma. Il endort moins. On peut carrément dormir au théâtre si on s’ennuie ! Mais si on ne dort pas, on est totalement éveillé. Tandis qu’au cinéma, même si on vous présente des horreurs, il y a une torpeur. Pour moi, c’est comme une drogue, le cinéma. Pas le théâtre, qui me cingle davantage… la présence des corps, de la parole. On aurait donné Les Paravents de Jean Genet au cinéma, il y aurait peut-être eu des « bombettes », mais pas ces moments violents qu’on a rencontrés à l’Odéon, quand Roger Blin grâce à Renaud-Barrault a pu monter la pièce avec Casarès.
Quand j’ai joué Quartett de Müller avec Chéreau ou La Veillée de Lars Noren avec Lavelli, on a eu des réactions très violentes dans la salle. Violentes presque physiquement contre nous.
Avec quel metteur en scène ou quel auteur aimeriez-vous jouer maintenant ?
J’aimerais bien jouer Thomas Bernhard, que je n’ai jamais joué.
Et s’il ne fallait jouer qu’un auteur toute ma vie, ce serait Tchekhov.
Chez les metteurs en scène, je ne sais pas… Il y a quelqu’un que j’ai abordé dans un petit rôle, c’est Klaus Michaël Grüber dans Bérénice. C’était un cadeau. Personne ne m’a parlé de Racine comme lui. Il associait Racine à Mozart et Giacometti ! Ca a été un grand moment, de travailler à ses côtés. Parmi les jeunes metteurs en scène… oh il y en a beaucoup. Je pense par exemple à Chantal Morel, qui à Grenoble fait des choses humbles et très belles. Il y en a d’autres. En ce moment, il y a quelques personnes que je rencontre et qui me séduisent par une certaine authenticité que je peux déceler en eux.
On a l’impression, quand on vous écoute, que votre travail est un véritable bonheur ; est-ce qu’il y a des choses que vous n’aimez pas dans le processus de réalisation d’un spectacle ?
Tout peut être joie, mais tout est difficile. Je peux oser, aller très loin -je pense- dans l’imprécation, la démesure, l’outrance, le grotesque, dans la douleur et dans la joie, le farcesque, la tendresse ; et en même temps je suis très pudique. Je n’ai pas peur de choquer, mais il y a certaines choses, surtout physiques, que je ne me permettrai jamais. J’ai été très loin pourtant, mais ça m’a toujours posé problème. Je trouve qu’il faut garder par de vers soi ses secrets.
On avance quelque chose. Ce qui est important, c’est ce que l’on n’avance pas. Je vous dis quelque chose. Ce qui est important c’est ce que je ne vous dirai jamais. A ce moment-là, on sait quelle est la personne que l’on a devant soi. Ce qui est important c’est le non-dit. C’est bien la quête de Nathalie Sarraute, d’aller à l’informulable.
Le mot c’est le « dit », comment trouvez-vous le « non-dit » ?
Mais d’abord on ne le trouve pas ! Les mots sont là pour aller à la quête de cet impossible qui crée le drame, la tragédie. C’est toujours plus, plus, plus, le non-dit. Il y a un très beau moment dans une pièce de Beckett, que j’avais vue, je crois, chez Renaud-Barrault, avec Catherine Sellers dans un fauteuil. On égrenait des choses de la vie, des choses belles, bonnes. Cette personne que l’on pouvait s’imaginer mourante, malade, disait « Encore ! Encore ! ». Beckett a un sens de la formule qui est d’une telle brutalité ! Comme dans Fin de partie où l’un dit à l’autre « Ca avance.. ». C’est terrifiant. « Comment ça va ? Ca avance. » C’est un coup de poignard ! Beckett est un immense écrivain.
Vous parliez de démesure tout à l’heure. Est-ce que chez Sarraute et avec Régy, vous jouiez ça ?
Oui, bien sûr. Il y a différentes manières d’être démesuré. Ce n’est pas parce que l’on est économe de moyens que l’on n’est pas démesuré, énorme et violent. Au contraire. Je crois que la violence peut accompagner le silence.
Comment travaillez-vous cela, justement ?
Ce sont les mots qui provoquent ça, qui sont porteurs. Je ne travaille pas psychologiquement. Je n’ai que très rarement donné de cours, parce que je n’ai pas le sens de la mise en scène, mais, souvent, j’ai demandé à de jeunes acteurs de dire, pas « à plat », bêtement, ce qui ne veut rien dire, car on fait déjà un effort, pour lire à plat, mais simplement. Il ne s’agit pas de se mettre dans tous ses états, ce qui serait artificiel, mais d’être attentif à ce que signifient les mots. Je dis juste « dites bien les mots, les uns à la suite des autres, très simplement ». Petit à petit, en n’étant plus rien, au degré 1 -degré zéro, on ne peut pas- en étant simple devant le mot que l’on a à proférer, les mots vous entraînent à une émotion. On n’a pas à se mettre dans un état, il faut simplement faire confiance à ce qui vient. Tchekhov m’a appris ça. Pintillé me l’a appris dans La Mouette. Au début du spectacle, on jouait aux cartes ; il fallait entrer, s’asseoir, jouer aux cartes, c’est tout.
Bien sûr il faut toujours être romanesque, être porteur d’une vie, de sa vie et de celle du personnage, mais il n’y a rien à jouer. Et petit à petit l’auteur vous apporte de quoi vous émouvoir. Il faut être d’une disponibilité totale.
Je privilégierai toujours l’auteur. Quand le metteur en scène est effectivement poète, musicien, peintre, il devient lui-même un auteur. Comme quand Chéreau monte La Dispute, et qu’il va dans les tréfonds, cherche dans les souterrains de l’œuvre.
Est-ce que vous avez envie de retravailler avec Claude Régy ?
Oui, j’en ai très envie. J’aimerais beaucoup aussi travailler avec Jean-Marie Patte, il est probable que cela se fasse. Je ne vais pas à la gloire, mais je vais là où cela me passionne. La vie est courte. Combien de temps me reste-t-il à vivre ? Peu de temps finalement, alors autant le passer en compagnie d’êtres qui vous touchent. Je l’ai toujours plus ou moins fait, mais c’est de plus en plus important.
Propos recueillis par Pascale Gateau et Valérie Valade
(1) Avec Jorge Lavelli, Roland Bertin a également joué La Vie est un songe de Calderon, Le Triomphe de la sensibilité de Goethe, La Journée d’une rêveuse de Copi, La Mante polaire de Rezvani, Le Cosmonaute agricole de Obaldia, Un Conte d’hiver de Shakespeare, La Veillée de Noren, C33 de Badinter, Slaves de Kushner, Mère courage de Brecht.
(2) Avec Patrice Chéreau, également, au théâtre : Massacre à Paris de Marlowe, Toller de Dorst, Peer Gynt d’Ibsen, et au cinéma : La Chair de l’orchidée.
(3) Avec Jacques Lassalle : reprise de Elle est là de Sarraute, Dom Juan de Molière (le rôle de Sganarelle) et Les Estivants de Gorki.
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Théâtre Ouvert
Théâtre Ouvert
159 avenue Gambetta 75020 Paris
- Métro : Saint-Fargeau à 181 m
- Bus : Saint-Fargeau à 125 m, Pelleport - Gambetta à 210 m, Pelleport Bretonneau à 315 m
Plan d’accès - Théâtre Ouvert
159 avenue Gambetta 75020 Paris