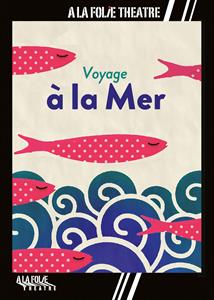Obsession(s)
Obsession(s)
- De : Soeuf Elbadawi
- Mise en scène : Soeuf Elbadawi
- Avec : André Dédé Duguet, Francis Monty, Soeuf Elbadawi, Leïla Gaudin
Obsession(s) - Photographie
- Un fantastique poétique
Soeuf El Badawi est un intranquille à l’intranquillité partageuse, contagieuse. Intranquille… comme on dirait indigné, révolté, insurgé ou plus simplement humain. Furieusement humain. Un obsédé du genre humain !
Il est né aux Comores, archipel que la politique malmène. Tout vient de là et tout y revient, la source, la piste, la quête. Il ne peut se satisfaire du consensus, du ventre mou, de l’accord des « on ». Alors, il traque les « gros mots » dans leur duperie sournoise… « Colonisation » par exemple. Un mot, « un peu fatigué » mais « têtu » dont il dénonce l’immédiate actualité. Il doute et interroge. Il s’emporte et s’encolère.
Alors, il s’adjoint d’autres imaginaires, un chœur soufi, un conteur martiniquais et des complicités québécoises. Alors, il convoque le fou, le conteur, l’artiste pour un rencontre sous-marine avec le coelacanthe, « un très vieux poisson à qui on ne la raconte plus » et qui a vu l’homme arriver… Avec eux, il fustige les « assassins d’aube », met à nu la part de l’ombre et en appelle à une autre lecture de l’histoire, de son monde, de… notre monde.
Un fantastique poétique, une poésie fièvre pour un « Moroni blues », une colère avec sa « fanfare des fous » et ses « obsessions de lune ».
- Le spectacle
Tel un rituel. Des hommes, de blanc vêtus, invoquent leur Seigneur, un soir de déroute. Saisie, une femme interroge. Dans l’ombre, une voix lui répond : « Ils enterrent leurs morts. C’est tout ce qui leur reste dans un monde, où l’on se gave de pop-corn pour survivre au déluge ».
Un trio soufi contant la détresse d’un archipel, un artiste rendu fou à force de digérer sa destinée dans l’ombre, un manipulateur d’objets conversant avec un poisson réchappé du crétacé, le Coelacanthe, un conteur des Amériques devisant sur la geste passée de ses semblables...
Ce spectacle naît du besoin de questionner la fabrique coloniale, hors des mémoires dites exclusives, avec la volonté de renouer avec une histoire en partage, de s’affranchir d’un récit mutilé et de s’ouvrir à une pluralité des regards à la fois.
Obsession(s) est un objet pluridisciplinaire, qui s’échappe d’une prison à ciel ouvert, les Comores, pour retrouver les chemins du monde, et « pour dire la complexité de nos vis-à-vis, entre Sud et Nord, encore sous tutelle », confie son auteur.
- Note d’intention
Ce projet naît du besoin d’interroger la fabrique coloniale, loin des mémoires dites exclusives. Il y a la volonté de retrouver le chemin d’une histoire en partage, de s’affranchir du récit mutilé d’un peuple encore sous tutelle, le mien, et de contribuer à faire tomber quelques certitudes bien établies. Il y a aussi l’idée de renaître au monde, après des années de confinement. Je dis que la part de l’ombre a besoin de se faire entendre. J’appartiens à cette partie du monde, biffée, rayée, effacée de la carte. Pour beaucoup, la colonisation française a pris fin en 1962, avec le drapeau algérien et les accords d’Evian. Alors que le feuilleton se poursuit dans mon pays et entrave encore nos manières d’exister. Il nous faut sortir du malentendu et du préjugé.
Un autre récit doit pouvoir s’ériger entre les différentes rives concernées par cette histoire. Un récit à situer hors du déni, hors du mépris. Qui passe par la langue, et pas seulement. Par la musique, les corps, l’objet. Des raisons qui me poussent à explorer et à orienter le travail vers une forme pleine, fondée sur un principe de transdisciplinarité entre les arts. Je fais confiance au plateau, pour faire surgir cette parole en devenir, et j’y convie des outils, permettant de prendre de la distance sur la violence de cet espace colonial, d’où je m’élève pour prendre la parole, afin d’imaginer d’autres mondes possibles.
Chez moi, on parlerait volontiers de « la chair de l’histoire ». Car il y a ce désir d’incarner la vie qui s’éteint, dans nos paysages encore sous tutelle... Mais les mots ne suffiront pas. Je fais appel par exemple aux traditions soufi de mon pays, auxquels j’ai déjà recouru dans de précédents spectacles, La fanfare des fous et Un dhikri pour nos morts (le premier évoque la folie d’un pays encore sous tutelle, le second de la tragédie du visa Balladur et de ses milliers de morts. Les deux spectacles ont été soutenus par la fondation du Prince Claus aux Pays-Bas).
La présence de trois initiés soufi, issus du collectif des Nurul’Barakat, avec qui j’ai déjà collaboré, devrait m’aider à traduire cette fameuse part de l’ombre. Ils incarneront le corps de ce pays-mien, où le sacré reste seul à permettre de retisser de l’espérance, désormais. Je prévois aussi d’interroger d’autres imaginaires, d’autres pratiques. D’où l’invitation faite à un conteur martiniquais, André Dédé Duguet. Lui-même appartient à un espace colonial, qui m’oblige à élargir mon champ de vision. Entre la Martinique et les Comores, la tragédie impose d’autres rythmes à nos corps. J’invite également un manipulateur d’objets, Francis Monty, un québécois, dont la mémoire coloniale apporte un souffle de complexité à mes propres interrogations. Nous ne voyons pas le Nord, de la même façon.
La distance est là. Ce récit s’ouvre à une pluralité des regards, qui m’évitent d’avoir à resservir les mêmes concepts de dualité entre le Nord colonisateur et le Sud colonisé. Le choix d’un conseil dramaturgique, en la personne de Paul Lefebvre, la volonté de travailler avec une scénographe, Julie Vallée-Léger, tous les deux québécois, dont la réalité immédiate paraît éloignée de la mienne, le souhait d’intégrer un savoir-faire en régie, lumière, vidéo et son, celui de Mathieu Bahasson, qui est français, expriment le désir d’éclater la proposition, pour mieux la situer dans le monde qui est le mien. Un monde qui souhaite échapper au binaire de la relation, loin de la condescendance et de l’amertume, du regard blanc et des reproches noirs, à cet endroit précis où le miroir inversé de l’histoire nous empêche de construire un avenir, dirait Lieve Joris.
J’essaie d’appartenir à un monde pluriel, où tous se disent d’accord pour une décolonisation des esprits, et un décentrement du regard, en acceptant de me rejoindre à cet endroit d’où je parle, là où la fable s’efface pour laisser déborder le réel, toujours en surcharge. Me revient, à l’esprit, cette vieille anecdote. Celle d’un président comorien, feu Ahmed Abdallah, qui disait à la puissance oppressante française, parlant de son peuple : « nous sommes la viande, vous êtes le couteau ». Il disait aussi, parlant de l’annexion d’une des quatre îles de l’archipel des Comores, que cela devait finir, un jour. Car « une vache ne pouvait survivre à quatre pattes ». Il fallait que le pays recouvre sa quatrième patte, et que la France retrouve une certaine humanité à admettre la restitution de ce que la nature et la culture ont donné aux habitants de l’espace qui m’a vu naître. Un archipel de quatre îles, au lieu de trois, dans la mesure où la quatrième, Mayotte, est encore sous occupation française, d’après le droit international (22 résolutions aux Nations Unies condamnent la présence française dans l’archipel depuis 1975).
En fait, j’ai tendance à penser que l’histoire de la prédation entre la France et les Comores ressemble un peu à celle du lapin et du chasseur. Elle prendra véritablement sens et redonnera de l’humanité à tous le jour où les arrières petits-fils du lapin finiront de raconter comment sa viande a engraissé le chasseur et sa famille. Je parle de ce fameux jour, où les arrières petits-enfants du chasseur reconnaitront le crime d’avoir sacrifié la viande de l’autre pour leur propre survie. Il s’agit d’une équation complexe, mais humaine. Et pour l’écrire, il me fallait partager une même envie de contribuer à l’érection d’une mémoire collective, et non exclusive.
Ce n’est donc plus mon histoire de petit colonisé que je souhaite interroger sur un plateau, mais celle des hommes avec qui je converse, régulièrement, du Nord au Sud, et vice et versa. Est-ce qu’on y arrivera ? Je ne saurais le dire. Mais l’envie est bel et bien là. Et peut-être que l’idée même d’un spectacle total, usant de tous les artifices, sans a priori, nous l’autorise. Il faut croire que la mémoire peut se partager autrement que dans la bêtise de nos manquements. Il est une histoire à écrire. Une histoire qui rassemble. Et nous voulons en être.
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Théâtre-Studio à Alfortville
Théâtre-Studio à Alfortville
16, rue Marcelin Berthelot 94140 Alfortville
- Métro : Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort à 732 m
- Bus : Général de Gaulle à 127 m
-
Voiture : périphérique Porte de Bercy / autoroute A4 direction Metz-Nancy sortie Alfortville.
Plan d’accès - Théâtre-Studio à Alfortville
16, rue Marcelin Berthelot 94140 Alfortville