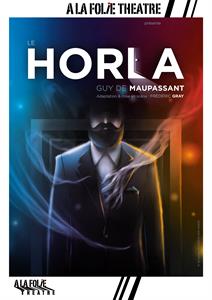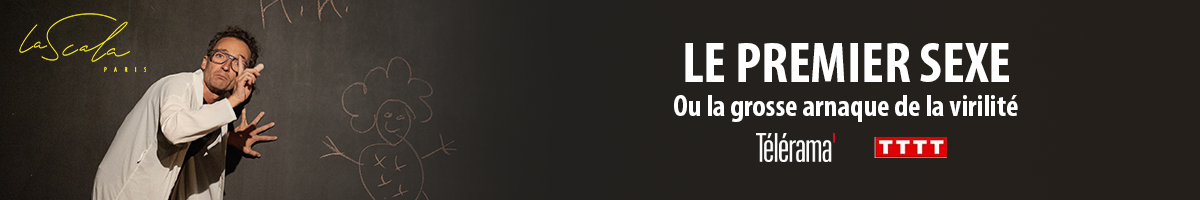Oncle Vania
- De : Anton Tchekhov
- Mise en scène : Yves Beaunesne
- Avec : Roland Bertin, Servane Ducorps, Evelyne Istria, Laurent Poitrenaux, Nathalie Richard, François Sikivie, Claire Wauthion
Résumé
La fin d’un monde
Maxime Gorki à Anton Tchekhov, novembre 1898
L’expérience du temps
Drame sur la condition humaine, la solitude et l’ennui, la pièce met en scène un vieux professeur qui, avec sa seconde épouse, se retire à la campagne dans la maison de Vania et de sa fille. Leur arrivée trouble des existences paisibles. Dans un dernier sursaut pour combattre la peur de ne pas vivre vraiment, les personnages tentent d’aimer, de haïr, de tuer.
Jour après jour, quelque chose nous quitte, il y a de la perte partout dans nos vies, et ce n’est pas triste : la mort s’installe dans les draps de notre jeunesse, et avec elle nous apprenons à aimer de façon plus apaisée. Les formes nouvelles doivent permettre le passage de l’ancien au nouveau.
Œuvre crépusculaire, Oncle Vania fait entendre un sombre chant. Oncle Vania parle de la fin d’un monde, de la fin d’une illusion. Dans une maison-labyrinthe aux 27 pièces, Tchekhov construit une langue nouvelle à l’architecture savante, comme un nouvel instrument d’opération de ce monde malade pour un écrivain que la médecine n’a jamais quitté. Cette maison est une ruche fantastique de mots qui ne se taisent jamais. Un peuple d’êtres jaillis d’un bloc, les jambes prises dans le marbre, les bras se dressant vers le ciel, et de la bouche entrouverte s’échappe un cri. Il n’y aura pas de bonheur, mais il y aura l’incandescence de l’instant lumineux qui rachète tous les retards et toutes les erreurs.
C’est une sorte de Zeitnot, c’est-à-dire, pour les joueurs d’échecs, l’impasse où se trouve celui qui perd la partie faute d’avoir eu la capacité de déplacer un pion à temps, même si la situation lui était favorable. Il est des vertiges auxquels il manque une poignée de secondes. Il faudrait alors arriver à donner forme à la fragmentation du temps, à l’enlacement de la pensée avec les élancements du corps, à un théâtre des miettes, de la parole en îlots.
Tous ces personnages vivent en grand danger d’effondrement, et quand cela se produit, c’est spectaculaire. Mais ils sont bâtis comme des maisons japonaises : faciles à démolir, faciles à reconstruire. Finalement, les matériaux les plus légers sont aussi les plus solides. Si l’on additionne les personnages de Oncle Vania, peut-être voit-on apparaître l’ombre de Tchekhov. La pièce, terminée huit ans avant la mort de l’auteur, est une œuvre d’une immense vitalité, riche de toutes les espérances qu’il n’aura pas le temps d’écrire.
Il y a chez eux quelque chose du syndrome de Münchausen. Celui qui en est atteint est celui qui va voir un médecin, lui fait une déclaration d’affection du style « vous allez me sauver, c’est merveilleux », le médecin se laisse piéger par ce contre-transfert, prescrit ce que lui, dans son monde de médecins, croit bien, et le patient sabote ses prescriptions, se mutile, ferme sa perfusion, provoque une cascade de pépins médicaux. Pour mettre en échec celui qu’il aime et qu’il respecte. Il ne se sent vivre que lors de ces tragédies médicales. Et quand il n’y a pas de tragédie, il meurt d’ennui, il est en pleine mélancolie. Chacun, comme un enfant mélancolique, se met à l’épreuve pour avoir la preuve qu’il est bien vivant, pour avoir la confirmation de ce qu’il vaut. La souffrance lui prouve qu’il vit, c’est comme un rite d’initiation. C’est sans doute un réflexe de riche, les épreuves chez les pauvres sont tellement quotidiennes que ce n’est pas la peine de se faire des ordalies.
Ce n’est pas de contracter je ne sais quelle schizophrénie clinique que la folie s’empare de l’être, mais d’éprouver ce monde sans amour : c’est à cause de cela que l’on bascule vers ces mouvements éperdus qui animent les culbutos tout blancs au regard vide des cours d’asile. C’est là qu’arrive Lear dont la tempête inhumaine a soufflé le crâne, laissé la cervelle à l’orage et les pensées sous la pluie ruisseler. C’est là aussi que Tchekhov illumine l’âme et l’ouvre enfin sous les éclairs : avec lui, je ressens toujours qu’il existe en moi un endroit qui sait ce que je ne sais pas. Il faut le lire comme cuisinent les Arabes, en puisant à pleines mains dans le pot de sel, les doigts blessés.
Yves Beaunesne
J’ai vu ces jours-ci Oncle Vania - j’ai vu et j’ai pleuré comme une bonne femme, même si je suis loin d’être un homme nerveux, je suis rentré chez moi abasourdi, chaviré par votre pièce, je vous ai écrit une longue lettre et - je l’ai déchirée. Pas moyen d’écrire bien, clairement ce que cette pièce vous fait naître dans l’âme, mais je sentais cela en regardant ses personnages : c’était comme si on me sciait en deux avec une vieille scie. Les dents vous coupent directement le cœur, et le cœur se serre sous leurs allées et venues, il crie, il se débat. Pour moi, c’est une chose terrifiante. Votre Oncle Vania est une forme absolument nouvelle dans l’art dramatique, un marteau avec lequel vous cognez sur les crânes vides du public...
Texte français André Markowicz et Françoise Morvan
Extrait de Oncle Vania, section Dossier, Éditions Actes Sud, coll. Babel, Arles, 1994
On oublie trop ce qu’est la province. Rien de tel cependant pour faire l’expérience du temps. La province, et russe, et en 1880, c’était trois fois la province : le bal chez l’inspecteur des impôts, le défilé de la garnison, les vodka-parties avec le médecin et le fermier voisin, ce ne devait pas être folichon, à Kourk ou à Taganrog.
Dans cette oisiveté, chaque seconde compte. Aucun théâtre peut-être qui, autant que celui de Tchekhov, soit scandé par un balancier. L’horloge finit par y donner sa musique au silence, et Dieu sait si l’on se tait dans La cerisaie comme dans Vania, et si l’on entend se taire. Comme chez notre Flaubert, provincial lui aussi : il n’y a pas loin d’Yonville aux bourgades ukrainiennes. Mais pas davantage, peut-être, de Paris à Moscou : l’œuvre de Tchekhov, comme celle de Flaubert, est issue de la grande cassure qui a ébranlé, vers le milieu du XIXème siècle, la conscience européenne, et à partir de quoi va se fonder la littérature contemporaine.
L’homme a cessé de croire à son destin pour n’y voir qu’un anti-destin, une mascarade, un jeu truqué « une farce de collégien », le mot est de Tchekhov lui-même. Et Eléna, dans Oncle Vania, constate doucement entre son livre de comptes et le samovar déjà froid : « Je ne suis qu’un morne personnage épisodique ». Quand on fait ce constat, il n’y a plus qu’un ennemi, et c’est celui qui est mortel. L’œuvre de Tchekhov a découvert le temps, et le temps est une blessure. (…)
Nous ne sommes plus guère qu’à une vingtaine d’années de 1917 : une classe désorientée assiste sans le savoir aux premières convulsions d’où sortiront les révolutions, les prolétariats et l’ère industrielle.
Renaud Matignon
In préface de La Cerisaie, Le sauvage, Oncle Vania - Folio.
Sélection d'avis des spectateurs - Oncle Vania
RE: Oncle Vania Le 4 janvier 2005 à 15h51
Moi je suis au lycée Millet et je joue le role d'Héléna
Oncle Vania Le 19 octobre 2004 à 14h23
Il y a longtemps que je n'avais pas été aussi ému lors d'une représentation. J'ai particulièrement apprécié le jeu des acteurs, que ce soit le rôle titre, celui de Sonia ou celui du docteur. Un très grand moment. Dommage que ce soit déjà la fin des representation. j'y serai bien retourné une seconde fois.
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
RE: Oncle Vania Le 4 janvier 2005 à 15h51
Moi je suis au lycée Millet et je joue le role d'Héléna
Oncle Vania Le 19 octobre 2004 à 14h23
Il y a longtemps que je n'avais pas été aussi ému lors d'une représentation. J'ai particulièrement apprécié le jeu des acteurs, que ce soit le rôle titre, celui de Sonia ou celui du docteur. Un très grand moment. Dommage que ce soit déjà la fin des representation. j'y serai bien retourné une seconde fois.
Informations pratiques - Criée
Criée
30, quai de Rive Neuve 13007 Marseille