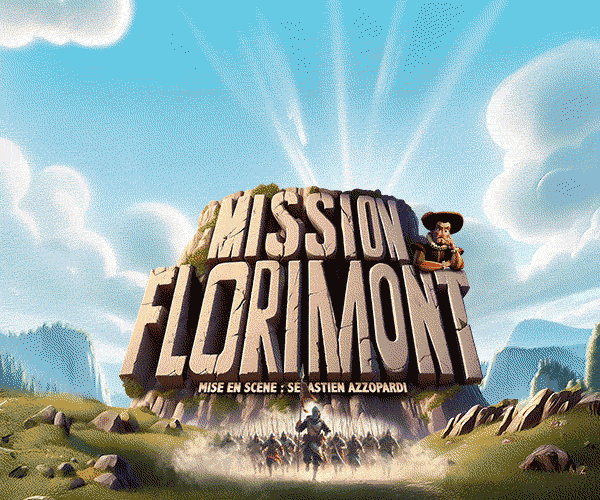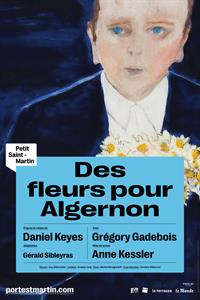Prends bien garde aux zeppelins
Prends bien garde aux zeppelins
- De : Didier Flamand
- Avec : Patrick Blondel, Marc-Henri Boisse, Arnaud Carbonnier, Pierre Carrive, Eric De Brosses, Andrée Delair, Philippe Du Janerand, Hervé Dubourjal, Isabelle Dunatte, Lionel Goldstein, Tom Grés, Flore Hofmann, Daniel Isoppo, Liv Knutsen, Vincent Martin, Françoise Miquelis, Elisabeth Mortensen, Michel Musseau, Louis Navarre, Christine Nissim, José Otero, Christine Paolini, Kira Pitonie, Vincent Priou, Jean-Louis Stanek, Marie Vag, Jean Valière, Mattéo Vallon, Mladen Vasari, Jean-Marie Verdi
Présentation
Historique de la pièce
Pourquoi ce titre ?
L’Histoire
Pourquoi utiliser une langue imaginaire ?
Pourquoi reprendre ce spectacle 25 ans après ?
Les gaietés de Flamand
L’accueil du public comme celui de la critique fut unanime. A l’automne 1977, aux Bouffes du Nord, le spectacle quasi muet de Didier Flamand, construit sur les ruines du début du XXème siècle, fait date dans l’histoire du théâtre contemporain. Des cris d’oiseaux, un sabir indistinct, quelques bribes de français constituent le seul langage de ces fragments non légendés d’une splendeur silencieuse, évoquant les monstruosités de la guerre. Une promenade à Lioubimov, un match de football, un bal à l’ambassade. Notables à chapeau melon. Soldats sur un quai de gare. Un restaurant déserté, un état-major surpeuplé. Serveurs en patins à roulettes, militaires en déroute, jeune filles en larmes…. Succession d’images que ceux qui les ont vues disent inoubliables, Prends bien garde aux Zeppelins, un quart de siècle après sa création, revient fleurir le tombeau d’un petit soldat inconnu tombé lors de la guerre 14-18. Prends bien garde aux Zeppelins
Créé en septembre 1977, ce spectacle s’inscrit dans la suite logique d’ateliers que je dirigeais à l’Ecole Polytechnique, la Faculté des Sciences de l’Ecole des Ponts et Chaussées, travail résultant lui-même de l’enseignement que j’avais reçu à la faculté de Vincennes, puis au cours Tania Balachova et à l’atelier Andréas Voutsinas.
C’est grâce à ce dernier, qui m’avait confié la responsabilité de monter un spectacle, que j’ai pu réaliser cette mise en scène, pour quatre représentations, au théâtre des Bouffes du Nord. Suite à l’accueil fait au spectacle, nous avons pu, l’année suivante, avec l’aide de Peter Brook, Micheline Rozan, la FNAC et les Affaires Culturelles, le reprendre pour trente représentations dans ce même lieu, puis sous le parrainage du Ministère des Affaires Etrangères (AFAA), entreprendre une grande tournée en Europe (Allemagne, Hollande, Italie, Finlande) ; enfin, en 1981, effectuer une reprise à l’Opéra Comique, à l’occasion du cinquantième anniversaire d’Amnesty International, ainsi qu’à Madrid au Teatro Español.
Emprunté à un poème d’Apollinaire, il est, pour moi, la parole réconfortante d’une mère à son enfant : “ Couvre-toi bien mon chéri, ne prends pas froid… ”. Mots qui sont là pour exorciser la peur, mais aussi pour nous faire pénétrer dans l’univers du conte.
Et puis, associé à cette idée de guerre, ce ballon enfantin, inventé par l’homme dans le désir de s’élever, s’affranchir des dures lois de l’attraction terrestre, qui plane au-dessus des têtes comme une menace, et peut à tout moment se transformer en machine à tuer.
Un petit soldat de la guerre de 14 est en train de mourir sur une table d’opération. Il revoit défiler les images d’une époque heureuse de son enfance.
Outrancières, transformées par les années, ces images nous sont restituées par de courtes scènes, flashs à la fois d’émotions et de sensations où se mêlent et s’entrechoquent, sons, musiques, lumières, odeurs.
Réminiscences de la campagne, la famille, les regroupements sociaux, la chaleur et la luminosité si particulière à une journée d’été… mais aussi visions extra-lucides sur la politique, le monde des affaires, l’ordre et le pouvoir, tout ce qui compose la machine sociale qui l’a forcé à aller se battre pour son pays.
A la faculté de Vincennes, j’avais été passionné par le travail sur le borborygme abordé avec Alain Astruc. J’avais travaillé également sur des textes d’Henri Michaux ainsi qu’avec certains groupes lettristes. C’était après 68 ; il y avait tout un mouvement d’idées nouvelles autour du théâtre et de son enseignement : Living Theater, Bread & Puppet, Mama de New York, Grotowski… De nombreux exercices nous ouvraient l’âme et la conscience, et s’organisaient autour du corps et ses infinies richesses, reléguant la parole au second rang.
Etant amené à donner des cours de théâtre, j’ai aussitôt voulu enseigner ces exercices qui m’avaient passionné, et dans cette nouvelle dynamique, les transformer, en inventer d’autres.
Pour développer la recherche liée au sous-texte, et aider l’acteur à aller chercher ce qui se cache derrière les mots, j’ai imaginé commencer un travail sur une langue inventée. L’apprenti comédien privé d’un langage accessible aux autres, devait, par son seul engagement, nous faire ressentir les sentiments profonds de son personnage.
Je voulais permettre au public le plus large possible de ressentir, en acceptant de se perdre dans un autre système de références et à travers une vision plus impressionniste que didactique, ce que pouvait être la guerre, sa mécanique implacable et absurde, l’horreur, la part grotesque et pathétique qui pouvait s’en dégager.
Il s’agit ici d’une aventure humaine et d’une histoire d’amitié. Ce spectacle a constitué, pour la grande majorité d’entre nous, nos premiers pas au théâtre.
Il représentait déjà bien plus que le simple plaisir de venir jouer sur une scène. Il s’agissait là d’une prise de parole essentielle, d’une profession de foi, de l’affirmation, en cette période très polémique, d’une idée que nous nous faisions de notre métier, du rôle de l’acteur et de sa nécessité d’engagement, mais aussi d’une forme d’expression que nous voulions affirmer. S’il était bien question de prendre la parole, c’était avant tout pour défendre un point de vue esthétique et moral, une démarche différente face à un théâtre qui nous semblait par trop académique et installé dans ses certitudes.
Il nous a paru tout naturel de venir témoigner de ces instants en les revisitant et en nous confrontant une nouvelle fois à la forme particulière de ce travail.
Non dans l’idée fallacieuse de reproduire un modèle qui avait fonctionné, mais bien au contraire dans un souci de mise à l’épreuve et de re-questionnement face au temps et son usure.
Il va être intéressant de voir jusqu’où nous avons pu changer, si le chemin est encore possible, et si nous aurons l’humilité requise pour ces courtes scènes et ce travail choral.
Il faudra bien tenir compte aujourd’hui de notre plus grande expérience, notre savoir-faire et donc notre habileté à faire semblant, à truquer. L’opposé même de cette grâce, cette candeur qui était la nôtre et qui faisait le charme si particulier de ces “ Zeppelins ”. Nous n’étions pas encore nés à nous mêmes. Nous n’avions pas encore de “ nom ”, fut-il grand ou petit. Nous étions libres, insolemment libres.
Et avec les mêmes comédiens ?
En partie. Certains nous ont malheureusement quittés, d’autres n’ont pas pu, ou pas voulu, ce spectacle appartenant pour eux définitivement au passé.
Pour ceux qui seront là aujourd’hui, quoi de plus passionnant que de venir le revisiter, avec nos expériences, nos désillusions, et, pourquoi pas nos nouveaux espoirs, dans une démarche plus nourrie, plus riche, plus critique.
Un spectacle de vieux clowns, sans nostalgie, une replongée dans ce qui fait, aujourd’hui, le questionnement sur le rôle de l’acteur, au-delà de celui d’histrion et de divertisseur public, dans une société où tout est devenu spectacle, course à l’individualité.
Oui, c’est pour tous ces motifs qu’il m’a semblé naturel de “ rappeler au front ” ceux qui étaient à l’origine de ce travail, les “ petits soldats de la classe 77 ”. Et puis aussi le désir secret d’aller se promener dans une forme plus “ Kantorienne ” à la façon de la Classe morte, pour célébrer ce que nous représentions collectivement et l’étonnement d’être encore là quand d’autres nous ont quittés. Être, nous aussi, déjà, nos propres fantômes.
Temps unique, hors du temps réel. Temps du Théâtre ? Temps qui nous lie par-delà la mort. Oui, si nous étions déjà nos propres fantômes, enchâssés dans cette histoire comme l’est le petit soldat dans la sienne ? Obligés de la vivre et de la revivre encore, de remonter au front et d’y remonter toujours. Comme le petit soldat, gisant magnifique dont le geste salvateur se répète indéfiniment, geste aujourd’hui dérisoire, tel le monument aux morts devant lequel nous passons sans même jeter un regard et qui nomme pourtant l’histoire et son bégaiement. Parce que la guerre est toujours bien là, même si elle a changé de visage et qu’elle fait moins mal, moins peur, tout du moins quand elle est loin de chez nous. Une sorte de gros jeu vidéo, si irréel qu’on finit par en accepter la présence. Plus de sang, plus de bruit, juste quelques images verdâtres à peine reconnaissables.
Mais aussi guerre dans la rue, la prison, la banlieue proche et ses cités. A la Bourse, à la télé, par l’intermédiaire du petit écran bleuâtre qui nous crétinise tous les soirs un peu plus, en nous abreuvant de fausses nouvelles, dans cette idée de liberté mensongère, de combats et de compétition, façon Loft Story ou Star Academy. Cette pornographie soft ou hard, qui envahit tout notre espace, du talk Show où tout le monde vient se vautrer pour parler de soi et dire tout et n’importe quoi, aux émissions de divertissement où nos politiciens, de quelque bord qu’il soient, s’exhibent pour bien montrer qu’ils sont des hommes comme les autres, qu’ils peuvent se moquer d’eux-mêmes et rire des pièges qu’on leur tend ou de la dernière blague salace qu’on leur glisse au passage. C’est la société du spectacle et des loisirs qui le veut, c’est elle qui dicte ses lois. Alors essayons avec nos modestes moyens, mais enthousiastes et poétiques de nous battre joyeusement contre les rires enregistrés et le désespoir envahissant.
Didier Flamand – janvier 2002
Prends bien garde aux Zeppelins est une suite de tableaux vivants, animés, quelques-uns parlants, qui “ représentent ” une guerre. – surtout celle de 14-18.
Quelques scènes de tranchées, d’antenne chirurgicale de première urgence, mais de préférence des choses vues à l’arrière, chez les riches qui ne se battent pas, ou les demi-riches.
Flamand est plein d’inventions. Ses idées, si l’on veut, sont des gags, mais des gags fins et purs, des observations simples, à peine soulignées, comme dans les premiers films de Jacques Tati (Flamand emploie, comme Tati, une langue parlée non compréhensible, sabir à forte consonance allemande dans les Zeppelins).
Ses gaietés sont proches d’une description par l’absurde. Le public est pris dans un malentendu optique, parce que les apparences sont celles d’une folie, libre, mais la réalisation est extrêmement soignée, par exemple tous les détails des costumes et des accessoires atteignent une perfection de dessin, de couleur, qui n’est pas courante au théâtre, surtout dans la comédie.
Il s’en faut de très peu que la farce ne bascule dans un constat glacé, affreux, mais elle n’y tombe jamais - il y a chez Flamand une absence de cruauté. L’invention est si riche qu’une simple séance de pose pour la photographie des élèves d’une classe dans un collège religieux ou que le simple croquis de deux clients buvant quelque chose dans un café deviennent des scènes fabuleuses. A croire que les traits que dessinent ces acteurs reposent avant tout sur une observation intelligente des citoyens vrais en action ; ces acteurs se surpassent dans la représentation des silhouettes secondaires muettes, presque immobiles, qui racontent toute une vie.
Michel Cournot, Le Monde, 22 septembre 1977
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Chaillot - Théâtre national de la Danse
Chaillot - Théâtre national de la Danse
1, Place du Trocadéro 75016 Paris
- Métro : Trocadéro à 96 m
- Bus : Trocadéro à 31 m, Varsovie à 271 m, Pont d'Iéna à 297 m
Plan d’accès - Chaillot - Théâtre national de la Danse
1, Place du Trocadéro 75016 Paris