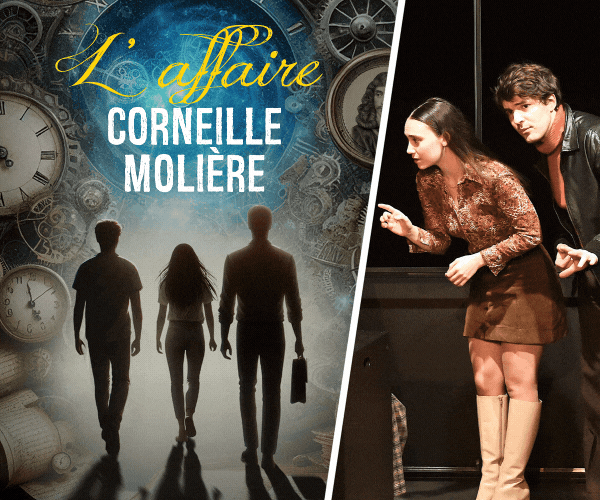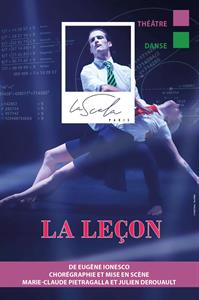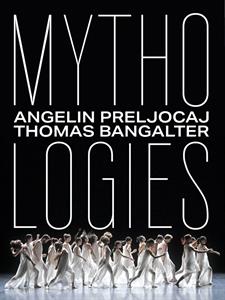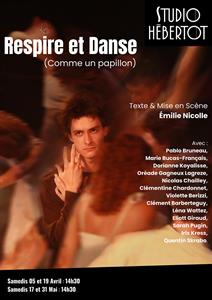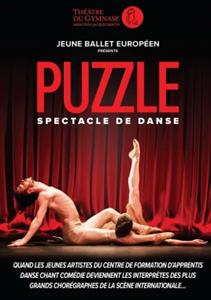Ballet de l'Opéra national du Rhin - On achève bien les chevaux
Ballet de l'Opéra national du Rhin - On achève bien les chevaux
- De : Horace McCoy
- Adaptation : Bruno Bouché, Clément Hervieu-Léger, Daniel San Pedro
- Mise en scène : Bruno Bouché, Clément Hervieu-Léger, Daniel San Pedro
Lors d’un marathon de danse sans pitié, les couples se déchaînent et se déchirent, en valsant vers le cataclysme final.
Ballet de l'Opéra national du Rhin - On achève bien les chevaux - Photographies
- Tragédie dansée
Il y a un siècle, les marathons de danses connurent un succès considérable. De ces concours qui duraient des semaines, Horace McCoy nous a laissé un témoignage bouleversant, avec son célèbre roman On achève bien les chevaux, adapté au cinéma par Sydney Pollack. L’adaptation du Ballet de l’OnR et de la Compagnie des Petits Champs entremêle les époques de la Grande Dépression et de la crise actuelle, en suivant l’aventure tragique de Gloria et Robert, où danseurs et acteurs jouent et dansent comme au bord d’un volcan.
Fort du succès de sa création des Ailes du désir librement adaptée du film de Wim Wenders, Bruno Bouché construit le répertoire d’un ballet du XXIe siècle, défrichant de nouveaux territoires dramatiques. Avec Clément Hervieu-Léger et Daniel San Pedro, il revisite ici la danse-théâtre, dans une forme inédite qui interroge avec sagacité la position du spectateur.
- Note d'intention
On achève bien les chevaux est né d’une volonté commune de continuer à interroger l’idée même de danse-théâtre. Ainsi Daniel San Pedro, Clément Hervieu-Léger et Bruno Bouché ont réuni leurs compagnies respectives : la Compagnie des Petits Champs et le Ballet de l’Opéra national du Rhin.
Le roman d'Horace McCoy s’est immédiatement imposé comme la trame narrative idéale pour une telle création. Écrit en 1935, On achève bien les chevaux décrit le spectacle mortifère d’individus tombés dans la misère, réduits pour quelques dollars à danser jusqu’à épuisement pour divertir un public en mal de sensations fortes. Cette histoire – déjà adaptée au cinéma par Sydney Pollack en 1969 – ne pouvait se prêter davantage à cette rencontre entre les musiciens, les danseurs du Ballet et les comédiens de la Compagnie des Petits Champs, car tout y est déjà contenu : la danse et le théâtre, le groupe, la condition de l’artiste et sa place dans la société.
En 2023, Bruno Bouché, Clément Hervieu-Léger (de la Comédie Française) et Daniel San Pedro signent une adaptation plus intemporelle du roman, dans un entrelac d’écritures chorégraphique et théâtrale. Entre la fiction et la réalité, les trois créateurs souhaitent s’interroger sur ce qui fait spectacle. Un spectacle sans public a-t-il une raison d’être ? Le public peut-il être complice d’un spectacle poussé à l’excès ? Peut-il en être l’otage ? Les metteurs en scène et chorégraphe n’entendent pas travailler sur la composition mais souhaitent demander au contraire à leurs interprètes d’être au plus proche d’eux-mêmes. Chacun doit faire avec ses propres forces physiques, sans tricher.
C’est de cet « épuisement vrai » que naîtront une vérité de sentiment et une réelle justesse d’appropriation du texte. Ce sont les corps qui doivent parler d’abord dans ce rythme effréné du marathon. Le travail sur la course, notamment pour le derby, est au cœur de la recherche d’une danse forte, transgressive et résolument contemporaine. La parole, elle, ne peut être qu’altérée ou modifiée par l’effort physique. Le texte de McCoy est extrêmement dialogué et offre une matière littéraire exemplaire pour s’abandonner à cet exercice d’interaction entre le corps et la parole.
D’un format d’une heure vingt-cinq, cette adaptation de On achève bien les chevaux, en mettant à nu la vulnérabilité de l’artiste, souhaite redonner du sens à ce que doit être aujourd’hui l’expérience du spectacle vivant : un spectacle fait de sueur et de larmes, de cris et de chuchotements, d’élans et d’épuisements...
Jean-Louis Barrault rappelait que le théâtre était, pour les interprètes comme pour les spectateurs, l’occasion de faire l’expérience de « notre commune humanité », cette humanité que nous raconte McCoy comme personne d’autre.
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt
Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt
2, place du Châtelet 75004 Paris
- Métro : Châtelet à 31 m
- Bus : Châtelet à 20 m, Châtelet - Quai de Gesvres à 62 m, Hôtel de Ville à 181 m, Pont Neuf - Quai du Louvre à 342 m
Plan d’accès - Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt
2, place du Châtelet 75004 Paris