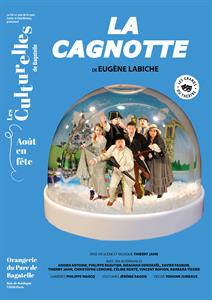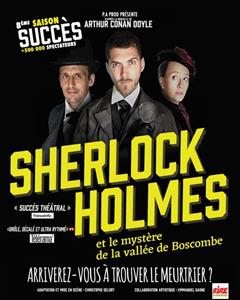Fanfares
Fanfares
Fanfares, c’est l’histoire incertaine de quelques égarés de par le
monde dans la nuit dévastée.
Routes boueuses et bombes au phosphore. Farniente dans les luzernes fraîches au clair de
lune.
Voyous, saints, clochards, aventuriers, et même quelques petits clercs de bureau à fine
moustache et à manchettes lustrées.
La saga des sans foi ni loi, comme on disait autrefois, mais aussi le roman des
célibataires anonymes arrosant leurs géraniums. Les déracinés et les enracinés.
Une cavalcade frénétique, exténuée, burlesque.
Il y a du désastre dans l’air. Quelques types douteux, cigare au bec,
parviennent bien à passer entre les balles. Cette musique-là, tout le monde s’en
passerait. On entend les pétards assourdissants de la Fête des Morts dans le Michoacan
et la fanfare municipale de Séville fait résonner ses lourds accords cuivrés pour
accompagner la Vierge de la Semaine Sainte.
Quelqu’un qui s’était endormi se retrouve brutalement plongé dans un paysage
qu’il ne reconnaît pas. Mais cela ne semble pas l’inquiéter. La peur est
parfois au rendez-vous. La solidarité aussi. Mais tous rejettent avec mépris le nouvel
angélisme universel.
Des types rôdent, affamés, fiévreux, illuminés de l’intérieur. La bande des
copains désastreux s’est réunie pour un anniversaire sans objet. Les vitelloni du
troisième millénaire échangent des confessions soûlographiques.
Deux mecs se poursuivent à cause d’une poule volée ou bien d’un baladeur et
l’un des deux finira mal.
Un employé fume un cigarillo en regardant le fleuve chocolat.
Il y a de la mélancolie, pas de tristesse, simplement un peu de saudade.
J’écoute ces fanfares. Je pleure, je ris, je ne me souviens plus.
A l’origine, ce spectacle devait clore une trilogie mexicaine commencée avec
Veracruz et Terra Incognita. Le projet a changé de nature, même s’il demeure dans
la ligne sensible et esthétique tracée par les deux spectacles précédents. En son
coeur, il y a certaines musiques populaires. Elles se sont imposées au hasard des voyages
et des rencontres. Ce sont des airs simples, énergiques, émouvants. Ils racontent des
choses que les mots ne disent pas, ou plutôt que les mots disent autrement. Fanfares dit
: " il y a encore de la vie ".
Alors les sommations mortifères et moralisatrices s’éloignent un instant. Alors
faire de l’art n’entre plus en concurrence avec le chant des oiseaux, avec les
nuages, avec les navires patients à l’entrée des ports.
Capter l’énergie de ces musiques pour produire un événement théâtral, voilà ce
ce que je voudrais tenter ici.
Georges Lavaudant
Ô mon Bien ! Ô mon Beau ! Fanfare atroce où je ne trébuche point ! Chevalet féerique ! Hourra pour l’oeuvre inouïe et pour le corps merveilleux, pour la première fois ! Cela commença sous les rires des enfants, cela finira par eux. Ce poison va rester dans toutes nos veines même quand, la fanfare tournant, nous serons rendus à l’ancienne inharmonie.
Des accords mineurs se croisent, et filent, des cordes montent des berges. On distingue une veste rouge, peut-être d’autres costumes et des instruments de musique. Sont-ce des airs populaires, des bouts de concerts seigneuriaux, des restants d’hymnes publics ?
Arthur Rimbaud : Illuminations
(Extraits de Matinée d’ivresse et Les ponts)
Dans l’art contemporain, on voit se dessiner la fin de l’alternative entre la gaieté et la gravité, le tragique et le comique, la vie et la mort. Ainsi, l’art renie tout son passé, sans doute parce que cette alternative familière exprime la coupure entre le bonheur de voir que la vie continue, et le malheur, qui est le médium dans lequel elle peut justement continuer. L’art, quand il se place au-delà de la gravité et de la gaieté, peut être le signe de la réconciliation aussi bien que de l’horreur, par la démythification totale du monde. Cet art-là correspond autant à une réaction de dégoût devant l’omniprésence de la publicité franche ou clandestine en faveur de l’existence qu’à un mouvement de réticence devant le cothurne qui surélève la souffrance, prenant toujours parti pour son immuabilité. L’art n’est pas très gai de nos jours, mais il n’est pas non plus très grave, face au passé récent. On commence à se demander s’il a jamais été aussi gai que la culture veut en persuader les hommes. Il n’a plus le droit, comme la poésie de Hölderlin, qui se sentait avec l’esprit universel, d’assimiler l’expression de la tristesse avec la joie extrême. Le contenu de vérité de la joie semble aujourd’hui inaccessible. Le fait que les genres s’effilochent, que l’attitude tragique apparaît comique et le comique mélancolique, est en rapport avec cela. Le tragique se décompose, parce qu’il revendique le sens positif de la négativité, celui que la philosophie a appelé la négation positive. Il n’est pas encaissable. L’art qui avance dans l’inconnu, le seul qui soit encore possible, n’est ni gai ni grave ; mais le troisième terme est dissimulé aux regards, comme plongé dans le néant dont les oeuvres d’art avancées décrivent les figures.
Theodor Adorno : L’art est-il gai ?, 1967
(repris dans Notes sur la littérature,
1974, tr. fr. Paris, Flammarion, 1984, pp. 435-436).
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Odéon - Théâtre de l'Europe
Odéon - Théâtre de l'Europe
Place de l'Odéon 75006 Paris
- Métro : Odéon à 284 m (4/10)
- RER : Luxembourg à 472 m (B)
- Bus : Théâtre de l'Odéon à 26 m, Sénat à 90 m, Saint-Germain - Odéon à 229 m, Luxembourg à 252 m
Plan d’accès - Odéon - Théâtre de l'Europe
Place de l'Odéon 75006 Paris