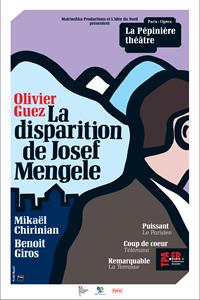La Famille royale
La Famille royale
- De : William T. Vollmann
- Mise en scène : Thierry Jolivet
- Avec : Florian Bardet, Zoé Fauconnet, Isabel Gonzales Sola, Nicolas Mollard, Thierry Jolivet, Julie Recoing, Savannah Rol, Paul Schirck, Clément Bondu, Jean-Baptiste Cognet, Yann Sandeau
La Famille royale - Photographies
- Un conte puissant et noir
Ce conte flamboyant et vénéneux nous plonge au cœur d’une métropole américaine où le cynisme des possédants a achevé de balayer les principes moraux de la multitude.
Seule la Reine des bas-fonds entretient une lueur de fraternité. Tyler, détective privé embauché par un homme d’affaires dégénéré pour infiltrer les milieux de la prostitution, nous fait passer du roman noir à ce qui pourrait être une mythologie contemporaine nourrie d’innocence, de culpabilité, d’or et de rédemption. La prose incandescente, l’incarnation viscérale des interprètes, l’humour désespéré confèrent à cette fresque des accents shakespeariens.
Les trois musiciens offrent en direct une musique rock sur des textes lyriques, le décor se déplace à haute fréquence, les huit comédiens glissent avec agilité d’un personnage à l’autre, d’un costume à l’autre. Dans cette Famille royale règne un esprit de troupe.
Par La Meute.
Roman traduit de l'américain par Claro, © Actes Sud 2006
Durée :
1ère partie : 2h10
2ème partie : 1h30
- La presse
« La gageure était de l’adapter pour la scène, et Thierry Jolivet s’en sort plus que bien, dans ce spectacle qui mêle théâtre, concert rock (...) et performance poétique. » Fabienne Darge, Le Monde, 6 octobre 2017
- Entretien avec Thierry Jolivet
Pourquoi avoir choisi de monter au théâtre ce roman de William T. Vollmann ?
Les spectacles que je fabrique sont presque toujours des adaptations d’œuvres non théâtrales, parce que je tiens à prendre ma part de l’acte d’écriture. D’ailleurs, j’ai commencé à concevoir ce projet bien avant d’avoir lu La Famille royale. Mon spectacle précédent, Belgrade, dont la problématique était liée à l’histoire de la violence politique dans l’Europe du xxe siècle, se passait en Serbie dans les années 2000, et j’avais le désir de faire avec le suivant un spectacle qui soit encore davantage en prise avec notre époque, notamment du point de vue des questions politiques qu’elle soulève. En l’occurrence, je voulais regarder le paradigme actuel, celui du néolibéralisme et de la société du spectacle, non pas comme une nécessité définitive mais comme un moment de l’Histoire. J’ai commencé à travailler à partir d’une matière essentiellement documentaire, et puis le moment est venu où j’ai eu besoin de trouver un point d’ancrage dans la littérature. Comme je l’avais fait avec l’ex-Yougoslavie pour Belgrade, j’ai alors décidé de circonscrire mes recherches à un territoire fantasmatique, celui des États-Unis. C’est ainsi que, me plongeant dans la littérature de l’Amérique contemporaine, j’ai découvert l’œuvre de Vollmann, dans laquelle j’ai trouvé le réceptacle le plus propice à accueillir le spectacle que je voulais faire, sur le plan thématique mais aussi stylistique, parce que la littérature américaine toute entière s’y trouve condensée, du roman noir au postmodernisme, du nouveau journalisme à la poésie Beat.
William T. Vollmann a enquêté sur le terrain dans les quartiers du Tenderloin et de Mission, les coins les plus chauds de San Francisco, pour nourrir son roman. Cela a pesé dans votre décision de le transposer au théâtre ?
Oui, c’est un aspect important, indéniablement. La Famille Royale est une œuvre politique, dans laquelle Vollmann restitue les rapports de violence sociale jusque dans leur plus extrême brutalité. Les personnages qu’il met en scène se situent aux deux extrémités du spectre social : le monde des affaires, du show-business, du jeu, de la finance d’une part, et d’autre part le lumpenproletariat d’une grande métropole, dans les tréfonds de laquelle gravitent prostituées, toxicomanes, délinquants, marginaux et proscrits en tout genre. Le fait que William T. Vollmann fasse, à travers eux, entrer les voix du réel dans la fiction, fonde à mon sens la légitimité de son entreprise littéraire.
Comment vous y êtes-vous pris pour adapter un livre d’une telle ampleur à la scène ; pour en restituer l’atmosphère générale ?
Ce qui m’intéressait tout particulièrement, c’était le parallélisme entre l’histoire des prostituées et celle du casino. La première est beaucoup plus développée que la deuxième dans le roman, j’ai donc dû rééquilibrer le récit de ce point de vue-là. La fracture esthétique qui sépare les deux histoires donne sa forme au spectacle, elle fonctionne comme un axe de tension du sens, qui met la dramaturgie en mouvement et structure le propos. L’économie narrative conventionnelle du théâtre a tendance à m’ennuyer le plus souvent, elle peine à se déployer à la taille du monde. Mais lorsque vous adaptez un roman, vous jouissez d’une grande liberté quant à la grammaire du récit : vous pouvez jouer sur des effets de montage, de simultanéité, d’antagonisme ou de symétrie, entremêler les espaces, les temporalités, les registres. Cela vous donne les moyens d’une véritable traversée. C’est sans doute la raison pour laquelle les spectateurs de La Famille royale ont parfois l’impression d’être au cinéma, quand bien même nous n’avons pas recours à la vidéo. Ensuite, il fallait théâtraliser le roman, c’est-à-dire le dialoguer de telle sorte que la parole elle-même soit un enjeu, un moteur, une action. Mais je tenais également à inviter la littérature, c’est-à-dire le poème, sur le plateau, c’est pourquoi il subsiste une multitude de passages narratifs, où la langue est le seul paysage. Quant à l’atmosphère proprement dite, elle trouve sa traduction théâtrale grâce à l’ensemble des outils dont nous disposons, qui malgré les apparences sont des outils pauvres, enfantins : l’énergie des acteurs, la musique jouée en direct, une machine scénographique en mouvement constant, un regard graphique sur la lumière. Il en résulte un effet d’immersion, qui là encore peut rappeler des sensations habituellement éprouvées au cinéma.
Le roman est imprégné d’une atmosphère très dense faite de violence, de cruauté, de la sexualité la plus crue, de pornographie. Comment avez-vous abordé cet aspect à la fois incontournable et difficilement représentable sur une scène de théâtre ?
La question du commerce sexuel et de sa captation par le système globalisé, à l’heure de ce supplément de mensonge que constitue la prétendue virtualité des phénomènes numériques, est l’un des thèmes majeurs du roman, parce qu’elle représente l’incarnation paroxystique de la violence que le monde marchand exerce sur les corps. Par conséquent, il était inévitable d’inclure des scènes de violence sexuelle, mais le spectacle est nécessairement beaucoup plus économe que le livre à cet égard. Tout ne peut pas être représenté littéralement sur le plateau sans donner lieu à un résultat insupportable ou ridicule. Il s’agissait donc de provoquer chez le spectateur des sensations équivalentes en faisant appel aux propriétés particulières du théâtre, et dans une économie narrative nécessairement plus réduite que dans un roman de mille pages.
Comment avez-vous travaillé un matériau aussi dense avec les acteurs ?
Chacun doit forcément assumer plusieurs rôles… En effet, c’est un spectacle monstre, lancé à grande vitesse, qui demande une véritable performance physique à ses interprètes chaque soir. Chacun incarne une multitude de rôles. À peine sortis de scène, les acteurs changent de costume et sautent à nouveau sur le plateau pour intégrer la séquence suivante ou mettre le décor en mouvement. C’est donc avant tout un spectacle de troupe, porté à part égale par huit acteurs, trois musiciens et trois techniciens. À l’origine, nous nous sommes fondés comme un collectif, ce qui implique de considérer l’acte théâtral comme une prise de parole commune. Chacun participe de son poste à la fabrication du spectacle, sans hiérarchie ni cloisonnement. Cela détermine nécessairement la nature des spectacles que nous inventons ensemble.
Propos recueillis par Hugues Le Tanneur, juillet 2017
La Famille royale – Bandes-annonces
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Théâtre de la Cité Internationale
Théâtre de la Cité Internationale
17, boulevard Jourdan 75014 Paris
- RER : Cité Universitaire à 157 m
- Tram : Cité Universitaire à 32 m
- Bus : Cité Universitaire à 227 m, Stade Charléty - Porte de Gentilly à 320 m, Jourdan - Montsouris à 358 m
Plan d’accès - Théâtre de la Cité Internationale
17, boulevard Jourdan 75014 Paris