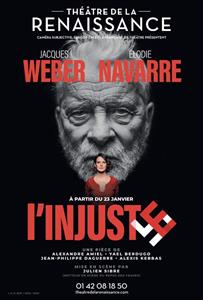La pomme dans le noir
La pomme dans le noir
- De : Clarice Lispector
- Mise en scène : Marie-Christine Soma
- Avec : Pierre-François Garel, Carlo Brandt, Dominique Reymond, Mélodie Richard
- Voyage initiatique
La romancière brésilienne la plus célèbre du XXe siècle a imaginé ce voyage initiatique d’un héros sans héroïsme, fuyant le crime qu’il a commis et se révélant à lui-même par la grâce de la rencontre de deux femmes étonnantes qui lui ouvrent le chemin. Marie-Christine Soma adapte ce texte et convie sur le plateau Carlo Brandt, Pierre-François Garel, Dominique Reymond et Mélodie Richard.
Martin a commis un crime dont on ne sait rien, seulement qu’il a transformé son rapport au monde. Martin n’a pas d’autre issue que de quitter la ville, s’enfuir, entamer sa traversée du désert. Il trouve refuge dans une ferme isolée où vivent deux femmes, Victoria et Ermelinda.
Au contact d’une nature qu’il découvre, grâce au travail imposé à son corps, ce héros involontaire s’engage sur un chemin qui va le conduire vers une redécouverte de lui-même, et de tout ce qui l’entoure. En adaptant cette oeuvre majeure de la littérature, Marie-Christine Soma veut donner vie à ces personnages nimbés de mystère, dont la rencontre inopinée se révèle porteuse d’espoir et fait entendre la voix d’une auteure qui refuse d’entrer dans le jeu des classifications entre bien et mal, entre « fous et gens raisonnables, êtres disciplinés ou subversifs, honorables ou scandaleux ». Un moment de théâtre où « tout peut arriver » dans cet univers suspendu où il est possible d’inventer un autre rapport aux êtres que nous côtoyons et au système qui nous contraint.
- Entretien avec Marie-Christine Soma
Quels sont les thèmes du Bâtisseur de ruines que vous voulez faire entendre ?
Marie-Christine Soma : En lisant le roman, on pourrait croire qu’il s’agit du parcours initiatique d’un homme. Mais, première étrangeté, ce parcours se fait grâce à deux femmes qui vont elles-mêmes s’engager dans un parcours initiatique grâce à l’arrivée de cet homme. Ce qui me plaît beaucoup, c’est donc cette idée que, dans la vie, il y a des possibilités pour changer, pour aller ailleurs, se déplacer sur d’autres chemins.
Cela rejoint d’ailleurs mon propre parcours. Ce sont les processus de transformation qui m’intéressent et je suis très admirative quand un écrivain arrive à nous amener à l’intérieur de ce mouvement de déplacement. J’aime l’idée de cette renaissance des personnages par la rencontre qu’ils font. Pour renaître, il faudra au héros traverser différents cercles : le cercle du végétal, le cercle du minéral, le cercle de l’animalité avant de rejoindre le cercle de l’humain. Il refait tout le parcours de la création avant de se recréer dans le monde humain. En ce moment où tout est exclusion dans notre monde, je trouve extraordinaire cette idée qu’un individu qui s’exclut par le crime puisse se réinscrire dans la communauté humaine. Cela prouve qu’un individu n’est pas défini par un moment de son existence, par un seul et unique acte commis mais qu’il y a toujours une possibilité de se remettre en marche. Rien n’est définitif.
Clarice Lispector circule par ailleurs dans les zones d’ombre entre masculin et féminin ?
M-C.S. : Oui et ce qui m’intéresse c’est comment cette femme romancière rentre dans la psyché d’un personnage masculin en saisissant la masculinité dans son endroit le plus intime. Cette capacité à circuler sans difficulté dans le masculin, et bien sûr le féminin, me séduit infiniment. Ayant fait un métier d’homme - éclairagiste -, j’ai moi aussi circulé sans appréhension, d’une façon assez fluide dans les deux univers. Elle n’a pas de barrière intellectuelle pour circuler dans les genres. Elle n’accorde pas une grande importance à l’appartenance à un sexe mais, par contre, elle s’intéresse fortement aux rencontres possibles entre les sexes. C’est la question de « l’être » qui la passionne. Martin, son héros, devient Homme quand il accède à sa part féminine.
Extraits des propos recueillis par Jean-François Perrier en mars 2017.
- Note d'intention
On pourrait résumer La Pomme dans le noir en quelques mots : un homme, Martin, tue, s’enfuit, et au terme de cette fuite, se trouve.
Dans sa fuite, comme dans les romans de « formation », il rencontre des épreuves : la peur, la solitude, le dénuement, le travail physique, et des êtres, deux femmes, Victoria, et Ermelinda, dont il bouleverse l’existence, et qui vont le révéler à lui-même. Cela se passe au Brésil, dans les années soixante du vingtième siècle.
La Pomme dans le noir est à la fois une quête initiatique, un apprentissage du Réel, un roman d’aventure ou un western en huis clos qui se joue des déterminismes conventionnels du masculin et du féminin. Dans son titre énigmatique, il y a le fruit symbole de la faute et du savoir. Comme chez Dostoïevski, la question de la responsabilité de l’Homme, de sa capacité de pardonner, est au centre, mais dans un monde déserté par Dieu.
Les personnages, Martin, Victoria, Ermelinda, sont des êtres éloignés de la scène sociale, chacun pour une raison différente. Martin, ce « héros » sans héroïsme, ne veut plus être le prisonnier d’un monde fait de définitions immuables, qui l’enferme dans une unique désignation. En commettant un crime, il se met lui-même au ban de la société, et donc au pied du mur. C’est un geste de colère, de révolte, une façon d’affronter seul la contingence. Il perd volontairement sa place « sociale » avec l’intime conviction que peut-être cet arrachement lui permettra de « voir » la vérité s’il accepte de tout reprendre depuis le début. Avant l’appartenance à un pays, à une langue, à un statut, à une famille. Réduit au « minimum ». Idiot.
La ferme, avec les plantes, les animaux, les paysages, constitue ce point de départ. C’est une sorte de « paradis perdu » à partir duquel Martin réapprend à voir réellement les choses, c’est-à-dire à en faire l’expérience, sans médiation, à mains nues. C’est un Nouveau Monde dont Martin est l’explorateur et où il va être possible de « construire » après avoir détruit.
Victoria et Ermelinda sont les deux « passeuses » qui vont permettre cette genèse. Elles aussi ont abandonné la ville pour se réfugier dans cette ferme isolée, l’une par volonté, l’autre par défaut. L’une est entièrement concentrée sur le travail, la maîtrise de soi et l’évitement de tout évènement nouveau. L’autre est tendue dans l’attente de l’évènement. Toutes deux vont envisager différemment le mystère que constitue l’arrivée de l’étranger.
En lisant, immédiatement, j’ai eu envie de voir s’incarner ces personnages, ils se dressaient littéralement devant moi, dans ce lieu unique de la ferme, tragiques et pleins de désirs. Leurs actes, leurs interrogations, leurs doutes, leurs élans me semblaient très proches. Martin a commis un crime. Quel est son crime ? Qu’est-ce que Le Crime ? Comment est-ce possible qu’un homme normal, civilisé, qui n’est pas un monstre, tue ? Et qu’est-ce qu’un monstre ? À ses propres yeux ? Aux yeux de la société ? Et comment réagir face à cela ? Faut-il le dénoncer ? Quelles peurs nous traversent face à celui qui a transgressé ? Quelle liberté nouvelle ouvre-t-il en nous, à notre corps défendant parfois ? Telles sont les questions que le texte nous pose.
Le mot « Crime » hante et traverse tout le texte, pendant longtemps sans être relié à un fait concret, dans un sens qui dépasse la langue de la loi et de la morale. Cet « acte » implique une obligation, une injonction, une fois celui-ci accompli, on ne peut plus reculer. Il faut avancer, s’exiler. S’exiler géographiquement, pour ne pas s’exiler de soi-même. Il y a un chemin à parcourir, avec le corps, avec les sens...Et paradoxalement une sorte de naissance.
Aujourd’hui, où nous sommes non seulement pris dans un flot permanent d’assignations et d’injonctions à être, mais aussi accablés par un retour de la loi moralisatrice, et par la misère des mots vidés de leur sens, il me semble que travailler sur cette écriture qui nous conduit librement, là où il n’y a ni genre, ni loi arrêtés, où tout est en train de se constituer, se dérobant sans cesse à l’ordre et à la maîtrise, réfutant toute logique purement binaire, est une nécessité.
Clarice Lispector, pour qui « regarder » est un acte d’amour, nous parle simplement et intimement d’ouvrir une voie qui échapperait à la division entre les hommes et les femmes, entre fous et gens raisonnables, êtres disciplinés ou subversifs, honorables ou scandaleux. Elle nous dit non pas ce qui arrive, mais le « plus ou moins » de ce qui arrive, de ce qui est difficile à raconter. Elle nous dit que le savoir n’est pas du côté du pouvoir, de la domination, mais du côté de la perte. Elle nous dit que la transgression est le geste qui vient interrompre ce qui interrompait l’existence, l’acte de passer outre, d’aller plus loin que ce qu’on croyait possible.
Comment « toucher » la pomme, la reconnaître, sans se l’approprier ? Comment accéder à une certaine forme de savoir et rester en mouvement, changer de place, de nom, de pays... Il me semble qu’il y a là quelque chose d’immensément fécond, et bienveillant. L’intensité vitale qui anime chacun des personnages éveille le désir de les inventer sur scène, en chair et en os... et de les regarder s’aventurer, essayer de comprendre ce qui leur arrive et peut-être nous réconcilier avec une part de risque et d’expérience. Alors rêvons, il fait chaud, sortant de la nuit, à l’orée d’un paradis perdu, un homme surgit, une femme droite et solitaire l’accueille, une autre jeune femme, plus loin, l’observe. Tout peut arriver...
Marie-Christine Soma, août 2016
La pomme dans le noir – Bande-annonce
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - MC93
MC93
9, bd Lénine 93000 Bobigny
- Métro : Bobigny Pablo Picasso à 472 m
- Tram : Hôtel de Ville de Bobigny à 90 m
- Bus : Hôtel de Ville de Bobigny à 84 m, Karl Marx à 176 m, Maurice Thorez à 274 m
-
Voiture : A3 (Porte de Bagnolet) ou A1 (Roissy) ou RN3 (Porte de Pantin) sortie Bobigny / centre-ville ou A86 sorties N° 14 Bobigny /Drancy.
Parking à proximité (un parking gratuit dans le centre commercial Bobigny 2 est accessible les soirs de représentation)
Plan d’accès - MC93
9, bd Lénine 93000 Bobigny