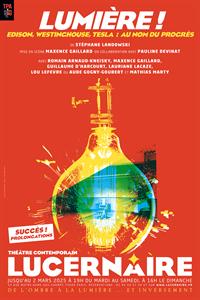Laissez-nous juste le temps de vous détruire
Laissez-nous juste le temps de vous détruire
- De : Emmanuelle Pireyre
- Mise en scène : Myriam Marzouki
- Avec : Johanna Korthals Altès, Stanislas Stanic, Pierre-Félix Gravière, Charline Grand
Laissez-nous juste le temps de vous détruire reprend le récit là où la précédente création de la compagnie, Europeana, une brève histoire du XXème siècle s’était interrompu. Le texte de Patrik Ourednik dressait une improbable épopée du siècle passé, celui d’Emmanuelle Pireyre se saisit du désarroi contemporain de la première décennie du XXIème siècle.
- Note d’intention
J’ai voulu, avec cette nouvelle création, poursuivre un travail d’auscultation des inquiétudes actuelles en passant commande d’un texte inédit. Aujourd’hui, beaucoup de préoccupations tournent autour de notre incapacité à faire spontanément, sans doutes ni angoisse, ce que des milliards d’individus ont fait avant nous : habiter, dans tous les sens du terme et à toutes les échelles possibles.
Ce motif principal de l’habitation du monde est indissociablement lié au désastre écologique, mais, au lieu de le considérer frontalement, le spectacle prend en compte les aspects secondaires et prosaïques de l’existence pour mieux faire remonter à la surface les problématiques fondamentalement humaines qui en découlent : le rapport à la pudeur, à la technique, à la culpabilité.
Laissez-nous juste le temps de vous détruire approche des figures contemporaines et ajuste la focale sur certains personnages, autant de tentatives individuelles, souvent vaines, pour donner une consistance au verbe habiter. Tous se posent la question : comment faire ? Cette interrogation traduit nos impasses face à un monde peuplé d’objets dont nous ne savons plus que faire, notre difficulté à trouver une place dans un univers où la virtualité des échanges modifie jusqu’à notre langue et nos relations, où tout effort individuel est soumis aux contraintes techniques et aux lois économiques.
Laissez-nous juste le temps de vous détruire s’ouvre dans les années 2000, lorsque Propriétaire était encore convaincu que la haie de son jardin pouvait le protéger du monde extérieur. Les fictions enchâssées dans le spectacle sont autant d’étapes pour réaliser que derrière la haie, il y a bien quelque chose, quelque chose comme la mise en crise financière du réel.
Myriam Marzouki
- Comment faire pour être heureux ?
Au début des années 2000, le bonheur individuel était encore au cœur des envies des ménages. Dans tous les pays de la zone euro, les gens bricolaient leurs petites stratégies pour être heureux. Mais le bonheur ne semble plus être la priorité des années 2010, le bonheur n’est vraiment plus le truc du moment : finie l’époque des petits questionnements personnels, de la déco, du yoga et des barbecues entre amis.
Il n’est plus temps d’être névrosés, les urgences sont ailleurs, du côté de l’eau potable, de la radioactivité, quelque part entre le compost, la pompe à chaleur et le bassin de phytoépuration. Les conditions plutôt pourries semblent désormais réunies et une seule question subsiste, obsédante : comment faire ?
Les années 2010 ont commencé. Bien-sûr, on a toujours envie d’y croire, à ce bonheur de propriétaires, à la jolie haie de jardin toute verte et aux petits bras des enfants autour de nos cous, mais derrière le barbecue, au-delà de la haie, on se demande plutôt : comment habiter le monde dans cette ambiance pressante de boîte de nuit, cette ambiance de réseaux densifiés où on a l’impression de ne jamais être seul cinq minutes ?
Myriam Marzouki
- Extraits « Et ça aujourd'hui on oublie »
« Ah la la c'était vraiment n'importe quoi
C'était le 20ème siècle
Nous étions tous comme James Dean
Nous écrasions l'accélérateur et foncions dans la nuit
Nous avions des tas d'états d'âmes
Des tas de névroses
Nous chauffions dehors… avec nos radiateurs
Nous étions comme Edith Piaf
Terrassés par l'amour
Le ciel / bleu sur nous peut s'effondrer
Et la terre peut s'écrouler
Ah la la c'était vraiment n'importe quoi
C'était le 20ème siècle
Nous passions des journées…
Nous prononcions des phrases comme…
Les / vers de terre nous dégoûtaient
Et ça aujourd'hui on oublie
Pas / question de voir la réalité en face
Et ça aujourd'hui on oublie
Ja/ mais un seul mot, un mot de nos déjections
Et ça aujourd'hui on oublie
Le ciel bleu peut bien s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler,
Peu m'importe : si tu m'aimes, je me fous du monde entier
Et ça aujourd'hui, on oublie
Et ça aujourd'hui, on oublie
Et ça aujourd'hui, on oublie
Et ça aujourd'hui…
* * * * * * * * * *
Durant les années 70, les gens demandaient aux enfants d’aller jouer dehors et de ne pas rester enfermés dans la maison, à une époque où il faisait beau, où il faisait tellement tellement beau. (...) Ce qui était dehors était alors bon pour la santé, le contact avec les arbres, les petites grenouilles faisaient du bien aux enfants, la proximité physique avec les quatre éléments, les expositions au soleil, étaient saines et fortifiantes, selon une population adulte accédant au confort à une vitesse grand V. En comparaison, l’intérieur avait l’air d’emblée sombre et étriqué.
Quelques années plus tard, dehors devint dangereux et dedans protégé.
Puis dedans devint dangereux à son tour.
Puis dehors devint radioactif. »
- La presse en parle
« Un théâtre qui informe, décrypte, qui se fait média alternatif contre les manquements du discours dominant. Un théâtre qui en d’autres termes ouvre une troisième voie et l’incarne (...) par un procédé emblématique : l’irruption d’une troisième voix Et c’est peut-être une réponse à tous ceux qui se demandent pourquoi on n’a pas vu, en France, des milliers d’Indignés se rassembler sur la place publique. Entre mille lieux possibles, le mouvement des Indignés français est ici. Dans ce théâtre qui recycle nos peurs en une énergie lumineusement vert-de-gris. » Regards
« Le rire fustigeant le jusqu’au boutisme écologique balaie tout, et crée un beau point de cristallisation et de rupture dans le spectacle qui accélère l’envol du spectacle. (..) Pied de nez conscient au « Que faire ? », récusation du « Comment faire ? », appel à l’imagination et à l’esprit critique du spectateur, une belle fin ouverte. » Au poulailler
Laissez-nous juste le temps de vous détruire – Bande-annonce
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Maison de la Poésie
Maison de la Poésie
Passage Molière - 157, rue Saint Martin 75003 Paris
- Métro : Rambuteau à 157 m, Etienne Marcel à 267 m
- RER : Châtelet les Halles à 365 m
- Bus : Grenier Saint-Lazare - Quartier de l'Horloge à 106 m, Réaumur - Sébastopol à 381 m
Plan d’accès - Maison de la Poésie
Passage Molière - 157, rue Saint Martin 75003 Paris