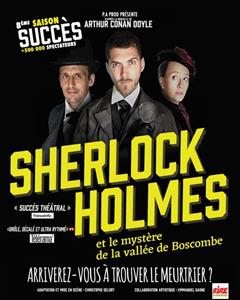Le dernier jour d'un condamné
Le dernier jour d'un condamné
- De : Victor Hugo
- Mise en scène : François Duval
- Avec : François Duval
Présentation
« Je vote l'abolition pure et
simple et définitive de la peine de mort* »
Mise en scène de la lecture
Le dernier jour d'un condamné est un plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Nous ne connaissons ni le nom, ni le visage, ni même le crime de l'homme qui se prépare à mourir. Hugo pose la question de vie et de mort, là où il faut la poser, là où elle est réellement "dans son vrai milieu, dans son milieu horrible, non au tribunal, mais à l'échafaud, non chez le juge mais chez le bourreau" ; il pose cette question sur la ligne médiane, fragile, sensible d'un monde de l'entre-deux tiraillé entre ces deux pôles dépersonnalisés et déshumanisés que sont le parquet et la guillotine. Le poète donne chaire et sang à la douleur intellectuelle. Il humanise.
François Duval
- « Je vote l'abolition pure et simple et définitive de la peine de mort* »
Le dernier jour d'un condamné n'est pas la défense particulière, et donc nécessairement transitoire, d'un criminel. C'est un plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Nous ne connaissons ni le nom, ni le visage, ni même le crime de l'homme qui se prépare à mourir. De cet homme, nous ne connaissons que la fébrilité, l'angoisse et l'errance psychologique, car Victor Hugo pose la question de vie et de mort, là où il faut la poser, là où elle est réellement « dans son vrai milieu, dans son milieu horrible, non au tribunal mais à l'échafaud, non chez le juge mais chez le bourreau » (**). Il pose cette question sur la ligne médiane, fragile, sensible d'un monde de l'entre-deux, tiraillé entre ces deux pôles dépersonnalisés et déshumanisés que sont le parquet et la guillotine. Le poète donne alors chair et sang à la douleur intellectuelle, il humanise.
Alors, la peine de mort n'est plus une abstraction car Hugo donne la parole à celui qui va mourir. Le dernier jour d'un condamné, ce sont les six dernières semaines de vie d'un homme qui s'empresse de les écrire, jusqu'à ce qu'au pied de l'échafaud, il en soit physiquement empêché. Ce livre est, en quelque sorte, le compte rendu journalistique de la tempête, de la lutte, de la révolution qui s'opère en lui. Il est dans l'urgence, urgence de vivre et de dire. Il couche sur le papier son angoisse pour mieux l'analyser, pour mieux la contenir surtout, et pour convaincre. Convaincre de l'ignominie d'un crime qu'il fait commettre à la société : « Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer, cette histoire nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible, de mes sensations, ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement. N'y aura-t-il pas dans ce procès-verbal de la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent ? »
Car finalement la société ne doit ni punir ni se venger. Dans la préface du Dernier jour d'un condamné de 1832, à ceux qui militent pour la peine de mort, pour une société qui se venge et qui punit, Hugo répond : « Se venger est de l'individu, punir est de Dieu. La société est entre les deux. Le châtiment est au-dessus d'elle, la vengeance au-dessous. Rien de si grand ni de si petit ne lui sied. Elle ne doit pas punir pour se venger, elle doit corriger pour améliorer. »
Marie-Lise Bonnafoux
* Extrait du discours de Victor Hugo à l'Assemblée - 1848
** Extrait de la préface du Dernier jour d'un condamné - 1832
Lorsque j'ai dû imaginer la mise en espace du Dernier jour d'un condamné, je me suis trouvé confronté à la situation étrange que fait naître l'exercice même de la lecture : celle qui veut que je sois un porte-parole, position particulière, ni auteur, ni tout à fait narrateur, ni même tout à fait un lecteur banal.
J'étais dans la position privilégiée d'être, physiquement, au centre de ce carrefour d'absence qu'est la littérature. C'est ce lieu particulier où se rend le lecteur que j'ai voulu créer par la mise en scène. Une reconstruction réaliste du décor, c'est-à-dire la reconstitution d'un cachot, par exemple, aurait daté le texte et donc nécessairement limité sa dimension universelle et intemporelle. C'est un lieu de mémoire que j'ai voulu créer, dans lequel les papiers laissés par le condamné sont le seul témoignage de son passage.
Lorsqu'il commence à écrire, il s'interroge, « peut-être n'ont ils jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente succession de tortures que renferme la forme expéditive d'un arrêt de mort ! Se sont-ils jamais arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'ils retranchent, il y a une intelligence ; une intelligence qui avait compté sur la vie, une âme qui ne s'était point disposée pour la mort ! Non. Ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire. (…) Ces feuilles les détromperont. Publiées peut-être un jour, elles arrêteront quelque moment leur esprit sur les souffrances de l'esprit ; car ce sont celles-là qu'elles ne soupçonnent pas. (…) A moins qu'après ma mort, le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillés de boue, ou qu'ils n'aillent pourrir à la pluie, collés en étoile à la vitre cassée d'un guichetier. »
Ces papiers sont dispersés sur le sol et sur deux des trois éléments qui composent la scénographie : un petit tabouret et un escabeau, tous deux en bois. Les papiers sont découverts et lus selon les déplacements qu'impose la mise en scène, soit de façon apparemment aléatoire. J'ai en effet choisi, non de trancher entre les différents rôles face auxquels je me trouvais confronté - auteur, narrateur, lecteur ou même acteur - mais de mettre en scène cette polyphonie liée à la lecture. Mon idée est de jouer le rôle d'un personnage porte-parole qui revient sur le lieu de l'écriture et qui, découvrant "l'autopsie intellectuelle" du condamné va peu à peu s'en imprégner. La dualité de ce jeu me permet de garder la juste distance par rapport au texte pour ne pas totalement incarner le personnage tout en lui conservant sa part d'humanité. Le dernier élément de la scénographie est une servante de scène, choix à la fois esthétique et symbolique, puisque la servante est la lumière de service que l'on pose sur le plateau une fois la représentation terminée et que l'on retire avant la représentation suivante. A l'image du monde de "l'entre-deux" dépeint par Hugo correspondent lumière et lecture, toutes deux précédant le spectacle.
François Duval
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Lucernaire
Lucernaire
53, rue Notre Dame des Champs 75006 Paris
- Métro : Notre-Dame des Champs à 166 m, Vavin à 234 m
- Bus : Bréa - Notre-Dame-des-Champs à 41 m, Notre-Dame-des-Champs à 129 m, Guynemer - Vavin à 161 m, Vavin à 235 m, Rennes - Saint-Placide à 393 m
Plan d’accès - Lucernaire
53, rue Notre Dame des Champs 75006 Paris