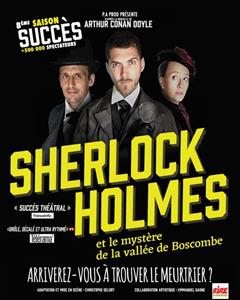Le songe
Le songe
« l’enfant de ma plus profonde douleur »
Note de mise en scène
Extrait d’interview d’August Strindberg
Genèse de la pièce
Texte du programme du Théâtre Alfred Jarry
Strindberg le rêveur
Jacques Osinski se sent proche des écrivains nordiques et des forces obscures qui assaillent leurs personnages. Après La Faim de Knut Hamsun et L’Ombre de Mart de Stig Dagerman, il aborde Strindberg avec sa pièce la plus riche et la plus complexe : Le Songe.
« C’est celle de mes pièces que j’aime le plus, l’enfant de ma plus profonde douleur », écrivait-il le soir de la première représentation, le 17 avril 1907. Le Songe, fait partie comme Le Chemin de Damas, ou La Grand route, des « drames itinéraires » mais c’est surtout du côté des rêves qu’il faut la classer. Strindberg, qui disait qu’il avait l’impression d’être un somnambule, a donné à sa pièce chargée de douleurs intimes la forme d’un rêve, incohérent et logique en même temps, dont la continuité est assurée par le rêveur.
Agnès, fille du dieu Indra, descend parmi les hommes pour rendre compte de l’état du monde, elle découvre la douleur de vivre. Mais la réalité n’est elle pas seulement un rêve comme l’affirme la religion hindoue ?
Le Songe fut créé en France par Antonin Artaud au Théâtre Alfred Jarry lors de deux représentations houleuses en juin 1928. Pour Jacques Osinski, cette pièce est un formidable champ d’expérimentation scénique, un texte dont chaque mot, chaque phrase, chaque rencontre d’Agnès, suscite de nouvelles formes et de nouvelles images.
Le Songe est publié aux éditions de l’Arche, traduction Carl Gustaf Bjurström et André Mathieu.
Après avoir travaillé sur l'Ombre de Mart de Stig Dagerman et La Faim de Knut Hamsun, je retrouve avec Le Songe de Strindberg un répertoire nordique qui m'est familier. Le Songe était l'une des pièces préférées de Strindberg. Plus étrange, moins connue que certaines de ses autres pièces, Le Songe offre au metteur en scène, libéré des conventions naturalistes, un espace de liberté sans limite.
Écrite selon la logique du rêve, Le Songe n'obéit plus à aucune règle de narration classique. Tout y est éclaté, fragmenté. Le temps et l'espace n'existent plus. Les personnages et les lieux se dédoublent, se démultiplient. Pourtant, « une conscience les domine tous, celle du rêveur » écrit Strindberg. Nous assistons au rêve du rêveur-poète et le voyons à l'oeuvre.
Pourtant le quotidien a également une part importante dans Le Songe tout comme une certaine dimension comique trop souvent négligée. Le monde fantastique du Songe relève de la réalité. Ses moindres détails se retrouvent dans la vie de l'auteur : le château qui pousse est la caserne que Strindberg voyait depuis sa fenêtre, la porte au trèfle, celle du Théâtre Dramatique de Stockholm où Strindberg avait coutume d'attendre sa troisième épouse, Harriet Bosse, celle-là même qui lui inspira la pièce...
Cette cohésion de la réalité et de l'imaginaire forme tout l'enjeu de ma mise en scène.
Il s'agit d'éviter tout à la fois deux écueils : celui d'un trop grand matérialisme et celui
de la « magie », d'un lyrisme exacerbé. C'est pour cela que nous afficherons la réalité
du lieu-théâtre dans lequel se déroule la pièce. Il s'agit de jouer avec l'architecture du
lieu, d'éviter tout mensonge, toute « féerie ». Nous chercherons à atteindre une certaine
fluidité, une légèreté, une certaine « dématérialisation », selon le mot même de
Strindberg, cela grâce à un décor fait de toiles et d'images vidéo, construit en intimité
avec la lumière, un décor léger et mouvant qui serait tout à la fois toujours le même et
toujours un autre. Il s'agit de récréer l'espace mental du rêve.
C'est dans cet espace qu'évolue Agnès dont la mise en scène s'attachera à souligner la singularité. Agnès est différente. Fille du dieu Indra, elle descend sur terre vivre parmi les hommes. Son cheminement initiatique dresse le constat désabusé de l'état du monde. Inhumaine, étrangère parmi les hommes, Agnès regarde, ressent, enregistre, telle une caméra, les oscillations des sentiments. Véritable personnage-spectateur, elle établit une radiographie de la planète. Envoyée d'en haut, elle enquête sur la misère humaine. Son constat d'échec est sans appel. « Je sens à présent toute la douleur de vivre. C'est donc ainsi que sont les hommes ». Agnès remonte sur Jupiter. En ce sens, elle évoque aussi la recherche mystique de Strindberg qui chercha Dieu sans réussir à le trouver. Agnès incarne l’unité de la pièce. Elle est son fil directeur. Autour d'elle, les autres comédiens forment une ronde mouvante, un choeur de figures changeantes.
Le Songe est un formidable champ d'expérimentation scénique pour le metteur en scène. Elle est comme un condensé de tout ce que le théâtre permet. Chaque mot, chaque phrase suscite de nouvelles formes, de nouvelles images. Je pense au Dreyer d'Ordet, à son réalisme sacré mais aussi à un choral de Bach. Il s'agit de trouver une unité dans le fragment, d'atteindre à une épure intransigeante. Il s’agit de dire, sans pathos, le malheur du monde, le grotesque de l‘existence. Agnès observe, immuable, les acteurs qui s’agitent sur le théâtre de la vie.
Jacques Osinski, septembre 2005
Quel est votre souvenir d'enfance le plus marquant ?
Tout ce que j'ai vécu, enfant, m'a fait une forte impression, car j'étais hypersensible à la fois à mes propres souffrances et à celles des autres. On n'osait pas, par exemple,
punir mes cadets, en sorte que je puisse l'entendre ou le voir, car je me serais entremis
et j'aurais étranglé les bourreaux. Les outrages et les injustices m'offensaient à tel
point qu'à l'âge de sept ou huit ans (je ne me souviens pas très bien) j'ai voulu m'ôter
la vie. Je pleurais pour tout, ce qui m'a valu un méchant sobriquet ; parfois je pleurais « pour rien » ou de douleur d'être au monde ; peut-être devinais-je mon horrible destinée.
Je suis né avec l'amour de la vérité et de la justice ; mais on m'accusait d'être envieux, si je désapprouvais que quelqu'un de moins méritant me fût préféré ; et on m'accusait d'esprit de vengeance, si je n'oubliais pas sur le champ toute injure, alors que les autres ne me pardonnaient jamais. Pour corriger mon propre comportement, j'observais d'un oeil attentif les autres. Ce que d'autres se permettaient, je me le jugeais permis, mais il n'en était pas ainsi : ils étaient toujours plus sévères pour moi. Cela dit je n'étais nullement sans défauts ; j'ai menti quelquefois, par peur, par lâcheté, par honte, mais j'en eus de tels remords que je ne recommençai pas volontiers.
On m'a obligé, par la torture, à commettre mon premier grand mensonge, lorsqu'en mentant j'ai dû me charger de la faute d'un autre. Une autre fois, par contre, j'ai dit une chose qui n'était pas vraie, par simple caprice ou par suite d'une inspiration diabolique que je ne saurais expliquer. J'ai volé des fruits aussi, bien entendu (ce vieux pommier revient toujours !), mais, chose surprenante, celui qui m'a dénoncé était mon complice ; et, chose incompréhensible, je ne l'ai pas dénoncé pour rejeter ma faute sur lui. Pourquoi, je ne le sais pas, car je n'étais pas généreux à ce point ; peut-être avais-je honte pour lui, trouvant son action tellement vile, du moment qu'il avait participé au vol. Quand ma mère m'a grondé et s'est mise à parler de la police et des tribunaux, j'ai été pétrifié d'horreur ; mais aussi d'étonnement qu'il puisse exister une telle sévérité pour quelques prunes.
Voici brièvement les circonstances. Nous habitions une ferme dont les terres très vastes étaient occupées par des cultures de tabac et des prairies. Assez loin de la maison, le voisin avait un verger avec des pruniers, longeant notre barrière par-dessus laquelle se penchaient des branches de ces beaux arbres. Le voisin était un vieux bonhomme, sans enfants, qui ne se rendait jamais dans son verger, mais laissait les fruits tout jaunes là où ils tombaient, peut-être de peur du choléra de 1854, où les prunes acquirent une mauvaise réputation et furent interdites au marché de Munkbron à Stockholm. Eh bien les arbres tendaient leurs branches par-dessus l'enclos, les prunes tombaient sur le sol chez nous ; nous avons commencé à ramasser des fruits par terre, puis nous sommes passés aux arbres, ouvertement et sans nous cacher.
Je comprends aujourd'hui la peur de ma mère, car si nous étions tombés sur un propriétaire mesquin, nous risquions la police. Cependant (je peux le dire aujourd'hui que j'ai soixante ans) lorsqu'à l'âge de vingt ans, je revins, étudiant, dans cette ferme, je trouvai que justement ce prunier-là s'était desséché et pas les autres. Cela m'a fait une vive impression, une impression terrible, car j'en vins à penser au figuier maudit par le Christ.
L'impression la plus forte de mon enfance est naturellement la mort de ma mère et le comportement de ma marâtre, avant que l'année de deuil se soit terminée. C'était indescriptible. Ma mère ne m'a pas aimé, elle avait d'autres favoris parmi les enfants, mais je la pleurai, et j'ai eu le sentiment d'avoir cessé avec sa mort d'appartenir à la même famille que mon père et mes frères et soeurs, je me sentais étranger à toute la race humaine. Mon père m'a toujours fait l'impression d'une puissance hostile, et il ne me supportait pas non plus ! Ce n'est pas gai d'être jeune ! - Cela suffit !
Comment se fait-il que vous ayez choisi de débuter comme auteur dramatique ?
C’est difficile à dire ! Mais quand j'étais adolescent j'avais en vain essayé d'écrire
des vers ; je suis allé au théâtre pour devenir comédien ; j'ai échoué à l'examen, j'ai
pris de l'opium pour me suicider, mais on m'a trouvé sur mon sofa encore en vie et
on m'a fait sortir de la pièce. Le lendemain j'ai été pris d'une étrange fièvre ; et en
deux jours, j'ai écrit une pièce en deux actes. Dans l'espace de deux ou trois mois
j'avais écrit une pièce en trois actes, une pièce en vers en cinq actes (Hermione) et
commencé un grand drame sur le Christ, que j'ai cependant brûlé avant de l'achever.
J'ai trouvé qu'il était plus facile d'écrire des drames ; les hommes et les événements prenaient forme, s'entrecroisaient et ce travail m'a donné une telle jouissance que j'ai trouvé que l'existence était une pure béatitude, tant que le travail de l'écriture se poursuivait, et il en est encore aujourd'hui. Ce n'est qu'alors que je vis ! [...]
August Strindberg,
Entretien avec C.G. Bjurstrom
Obliques n° 1 - 1975
Le Songe est avec Maître Olof et Mademoiselle Julie la pièce dont Strindberg lui-même était le plus fier, conscient de ce que chacune d'elles avait de neuf et aussi de durable. « C'est celle de mes pièces que j'aime le plus, l'enfant de ma plus profonde douleur », écrivait-il à son traducteur allemand, Schering, le soir même de la première représentation, le 17 avril 1907.
Elle est née en effet sous le signe de la discorde qui n'avait pas tardé à éclater dans son mariage avec Harriet Bosse, qui avait près de trente ans de moins que lui. Ils s'étaient mariés le 6 mai 1901 et il était entendu qu'ils partiraient en voyage de noces, dès que Strindberg aurait terminé la pièce qu'il avait en chantier, Charles XII.
Il y mit la dernière main le 23 juin, mais le 26 il annonça à sa jeune femme que « les puissances » lui interdisaient de quitter son pays. La maison qu'il avait coutume de louer à Furusund, dans l'archipel de Stockholm, n'était plus libre. Le soir Harriet Bosse partit seule, « sans dire adieu, sans dire où ! Quelle nuit de chagrin ! » Il apprit bientôt qu'elle se trouvait à Hornbaeck au Danemark et le 2 juillet il l'y rejoignit. C'est pendant ces journées de solitude qu'il termina les derniers tableaux de la troisième partie du Chemin de Damas et qu'il écrivit la première esquisse du Songe, intitulé alors « Le Drame du couloir ».
Il reprit son projet au lendemain de la crise suivante, qui éclata peu après leur retour à Stockholm le 7 août. Le 8 Strindberg s'était remis au travail, attaquant une nouvelle pièce historique, Engelbrekt. Le 9, le médecin confirma que la jeune femme était enceinte. Le 21 nouvelle dispute, Strindberg s'emporte et Harriet Bosse le quitte cette fois elle reste absente pendant quarante jours. Strindberg continue péniblement et sans inspiration à travailler à Engelbrekt, terminé le 3 septembre et entame aussitôt une nouvelle pièce historique, la Reine Christine : c'est un des plus séduisants et des plus inquiétants portraits de femme qu'il ait tracés, à la fois une revanche sur l'absente et une déclaration d'amour. L'actrice Harriet Bosse devait en tirer plus tard son profit : ce fut un de ses meilleurs rôles, fait « sur mesure ».
Le 6 septembre Strindberg note : « Pour la première fois ces dernières années la pensée du suicide se présente... Je me sens impur à travers elle. Des hommes étrangers me souillent du regard dont ils la souillent. » Le 8, il la revoit chez son beau-frère, mais s'en va parce qu'elle lui semble « fausse et intrigante ». Le 13 elle vient le voir c'est l'occasion d'une nouvelle dispute. Le 16 Strindberg fait son testament. Le 23 réconciliation ! Le jour même il termine la Reine Christine.
Ce n'est cependant que le 5 octobre qu'Harriet Bosse revient au foyer. Tout semble s'apaiser. Strindberg est heureux, comme toujours quand sa femme attend un enfant, et plein de prévenance. Mais la blessure sans doute est trop profonde pour aisément se refermer. Le 6 septembre il notait dans son Journal : Cette histoire d'amour, pour moi si grande et si extraordinairement belle, et qui s'en allait maintenant en dérision, m'a pleinement convaincu que la vie est une illusion et que les histoires les plus belles, qui s'en vont comme des bulles de savon dans l'eau sale de la lessive, sont faites pour nous inspirer le dégoût de la vie. Nous ne sommes pas chez nous ici, et nous sommes trop bons pour cette misérable existence... Les hommes ne sont pas nés méchants, mais la vie les rend méchants. Alors la vie ne peut plus être une éducation, ni une punition (qui nous améliore) mais seulement un mal.
C'est dans cet état d'esprit, mais plein aussi de résignation, de tendresse et d'indulgence envers celle qui attend son enfant, qu'il reprend la pièce esquissée trois mois plus tôt et qu'il la termine. Elle, porte alors encore le nom de « Château qui pousse ». Le prologue est ajouté en 1906 seulement, et semble avoir pour principal but de contrebalancer ou de justifier la fin.
Strindberg a lui-même muni sa pièce d'un avertissement : dans ce « jeu de rêve » qui se rattache au jeu de rêve précédent, Le Chemin de Damas, l'auteur a cherché à imiter la forme incohérente mais apparemment logique du rêve. Tout peut arriver, tout est possible et vraisemblable. Temps et espace n'existent plus. A partir d'une base réelle insignifiante, l'auteur donne libre cours à son imagination qui multiplie les lieux et les actions en un mélange de souvenirs, d'expériences vécues, de libre fantaisie, d'absurdités et d'improvisations.
Les personnages se dédoublent et se multiplient, s'évanouissent et se condensent, se dissolvent et se reconstituent. Mais une conscience suprême les domine tous celle du rêveur. Pour lui il n'existe pas de secrets, pas d'inconséquences, pas de scrupules, pas de lois. Il ne juge pas, il n'acquitte pas, il ne fait que relater un rêve. Comme le rêve est plus souvent douloureux que joyeux, une note de mélancolie et de compassion envers tout ce qui vit traverse le récit chancelant. Quoique libérateur, le sommeil se révèle souvent pénible, mais au moment où la souffrance est la plus intense, le réveil soudain réconcilie celui qui souffre avec la réalité, qui bien que douloureuse apparaît alors comme une délivrance en comparaison du cauchemar. [...]
Carl Gustav Bjurstrom, Revue Obliques - 1975
Le Songe de Strindberg fait partie de ce répertoire d'un théâtre idéal, constitue une de ces pièces types dont la réalisation est pour un metteur en scène comme le couronnement d'une carrière. Le registre des sentiments qui s'y trouvent traduits, rassemblés, est infini. On y retrouve à la fois le dedans et le dehors d'une pensée multiple et frémissante. Les plus hauts problèmes y sont représentés, évoqués en une forme concrète en même temps et mystérieuse. C'est vraiment l'universalité de l'esprit et de la vie dont le frissonnement magnétique nous est offert et nous empoigne dans le sens de notre humanité la plus précise et la plus féconde. La réussite d'une représentation semblable sacre nécessairement un metteur en scène, un directeur.
Le Théâtre Jarry se devait de monter une telle pièce. On connaît la raison d'être et le principe de cette nouvelle compagnie. Le Théâtre Jarry voudrait réintroduire au théâtre le sens, non pas de la vie, mais d'une certaine vérité sise au plus profond de l'esprit. Entre la vie réelle et la vie du rêve il existe un certain jeu de combinaisons mentales, des rapports de gestes, d'événements traduisibles en actes et qui constituent très exactement cette réalité théâtrale que le théâtre Jarry s'est mis en tête de ressusciter.
Le sens de la réalité véritable du théâtre s'est perdu. La notion de théâtre est effacée des cervelles humaines. Elle existe pourtant à mi-chemin entre la réalité et le rêve. Mais tant qu'elle n'aura pas été retrouvée dans son intégrité la plus absolue et la plus féconde, le théâtre ne cessera pas de péricliter. Le théâtre actuel représente la vie, cherche par des décors et des éclairages plus ou moins réalistes à nous restituer la vérité ordinaire de la vie, ou bien il cultive l'illusion et alors c'est pire que tout. Rien de moins capable de nous illusionner que l'illusion d'accessoire faux, de carton et de toiles peintes que la scène moderne nous présente. Il faut en prendre son parti et ne pas chercher à lutter avec la vie. Il y a dans la simple exposition des objets du réel, dans leurs combinaisons, dans leur ordre, dans les rapports de la voix humaine avec la lumière toute une réalité qui se suffit à elle-même et n'a pas besoin de l'autre pour vivre. C'est cette réalité fausse qui est le théâtre, c'est celle-là qu'il faut cultiver.
La mise en scène du Songe obéit donc à cette nécessité de ne rien proposer aux regards du public qui ne puisse être utilisé immédiatement et tel quel par les acteurs. Personnages à trois dimensions que l'on verra se mouvoir au milieu d'accessoires, d'objets, au milieu de toute une réalité également à trois dimensions. Le faux au milieu du vrai, voilà la définition idéale de cette mise en scène. Un sens, une utilisation d'un ordre spirituel neuf donné aux objets et aux choses ordinaires de la vie.
Le 2 juin 1928
Depuis plusieurs années j'ai pris des notes sur tous mes rêves, et j'en suis arrivé à cette conclusion : que l'homme mène une existence double, que les imaginations, les fantaisies, les songes possèdent une réalité. Si bien que nous sommes tous des somnambules spirituels, que pendant le sommeil nous commettons des actes qui, de par leur nature différente, nous poursuivent dans l'état de veille, avec la satisfaction ou la mauvaise conscience, la peur des conséquences. Et il me semble, pour des raisons que je me réserve le droit d'exposer une autre fois, que la manie dite de persécution est bien fondée sur des remords qui succèdent aux mauvaises actions commises pendant le « sommeil », et dont les souvenirs brumeux nous hantent. Et que les fantaisies de poète si méprisées par les esprits bornés sont bel et bien des réalités. [...]
Je lis dans un livre un passage sur les doctrines de la religion hindoue. Le monde entier n'est qu'illusion. La force divine originelle s'est laissée séduire par Maya, ou l'instinct de reproduction. Ainsi la matière divine originale a-t-elle commis un péché envers elle-même. (L'amour est un péché ; c'est pourquoi les souffrances de l'amour constituent l'enfer le plus terrible qui soit.) Le monde n'existe donc que par le péché, si tant est qu'il existe. - Car il n'est qu'une image vue dans le rêve (c'est pourquoi mon songe est une image de la vie), un fantôme qu'il appartient à l'ascèse d'anéantir.
Mais cette tâche entre en conflit avec l'instinct amoureux et le résultat est une hésitation continuelle entre le tumulte de la volupté et les affres de la pénitence ! - Cela me semble être la solution de l'énigme du monde ! - J'ai trouvé ce que je viens de relater dans l'Histoire de la Littérature, au moment de terminer mon « jeu de rêve », le Château qui pousse. C'était le matin du 18. Mais ce matin j'ai vu le château (= la caserne de la garde à cheval) comme illuminé par le soleil levant. Maintenant la « religion hindoue » m'a donné l'explication de mon jeu de rêves et la signification de la fille d'Indra, le Secret de la Porte = le Néant. Toute la journée j'ai étudié le bouddhisme. [...]
Je me fais l'impression d'un somnambule ; c'est comme si l'imagination et la vie se mélangeaient. Je ne sais pas si Père est imagination ou si ma vie l'a été ; mais il me semble que cela m'apparaîtra bientôt, à un moment précis, et que je m'écroulerai alors soit dans la folie et les remords, soit dans le suicide. Par abus d'imagination ma vie est devenue la vie d'une ombre ; j'ai l'impression de ne plus marcher sur terre mais de flotter sans poids dans une atmosphère composée non d'air mais de ténèbres. Si la lumière entre dans ces ténèbres, je tomberai, anéanti.
Il est étrange également que dans un rêve nocturne qui revient souvent, je me sente voler, sans poids, je le trouve tout naturel, et toutes les notions de bien et de mal, de vrai ou faux sont alors dissoutes chez moi, et tout ce qui arrive, si insolite soit-il, me semble comme il se doit. [...]
Strindberg - Légendes
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Théâtre de la Cité Internationale
Théâtre de la Cité Internationale
17, boulevard Jourdan 75014 Paris
- RER : Cité Universitaire à 157 m (B)
- Tram : Cité Universitaire à 32 m (T3a)
- Bus : Cité Universitaire à 227 m, Stade Charléty - Porte de Gentilly à 320 m, Jourdan - Montsouris à 358 m
Plan d’accès - Théâtre de la Cité Internationale
17, boulevard Jourdan 75014 Paris