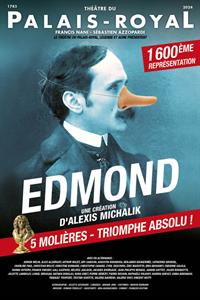Mayday
Mayday
- De : Dorothée Zumstein
- Mise en scène : Julie Duclos
- Avec : Maëlia Gentil, Vanessa Larré, Marie Matheron, Alix Riemer, Bino Sauitzvy
Audiodescription mardi 7 et dimanche 12 mars 2017.
- La matière sombre de la mémoire
En 1968, la journaliste anglaise Gitta Sereny assiste au procès de Mary Bell, meurtrière à l’âge de 11 ans de deux petits garçons. Elle écrit alors un livre, Meurtrière à 11 ans.
Des années plus tard, elle rencontre Mary Bell, dix sept ans après sa sortie de prison. Mary accepte de témoigner, de raconter son histoire, ses souvenirs, tout ce qu’elle peut en dire, tout ce qui lui revient. Le livre s’appelle Une si jolie petite fille.
Dorothée Zumstein s’est inspirée de ce fait divers pour écrire MayDay. Elle a lu les livres de Gitta Sereny, s’est rendue à Scotswood, petite ville du nord de l’Angleterre où se sont déroulés les faits, pour voir, sentir, s’imprégner. De cette démarche documentaire est née une écriture non réaliste, proche parfois du poème.
Dorothée Zumstein a d’abord procédé comme une enquêtrice, pour tirer finalement de cette histoire une pièce, aux lignes pures et essentielles.
- La presse
« Julie Duclos, qui s’affirme comme une metteuse en scène de talent, sait créer une atmosphère au réalisme tissé d’onirisme, et peaufine une belle écriture scénique, notamment dans le dialogue entre théâtre et vidéo. Les quatre actrices sont dans l’ensemble excellentes. » Fabienne Darge, Le Monde, 27 février 2017
- Le texte
Je ne sais pas, au moment où je lis la pièce pour la première fois, qu’elle s’inspire d’un fait réel. Évoquons l’histoire telle que je la découvre dans un premier temps, une femme, Mary Burns, a commis un meurtre dans son enfance, à l’âge de 11 ans, elle a tué deux petits garçons plus jeunes qu’elle, a été jugée et condamnée, puis est sortie de prison, et a dû changer d’identité pour fuir les journalistes.
Quand la pièce commence, Mary a 40 ans, elle a eu à son tour une petite fille, et vit difficilement avec les fantômes de son passé. Pour échapper à ses cauchemars, elle finit donc par accepter de faire une interview, pour parler de son histoire. Cette interview est le pilier de la pièce, sa raison d’être. Prenant la chronologie à rebours, MayDay évoque le procès de Mary, et assigne trois générations de femmes à comparaitre.
Mary à 10 ans, sa mère, la mère de sa mère. La pièce s’apparente alors à une gigantesque interview, comme si la parole de Mary faisait apparaître toutes ces voix. Parfois on ne sait plus quelle est la part du souvenir, de l’imagination, ou du rêve, ce n’est plus la question, il s’agit d’une remontée libre et sauvage dans un temps, où toutes les temporalités au présent coexistent.
- La forme
Au moment où je découvre la pièce, je ne connais pas encore le théâtre de Dorothée Zumstein, MayDay est sa deuxième pièce. Ce qui me frappe, en premier lieu, c’est l’écriture, ou plutôt la structure de la pièce. C’est une oeuvre totalement explosée, fragmentée. La dramaturgie de MayDay fait écho, de façon immédiate, à ma façon de travailler. La pièce ne raconte pas une histoire, mais tourne autour pour en livrer des bribes, des instantanés, des images. Des fragments.
Dans MayDay, une interview projetée en vidéo constitue le fil rouge de la pièce, créant un dialogue constant avec le plateau. Ce type de dramaturgie m’intéresse, le montage vidéo/plateau fut au coeur des Fragments d’un discours amoureux mon premier spectacle, et de Nos Serments, créé en 2014.
Dans la pièce, il y a aussi des portraits en mouvement de femmes sur plusieurs générations, pensée pour le livre de Nancy Huston Lignes de faille. L’interview où Mary évoque son passé fait littéralement apparaître d’autres figures féminines, qui successivement nous parlent. Mary enfant, sa mère, puis sa grand mère. La forme de ces récits, leur agencement chaotique, sans continuité logique ou psychologique me frappe. Chacune parle tour à tour au spectateur pour témoigner de son histoire, dans un espace temps différent de celui de Mary, dont nous suivons en direct l’interview.
- Interview de Mary
« Mais si elle est devenue ce qu’elle est devenue (Temps) C’est parce que je suis née Elle avait dix sept ans vous savez quand elle m’a eue.
Betty : Je l’ai su tout de suite Non... L’enfant n’avait pas ouvert les yeux Que je le savais déjà. Débarrassez moi de ça ! Je savais qu’elle apporterait que du malheur Je savais L’enfant n’avait pas encore vu le jour, Que je le savais. »
Si nous étions au cinéma, nous dirions que ce type de raccord, au sens du montage opéré par Zumstein dans son écriture, est non réaliste. Mary évoque un moment de l’histoire dont elle ne peut se souvenir, elle vient de naître. Cette évocation nous propulse dans un récit de Betty au moment de sa naissance, que Mary n’a sans doute jamais entendu, mais dont son corps a conservé la mémoire.
MayDay parle de l’invisible, nous rappelle que nous sommes faits aussi de ce que nous ignorons, d’événements qui nous ont précédés, et que nous portons. La pièce parle de la mémoire comme d’une chose plus vaste que le souvenir : pour Mary, accepter de faire cette interview, c’est replonger dans sa mémoire, c’est à dire dans une matière infinie, inconnue d’elle même. Parfois des souvenirs précis reviennent, d’autres fois, comme dans un film de David Lynch, ou comme dans un rêve, ou comme dans Alice au pays des merveilles, une porte s’ouvre, on verra que toute la pièce est centrée autour de ce geste d’ouvrir une porte, et cela fait apparaître des visions, dont on ne sait plus d’où elles viennent, ni pourquoi elles surgissent.
Dans MayDay, la mémoire est une matière sombre où les images s’entremêlent, à ciel ouvert, éclosent comme des bulles dans le temps, par associations.
On pourrait imaginer que la pièce de Dorothée Zumstein est une spirale porteuse d’images, qui tourne autour d’un événement, aspirant tout sur son passage. J’ai lu ensuite l’entièreté de son théâtre, et garde cette sensation dans chacune de ses pièces, d’ouvrir une porte et tomber dans un puits sans fond, pour voir et entendre des images et des sons dans cette chute.
- Histoire d’un geste
MayDay est l’histoire d’un geste, c’est à dire d’un secret, que nous découvrirons à la fin de la pièce, à force de remonter le cours des générations. La grand-mère, Alice, a pressenti qu’un jour sa fille, Betty, dans la chambre, là, de l’autre côté de la porte, se faisait abuser par son père. Elle l’a su, ce jour-là, et n’a pas ouvert la porte. Ce geste non accompli, suspendu, a tracé des lignes, imprimé de terribles répercussions sur les générations qui suivent. Sa fille plus tard se prostitue, sa petite-fille devient une meurtrière. Il ne s’agit pas dans la pièce de chercher un coupable, ni de dire que la grand-mère serait responsable de tout. Zumstein ne pose aucun jugement sur ses personnages. Mais ce geste originel agit en s’abattant sur les générations qui suivent.
On comprend alors pourquoi Mary, au début, raconte ce rêve étrange d’une porte mal fermée, d’une petite fille dressée derrière la porte, qui lève sa main vers la poignée, et prise de paralysie, ne parvient pas à faire ce geste simple. C’est suite à ce rêve terrifiant, que Mary se décide à contacter le journaliste : Faut lui ouvrir la porte sinon ça s’arrêtera jamais. Je vais la faire... Cette interview, je vais la faire.
Je pense à Sonate d’automne de Bergman, où la mère et la fille se parlent pendant toute une nuit, crient, pleurent, règlent leurs comptes, une nuit entière comme une catharsis, comme s’il fallait la traverser pour être enfin en paix, l’une avec l’autre, et avec soimême.
Dans MayDay, l’interview vaut bien cette nuit-là, elle nous propulse dans la tête de Mary, dans son corps, nous traversons avec elle des espaces-temps, rencontrant ainsi son enfance, sa mère, sa grand-mère, pour au final, comme au sortir d’un rêve, entrevoir la possibilité d’être, à peu près, en paix au présent.
- Extrait
Kate
C’est à cause de ce rêve,
Ce rêve que j’arrête pas de faire
Depuis qu’on parle de faire cette interview.
Faut croire que ça a réveillé quelque chose,
Quelque chose qui, d’ailleurs,
N’a jamais dormi que d’un oeil.
Le rêve c’est toujours le même,
Enfin, à peu de chose près...
Je suis assise sur le canapé,
Exactement comme maintenant,
Assise sur le canapé,
Dehors, il fait déjà nuit,
Je tricote au ralenti,
Je regarde la télé d’un oeil
Ou bien je somnole à cause de mes cachets.
Depuis le canapé, on voit la porte d’entrée...
Là, comme je vous parle, je la vois, la porte d’entrée.
Je vois la porte fermée.
Dans mon rêve c’est pareil,
C’est ça le plus effrayant,
Tout est comme d’habitude.
Kate pose le téléphone et poursuit, comme passée “de l’autre côté”.
Tout est à sa place : La photo sur la cheminée la table basse ma tasse de thé...
Tout est comme d’habitude,
Jusqu’au moment où je sens, sur ma nuque,
Ce courant d’air froid...
On dirait que c’est le vent du soir qui s’insinue dans le salon.
Le vent du soir, oui mais pas le vent d’ici,
Le vent de là-bas,
Le vent d’autrefois,
Le vent qui fait trembler la rivière, vibrer la voie ferrée,
Le vent qui froisse les tôles amassées sur le terrain vague,
C’est le vent d’autrefois,
Le vent qui charrie les odeurs noires et grises, s’insinue, trouve les fentes et les fissures.
Non, c’est pas l’odeur d’ici,
C’est l’odeur de là-bas,
C’est alors que je me dis : La porte est mal fermée, Je croyais l’avoir claquée, J’ai dû mal tirer la poignée.
Machinalement je me lève,
Je vais vers la porte d’entrée...
Kate se lève, fait quelques pas et se fige devant la porte (réelle ou imaginaire)
Je vais pour la fermer,
Je lève la main,
Je lève la main vers la poignée,
Mais j’ai cette douleur au bras,
Cette douleur soudaine et cinglante
Qui me saisit,
De l’épaule jusqu’au bout des doigts.
De l’autre côté de la porte il y a la nuit,
C’est pas compliqué,
Il y a juste cette putain de poignée à tourner.
Je peux pas,
Je suis glacée,
Je suis glacée parce que je sais qu’elle est là,
Je sais qu’elle est derrière la porte,
Juste là de l’autre côté, dans la nuit, de l’autre côté,
Oui je sais qu’elle est là,
Dans son petit manteau rouge, six boutons ceinture à boucle,
Je sais qu’elle est là,
Et je sais qu’elle aussi,
Dans le froid, dans la nuit,
Se dresse sur la pointe des pieds,
De l’autre côté,
Et lève la main vers la poignée.
Mayday – Bande-annonce
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - La Colline (Théâtre National)
La Colline (Théâtre National)
15, rue Malte Brun 75020 Paris
- Métro : Gambetta à 73 m
- Bus : Gambetta - Pyrénées à 53 m, Gambetta à 57 m, Gambetta - Cher à 144 m, Gambetta - Mairie du 20e à 150 m
-
Station de taxis : Gambetta
Stations vélib : Gambetta-Père Lachaise n°20024 ou Mairie du 20e n°20106 ou Sorbier-Gasnier
Guy n°20010
Plan d’accès - La Colline (Théâtre National)
15, rue Malte Brun 75020 Paris