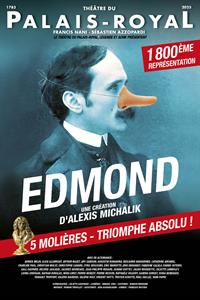Meeting Massera
Meeting Massera
- De : Jean-Charles Massera
- Mise en scène : Jean-Pierre Vincent
- Avec : Gauthier About, Simon Bellouard, Anne Cantineau, Charlotte Corman, David Geselson, Guila-Clara Kessous, Nathalie Kousnetzoff, Alain Macé, Douce Mirabaud, Sylvie Pascaud
Dans le cadre du Festival d'Automne à Paris.
À la rencontre de Massera
Paroles d'acteurs
Entretien avec Jean-Pierre Vincent
Vous entrez dans une librairie, vous flânez aumilieu des livres, vous voyez un titre : United emmerdements of New Order et, sur la même couverture United Problems of Coût de la Main-d’oeuvre. Vous feuilletez…Mais qu’est-ce que c’est que ça !? C’est drôle, très pertinent et très impertinent, ça fait parler notre monde. Ça tord les langages de la réalité, toutes ces tentatives pour commenter la catastrophe, toutes ces ruses de paroles pour lui survivre. Ça recycle tous les clichés de la rhétorique ambiante, mais c’est écrit, et cela sonne très personnel… De qui est-ce ? « Jean-Charles Massera ». Connais pas.
On achète le livre, on lit tout. Intuition confirmée ! Mais que faire avec ça ? Ce n’est pas écrit pour le théâtre, mais c’est une parole, une littérature orale : tout cela est fait pour être parlé, et gestualisé. Nous avons déjà pratiqué cela sous diverses formes. Ce pourrait être une matière de travail jubilatoire et retorse pour des acteurs… L’occasion se présente alors : cette expérience de l’Adami au Festival d’Automne, qui a nom Paroles d’acteurs. Il s’agit de travailler quatre semaines avec un groupe d’acteurs que vous ne connaissez pas forcément ; il y faut un texte ouvert aux recherches, pouvant satisfaire les appétits de chacun(e). Eh bien, c’est parti. À la rencontre de Massera, pour un théâtre d’aujourd’hui…
Jean-Pierre Vincent
Un essai proposé par Jean-Pierre Vincent et sa compagnie sur des textes de Jean-Charles Massera.
Dramaturgie Bernard Chartreux.
Déjà, en effet… Jean-Pierre Vincent a depuis longtemps l’habitude de porter sur scène des textes qui n’y étaient pas destinés. C’est même l’un des premiers à avoir tenté ces grandes expériences de transfert dans le théâtre français, à avoir projeté sur scène de vigoureux monologues obsessionnels issus d’autres espaces textuels. C’est aussi un artiste profondément passionné par la question politique comme en atteste par exemple son récent Karl Marx Théâtre inédit – encore du théâtre impossible et venu d’ailleurs.
Dans le cadre de Paroles d’Acteurs, programme annuel de l’Adami, Jean-Pierre Vincent travaille cette année avec dix acteurs, à inventer une façon de mettre sur scène la critique ironique du programme néo-libéral inventé par Jean-Charles Massera. Les logiques de jeu sont celles bien sûr du monde rigoureux de Vincent : pas de sentiment, pas d’hystérie surtout, mais de l’intelligence et de l’énergie avant tout. De la parole et des corps qui en veulent.
Avec Paroles d’acteurs, l’Adami perpétue la notion de transmission. Chaque année depuis plus de 10 ans, carte blanche est donnée à un « maître de théâtre », acteur et metteur en scène, pour partager pendant un mois son savoir et son expérience avec de jeunes comédiens dans le cadre de représentations publiques. Après notamment Joël Jouanneau (2006), Julie Brochen (2007) et Ludovic Lagarde (2008), c’est autour de Jean-Pierre Vincent de participer à la construction d’une identité professionnelle commune entre des comédiens d’horizons différents.
Vous allez proposer aux acteurs de « Paroles d’acteurs » de travailler autour de l’auteur
contemporain Jean-Charles Massera, sous laforme d’un « meeting Massera ». On aurait pu
s’attendre à ce que vous choisissiez un auteur qui a accompagné votre parcours. Or, vous découvrirez en même temps que les acteurs la façon de mettre en jeu cette langue. Dans quelle
mesure les textes de Jean-Charles Massera vous ont paru bien adaptés aux contraintes propres à « Paroles d’acteurs » ?
Les textes de Jean-Charles Massera ont été peu mis en scène. J’ai découvert son travail en
feuilletant, puis en achetant, un ouvrage en librairie il y a peut-être quatre ans. Je le conservais
au chaud en attendant le moment le plus opportun pour le travailler sur scène. À ma connaissance, l’expérience de Paroles d’acteurs s’est toujours développée autour d’œuvres contemporaines et comportent des contraintes précises : nous devons construire avec un groupe de dix acteurs, sur un texte qui permette une répartition relativement égalitaire du jeu de façon à ce que chacun puisse travailler pendant quatre semaines. J’aurais, de toute façon, cherché un texte qui ne soit pas de facture classique puisque, par définition, les œuvres dramatiques classiques comportent une hiérarchie entre les différents rôles. Si je me suis arrêté sur ce texte en librairie, c’est parce qu’il possède une oralité particulière.
A première lecture, la langue semble être celle que l’on retrouve à la radio ou dans les débats
politiques, alors qu’elle est, en fait, minutieusement écrite, composée. Il y a donc une tension spécifique dans les textes de Massera entre un projet littéraire et une énergie éminemment orale. Là réside la difficulté. Et si je dois travailler pendant un temps resserré avec des acteurs, je vais chercher un support qui leur pose problème. C’est ce problème que nous allons tenter de résoudre ensemble. Sans cela, pourquoi faire un atelier ?
Les textes de Jean-Charles Massera s’inspirent des particularismes de la société néo-libérale.La dimension politique a souvent caractérisée votre travail de metteur en scène depuis les
années 1960. Quels autres aspects de son écriture vous semblent entrer en écho avec vos
préoccupations générales ?
Evidemment, la teneur politique de ses textes m’intéresse beaucoup. La première fois que j’ai
lu du Massera, j’ai rencontré des éléments qui me sont familiers et d’autres radicalement étrangers. L’enjeu pour un acteur est un rapport avec sa langue, avec son présent, avec la
géographie du monde dans lequel il vit - monde qui s’incarne dans un certain nombre de régimes de discours. Il se trouve que les textes de Massera sont comme des métadiscours. Son écriture mange la langue des journalistes économiques, engloutit la pseudo science sur le monde, l’idéologie de l’information, les mensonges travestis en science. Elle mange les formules, poncifs et clichés de ces discours, les fait revivre autrement, en extrait l’âme et le sens souterrain. J’ai été le premier metteur en scène à proposer, il y a 30 ans de cela, un théâtre basé sur une écriture monologante, sur des textes solitaires, des textes qui n’étaient, par conséquent, pas des textes dramatiques. S’ils étaient écrits par des auteurs de théâtre, ils s’inscrivaient en quelque sorte comme des textes de « contre-théâtre ». Mon travail théâtral propose souvent une forme qui s’inscrit aux limites du dialogue théâtral, qu’il s’agisse des
textes de Bernard Chartreux ou de Michel Deutsch que j’ai, naguère, mis en scène, ou plus
récemment avec Karl Marx Théâtre inédit. Bien sûr, si je monte un Molière, la question se pose différemment… Encore qu’une pièce comme L’école des femmes se rapproche d’une forme monologante, obsessionnelle, avec des comparses épisodiques.
En 30 ans de parcours en qualité de pédagogue, quels sont les éléments qui vous semblent avoir changés dans le bagage des acteurs, en vue des formations qui leur sont accessibles à ce jour ?
Les lignes de force du monde matériel changent, les jeunes gens sont colorés par ces vastes changements. Une personne de ma génération peut sûrement regretter qu’ils aient oublié un
certain nombre de choses, comme le sens de l’Histoire, la connaissance du passé, celle de la
géographie, de la littérature…L’enseignement de l’Histoire s’effondre depuis 30 ans… Cela rend peut-être les gens un peu désarmés politiquement. Si bien que je passe toujours la
moitié du début des répétitions à parler d’Histoire, à les nourrir pour qu’ils ne flottent
plus comme des bouchons sur l’eau. Ensuite, la formation théâtrale a beaucoup changé en
France depuis une quarantaine d’année. L’école du Théâtre National de Strasbourg a pris
corps dans l’esprit général, et il y a maintenant une dizaine d’écoles nationales fondées sur la
trace de celle de Strasbourg. Les élèves sont plus conscients des difficultés à surmonter pour être acteur ; en même temps la plupart sortent relativement démunis de l’enseignement
secondaire. Une des missions conséquentes des écoles d’arts dramatiques est de re-cultiver des jeunes gens dont le seul bain culturel fut souvent celui de la télévision. La classe dominante mondiale a peu ou prou démissionné quant à la formation de sa jeunesse. Pour atteindre une réelle plénitude, les écoles d’art se doivent de lutter contre les forces dominantes du monde. Mais peut-être le théâtre a-t-il toujours été en tension avec le politique ?
Quelle conscience du théâtre, quelle attitude face à cette discipline souhaiteriez-vous transmettre aux jeunes acteurs ?
Evidemment je sais des choses, mais j’aime plutôt me concentrer sur ce que je ne sais pas.
Jamais je ne transmets un « savoir-faire ». Quelque soit le style d’un metteur en scène, quelque soit son rapport à l’idéal, aux formes, à l’abstraction, il y a des invariants qui apparaissent lorsqu’il s’agit de parler du jeu de l’acteur. Toutes les fois où j’ai pu échanger avec d’autres metteurs en scène, y compris ceux lointains de mon travail, j’entends les choses suivantes : la vérité, le concret, le fait qu’un geste artistique doit avoir un début, un milieu et une fin… Cela dit, ce qui me semble essentiel, c’est un rapport éthique, honnête avec l’objet de travail, avec l’énergie d’une poésie. Il est vain de vouloir faire dire au poète ce qu’il n’a pas dit.
C’est un rapport éthique au poète mais aussi au spectateur potentiel, et au réel. D’une manière
générale, c’est l’intelligence que je demande aux acteurs, la non hystérie, la non nervosité, le non sentimentalisme. Tout poème, dramatique ou non, a un poids, une énergie, une vitesse propre qu’il s’agit de percevoir. Leur travail est toujours de saisir cela et de débarrasser l’objet de tous les oripeaux, de toutes les algues qui se sont déposées sur lui à travers le temps. Ils doivent affiner leur perception pour saisir quelles forces sont en jeu entre un texte - quelque chose de l’ordre de l’immatériel – et l’actualité du monde.
De quelle façon, avec les outils dont dispose l’acteur, peut-il saisir cette tension et la rendre sensible pour quelqu’un qui ne connaît ce dont il s’agit ? L’art est un drôle d’endroit de la réalité du monde. C’est un besoin profond, chromosomique de l’espèce humaine. Il lui est vital de se voir raconter le monde d’une manière différente que celle employée par les puissants qui nous dirigent, dans une langue autre que celle, courante, utilisée en conversation avec mes voisins.
A titre personnel, j’ai toujours eu ce besoin de voir quelqu’un monter sur une pierre et me dire comment il voit le monde, et comment il me voit, se voit dans le monde.
Quelles furent les rencontres ou expériences marquantes de transmission que vous avez vécu, vous-mêmes, en tant que jeune acteur metteur en scène ?
Lorsque j’ai commencé à faire du théâtre au lycée Louis le Grand à Paris, en 1958-59, j’ai
immédiatement rencontré Patrice Chéreau et cette rencontre a bouleversé ma vie. Si j’avais
fait du théâtre sans jamais le rencontrer, je serais devenu un petit bonhomme de théâtre
français, purement français, comme il y en avait plein, et comme il y en a encore. Il se trouve que Patrice avait déjà une culture qui lui venait non seulement de Roger Planchon mais aussi de Brecht et du Berliner Ensemble. En tant qu’adolescents qui nous destinions au théâtre,
nous avons donc refusé l’héritage franco-français représenté à l’époque par la Comédie
Française, le Conservatoire, et une tradition littéraire, catholique, petite bourgeoise, de l’art français. Il nous fallait un levier : nous nous sommes plutôt appuyés sur des expériences étrangères, non seulement Brecht mais également sur des artistes russes comme
Meyerhold. Ainsi, je ne suis passé par aucune école de théâtre mais j’avais une sorte de « maître », du même âge que moi, qui était Patrice. Nous avons avalé ensemble du cinéma,
du théâtre, de l’histoire et de la politique, avons travaillé de façon inlassable, acharnée - et en
nous amusant beaucoup ! - pour nous extraire de ce qui nous semblait n’être qu’une gangue
française étouffante et mortifère. Nos maîtres étaient tous loin de nous : soit morts, dans le cas de Meyerhold, soit étrangers comme Bertolt Brecht ou Giorgio Strehler. Au fond, j’ai pu reconsidérer de façon un peu plus amicale des figures comme Louis Jouvet ou Charles Dullin
seulement après m’en être détaché. J’ai pu alors regarder derrière moi et entrer dans l’expérience pédagogique - chose que je n’ai jamais considérée comme la délivrance d’un message – pour transmettre ce moteur qui nous avait poussés vers cette soif d’apprentissage. Apprendre, et apprendre, toujours, inlassablement. Et joyeusement.
Propos recueillis par Eve Beauvallet pour le Festival d’Automne à Paris.
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Théâtre de la Cité Internationale
Théâtre de la Cité Internationale
17, boulevard Jourdan 75014 Paris
- RER : Cité Universitaire à 157 m (B)
- Tram : Cité Universitaire à 32 m (T3a)
- Bus : Cité Universitaire à 227 m, Stade Charléty - Porte de Gentilly à 320 m, Jourdan - Montsouris à 358 m
Plan d’accès - Théâtre de la Cité Internationale
17, boulevard Jourdan 75014 Paris