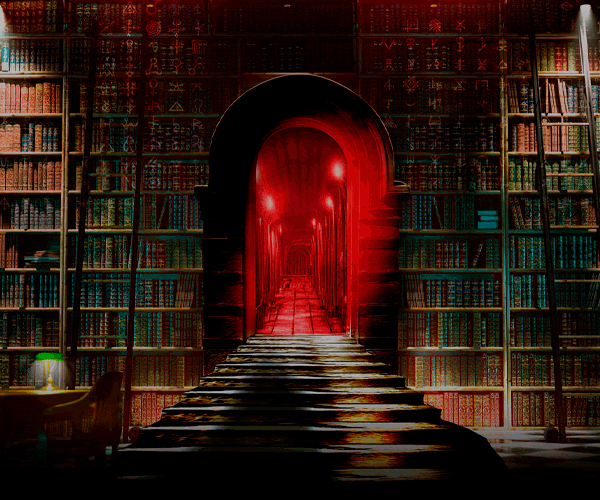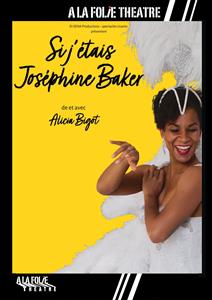Notre classe
Notre classe
- De : Tadeusz Slobodzianek
- Mise en scène : Justine Wojtyniak
- Avec : Zosia Sozanska, Julie Gozlan, Fanny Azema, Serge Baudry, Tristan Le Doze, Zohar Wexler, Georges Le Moal, Gerry Quévreux, Stefano Fogher, Claude Attia
Notre classe - Photographies
- Leçons d'un progrom
Quatorze leçons pour une histoire, celle de la vie de dix camarades de classe, juifs et catholiques, de 1929 à 2003, des bancs d’école à nos jours. Ils grandissent, entrent dans la vie adulte ensemble, deviennent les acteurs et témoins des événements traumatisants du XXe siècle. Face à des idéologies montantes, comment préserver notre « vivre ensemble » ?
- La presse
« Dansant, réunis en de magnifiques chorals, une dizaine de comédiens aux origines diverses (France, Pologne, Algérie, Israël…) en sont les interprètes. Si, dans la dernière partie (...) la pièce s’étire un tantinet, ils n’en font pas moins preuve d’une énergie folle, emportés dans un jeu physique, défendant avec le même souci d’humanité, leurs personnages, par-delà le bien et le mal, dans toute leur complexité. » Didier Méreuze, La Croix, 3 mai 2017
- Note de mise en scène
En découvrant la traduction de Notre classe par Cécile Bocianowski, immédiatement, il me parut évident que grâce à la transposition dans la langue française, ce texte racontant au départ une histoire locale, devenait l’extraordinaire parabole de n’importe quelle communauté face à la violence de la politique, des idéologies changeantes qui provoquent des prises de position, mènent à la dissolution de liens entre les individus.
L’extraordinaire juxtaposition des voix avant et après la catastrophe du pogrom en 1941, permet seule de rendre compte que ce tragique épisode n’est pas une prérogative du village de Jedwabne, ni de la Pologne, par ailleurs. S’attaquer à ce monstre de théâtralité, joué et primé plusieurs fois dans le monde entier, s’est imposé à moi comme nécessaire, urgent et poétique ; une façon d’agir en faveur de notre vivre ensemble.
Mon utopie d’une troupe, d’un collectif allait s’y exprimer pleinement dans la distribution chorale de dix acteurs. Au-delà des raisons artistiques, une vocation tout à fait personnelle et intime m’amène à créer ce spectacle. Ayant vécu en Pologne jusqu’à l’âge de 24 ans, j’ai subi le silence au sujet des Juifs disparus, silence imposé par le pouvoir officiel, entretenu comme un tabou au sein de ma famille, de l’école, de la société. Ce travail théâtral guérit cette blessure.
- Polyphonie des voix
Tadeusz Slobodzianek écrit Notre classe en 2010, lors d’un violent débat sur la coresponsabilité polonaise dans la Shoah, provoqué par de récentes révélations au sujet des pogroms perpétrés par les catholiques sur leurs voisins juifs. L’auteur s’inspire des récits des historiens Jan T. Gross et Anna Bikont, qui après 60 ans de silence sous le régime soviétique, reviennent aux témoignages des survivants et interrogent ceux qui restent, les témoins vivants de ces crimes, jusqu’alors attribués aux nazis. Ces récits d’investigation deviennent la matière première du texte dramatique. Ce dernier ne s’arrête pas cependant à la description de la catastrophe, mais retrace la vie des copains de classe des bancs d’école jusqu’à leur mort.
L’auteur est parti d’une photo de classe datant d’environ 1930, de Jedwabne, village devenu depuis emblématique. De prime abord la communauté est celle d’une classe d’école, mais au fur et à mesure de l’action, les différentes voix marquent leur appartenance à d’autres groupes comme nation, mouvement politique, religion.
Cette classe est de toute évidence la métaphore du vivre ensemble. Sa cohésion, l’apparente unité des voix se désagrège progressivement par des divergences religieuses, politiques et sociales. Le chœur d’écoliers laisse la place à la polyphonie des voix : celles des vivants, des mourants et des morts, celle de l’intime et du collectif, du subjectif et de l’objectif, celle des victimes et des bourreaux, celle de l’absent au regard extérieur.
Cette démultiplication de voix s’articule autour de soliloques, d’une apparence de dialogues, de comptines et de chansons, de lettres, de poèmes, tout en diversifiant les voix chorales, narratives, commentatives, actants. Les modalités variées d’énonciation créent un extraordinaire poème rapsodique, rappelant tous les codes du postdramatique et donnant une magnifique leçon d’écriture théâtrale. L’art de la mémoire, disait Walter Benjamin, est un art épique et rapsodique. Tadeusz Slobodzianek semble y exceller
- Leçon d'actualité
Nous scrutons les différents destins et observons comment « l’histoire avec un grand H » broie l’individu. Nous sommes invités ainsi à plonger au cœur de l’humain et sonder sa capacité de résilience. Il en résulte les possibles réactions individuelles à des événements traumatisants. Certains personnages font recours au refoulement, d’autres à la négation, d’autres encore cherchent la vengeance.
Il est captivant de découvrir comment ces sentiments changent au cours d’une vie et le cours de cette vie, tout en observant qu’il est impossible d’oublier les morts. L’empreinte sanguinaire reste collée à la peau, ineffaçable. C’est dans ce sens-là que la communauté, traversée par une tragédie, reste inséparable. L’auteur nous invite à épouser la métaphore d’une classe dans un sens symbolique comme l’image-même de chaque communauté confrontée à une tragédie.
L’histoire d’un village polonais résonne fortement avec les drames d’aujourd’hui, les adversités communautaires, les conflits d’appartenance religieuse qui surgissent après des événements tragiques. Cela se passe en Pologne, c’est-à-dire…nulle part et partout, dans une actualité sans cesse renouvelée.
- Être ou ne pas être, acteur-revenant
Ce qui m’a immédiatement interpellé à la première lecture de la pièce a été le statut ontologique de ses personnages. Les didascalies dévoilent l’approchement de leurs dates de naissance et une terrible sinusoïde des dates de leur mort. À la première leçon ils sont les gamins peinant à se présenter, à la troisième ils distinguent déjà leur appartenance religieuse, à la cinquième ils mènent leurs premières disputes politiques. À la neuvième leçon, dans un contexte politique extrêmement tendu, une haine approchant l’hystérie collective poussera les catholiques à lyncher les juifs.
En quatorze leçons, dans un rythme endiablé, nous parcourons la vie entière de dix personnages, jusqu’à la mort de chacun. C’est dans une optique testamentaire, qu’ils se retrouvent dans cette classe imaginaire à nous donner une leçon d’histoire, mais certainement plus encore, une véritable leçon de vie. Ils sont donc tous morts revenant avec leur mystérieux message par delà le bien et le mal à nous interroger au plus profond de nos humanités. Leurs voix recomposent le récit de leur propre biographie, de l’enfance, à travers l’âge mûr, en se prolongeant dans la description paradoxale de leur propre mort.
Les monologues intérieurs dont les motifs et les courbes se succèdent et s’entrecroisent, s’entremêlent à des bribes de dialogues qui restent comme des survivances d’une vie déjà trépassée. Cette dialectique implique une direction d’acteurs qui s’éloigne radicalement d’un quelconque jeu naturaliste. Il faut inventer de nouveaux outils, mettre l’acteur à l’endroit de l’incertitude quant à son savoir faire, sur le seuil du vivant et du mort. Lui donner comme modèle…le Revenant.
Il ne peut donc pas jouer à proprement parler mais doit se tenir là sur ce seuil, traversé par une parole étrangère à lui-même, chuchotée à son oreille par son double, son fantôme. Faire en sorte que le texte parte du corps, de sa mémoire. Utiliser la distanciation brechtienne avec le récit, qui apparaît comme un monologue intérieur d’une vie déjà vécue.
C’est dans une poétique onirique, proche du rêve éveillé que nous pouvons inviter l’acteur à déposer ses armes du jeu, à se tenir là comme un revenant. Pour cela je déploie un dispositif de travail qui débute avec un long travail corporel, fais traverser les acteurs à travers un jeu avec la matière de vieux vêtements comme porteurs de présences, pour qu’ils s’expriment dans des improvisations avec l’ensemble du groupe qui abolissent la chronologie, la hiérarchie des éléments du spectacle, et où comme dans un rêve tout se mélange et surgit au même temps.
Ce jeu-là est une porte ouverte vers l’imaginaire des acteurs permettant de faire jaillir des images à la lisière du fantastique où la seule logique est celle du rêve. Tout y est possible, l’accélération du temps, la rencontre par delà la mort, la femme violée qui éprouve du plaisir, l’extatique d’un crime collectif, le mourant qui décrit son trépas, le fatum qui s’abat le même jour sur deux enfants dans deux pays différents...
S’il nous était permis de regarder en arrière les grands événements de nos vies, on constaterait volontiers que la vie est un songe. Ce regard a-t-il aussi son point aveugle ?
Notre classe – Bande-annonce
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Cartoucherie - Théâtre de l'Epée de Bois
Cartoucherie - Théâtre de l'Epée de Bois
Cartoucherie - Route du Champ de Manœuvre 75012 Paris
- Métro : Château de Vincennes à 1 km
- Bus : Cartoucherie à 210 m, Stade Léo Lagrange à 560 m
-
Navette : Sortir en tête de ligne de métro, puis prendre soit la navette Cartoucherie (gratuite) garée sur la chaussée devant la station de taxis (départ toutes les quinze minutes, premier voyage 1h avant le début du spectacle) soit le bus 112, arrêt Cartoucherie.
En voiture : A partir de l'esplanade du château de Vincennes, longer le Parc Floral de Paris sur la droite par la route de la Pyramide. Au rond-point, tourner à gauche (parcours fléché).
Parking : Cartoucherie, 2ème portail sur la gauche.
Plan d’accès - Cartoucherie - Théâtre de l'Epée de Bois
Cartoucherie - Route du Champ de Manœuvre 75012 Paris