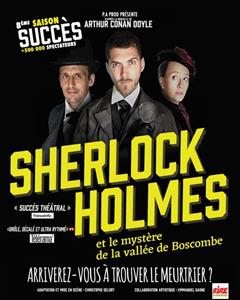Richard III
Richard III
- De : William Shakespeare
- Mise en scène : Philippe Calvario
- Avec : Philippe Torreton, Alban Aumard, Anne Bouvier, Pauline Bureau, Yann Burlot, Nicolas Chupin, Florence Giorgetti, Martial Jacques, Martial Jacques, Régis Laroche, Marie-Christine Letort, Jean-Luc Revol, Maximilien Muller, Joachim Salinger, Martine Sarcey, Alexandre Styker
Une soif intarissable de pouvoir
Jean-Michel Déprats, le traducteur
Note de mise en scène
La scénographie
Richard III ou la violation des sanctuaires
Duc de Gloucester, l’ambitieux Richard le bossu ne pense qu’à prendre la couronne royale à son frère, Edouard IV. Manipulateur de génie, il persuade celui-ci que leur frère Clarence complote contre lui. Clarence est enfermé dans la tour de Londres puis exécuté. A la mort d’Edouard IV, Richard devient régent. Sur le cercueil de ce dernier, il séduit sa veuve Lady Anne et fait ensuite enfermer et assassiner ses neveux afin qu’ils n’accèdent pas au trône. Richard se hâte de faire éliminer un à un les derniers fidèles du roi tandis que son ami Buckingham lui rallie le parlement et le peuple. Couronné roi, il répudie Anne pour épouser sa jeune nièce Elizabeth… Débute alors son règne de terreur. Buckingham, son ancien complice, soulève les troupes contre lui et Richard est tué dans la bataille.
C’est entre 1591 et 1592 que Shakespeare s’est consacré à l’écriture de Richard III, dernière pièce de sa tétralogie historique qui avait débuté avec les trois premières parties de Henry VI. Cette pièce fait état d’événements réels qui, à l’époque où Shakespeare la rédige, étaient encore récents dans l’esprit des spectateurs, prenant ainsi une forte résonance historique : la pièce se déroule lors de la guerre des Deux Roses, suite de guerres civiles entre la maison royale de Lancastre et la maison royale d’York qui prit fin en 1485 avec la mort de Richard III au champ d’honneur et l’accession au trône d’Henri VII.
Le texte est publié aux Éditions Gallimard, collection La Pléiade.
C’est en 1980 que Jean-Michel Déprats réalise un coup d’essai et un coup de maître : traduire Peine d’amour perdues pour Jean-Pierre Vincent, alors que cette pièce avait la réputation d’être difficilement traduisible. Lui qui décrit la pièce comme « un feu d’artifice de jeux de mots » s’agace de voir en note « jeux de mots intraduisibles ». Mais Jean-Michel Déprats a cette particularité d’avoir approché de près un plateau de théâtre, lui qui travaillait la mise en scène avec sa Compagnie du théâtre de la Colline au début des années 70. Depuis, il enseigne la littérature anglaise à l’université de Paris X - Nanterre.
Il a traduit également Coriolan pour Bernard Sobel, Richard III pour Georges Lavaudant, Macbeth pour Jean-Pierre Vincent et Matthias Langhoff, Roméo et Juliette pour André Serres... Et bien sûr le théâtre complet de Shakespeare pour la Pléiade. 38 pièces. Sa méthode ? Dire le texte : il s’enregistre sur des cassettes qu’il fait décrypter. « Cela (lui) permet de ne jamais oublier qu’au théâtre il s’agit toujours de dire ».
De son travail sur Richard III, il garde un souvenir douloureux : « Pendant des années, je m’étais joué Richard III à moi-même : « Now is the winter of our discontent... » C’était comme un arrachement, je me disais, ce n’est pas possible en français, on ne peut pas y arriver. J’ai été content d’avoir pu trouver : « Or voici l’hiver de notre déplaisir... » . De sentir la pulsation comme un écho. »
« Quoi, vous tremblez ? Vous avez tous peur ? Hélas, je ne vous blâme pas, car vous êtes mortels… » (Lady Anne I,2)
« Shakespeare est semblable au monde, ou à la vie même. Chaque époque y trouve ce qu’elle cherche ou ce qu’elle veut y voir. Le spectateur du 20e siècle déchiffre Richard III à l’aide de son expérience propre. Et il peut ni le lire, ni le voir autrement. Et c’est pourquoi l’atrocité Shakespearienne ne l’effraye pas, ou plutôt ne l’étonne pas. Il suit la lutte pour le pouvoir et la façon dont les héros de la tragédie s’entretuent. Il ne considère pas que la mort effroyable de la plupart des personnages soit une nécessité esthétique, ni une règle obligatoire en tragédie, ni même un trait spécifique du génie inquiétant de Shakespeare. Il est plutôt enclin à considérer la mort atroce des principaux héros comme une nécessité historique, ou comme une chose tout à fait naturelle » Jan Kott, Shakespeare notre contemporain, Payot, Paris, 1978
« C’est donc bien cette chose naturelle due au rapport historique et lointain de ces atrocités humaines qui laisse place à une fantastique liberté pour le metteur en scène et les comédiens. A la différence de Roberto Zucco dont je me suis emparé précédemment, la barbarie et la sauvagerie de Richard III sont dictées par une soif intarissable de pouvoir. Cette quête farouche fascine des générations entières et fait de cette pièce l’œuvre la plus jouée au monde (devant Hamlet). Chacune des tragédies historiques (dont Richard III) commence par la lutte pour conquérir ou renforcer le trône ; toutes s’achèvent par la mort du monarque et un nouveau couronnement.
Chacun des spectateurs a envie d’assister à cette ascension suivie irrémédiablement de cette chute ; depuis la tragédie Antique, il a besoin de voir représenter les zones les plus primaires de l’être humain, ces zones où l’homme n’a aucune limite pour parvenir à ses fins. Chez Shakespeare, il n’y a pas de dieux. Il n’y a que des souverains, dont chacun tour à tour est bourreau et victime, et des hommes qui ont peur.
Le spectateur vient voir le mal incarné sur un plateau, il cherche même inconsciemment voire consciemment à être séduit par lui, comme Lady Anne sera séduite par cet homme qui a tué son mari et son père. La distance historique rend tolérable cette fascination du mal.
Cette même distance historique permet au metteur en scène que je suis de laisser libre cours à ses fantasmes d’ordre esthétiques d’une part et barbares d’autre part. C’est de cet « Esthétisme Barbare » que je veux m’emparer avec violence et gourmandise. »
Philippe Calvario
« La scénographie de ce Richard III est née de deux recherches :
- D'une part, en écho au monde des samouraïs, créer un espace inspiré du Japon ancien, autant dans le dessin de la scène ou des shoji lumineux que dans le choix des matériaux, simples, bruts et beaux.
- D'autre part, accompagner la descente aux enfers de Richard par une destruction visible de son univers : à la pierre verte polie, lisse et impeccable, succèdent ainsi le béton brut, taché, les pierres usées de la Tour puis la terre, de plus en plus présente, bouleversée par les combats dont elle gardera l'intensité imprimée.
Avec tous ces éléments, nous avons inventé un langage complexe, changeant, d'une grande richesse de combinaisons mais simple de manipulations afin de répondre le plus sobrement possible à la multiplicité des lieux évoqués.
L'espace de jeu et les matériaux qui le composent expriment une part intime de l'âme des personnages, non verbale, intuitive, qui se doit d'accompagner de façon sensorielle la richesse de leur langage et la violence de leurs émotions. »
Karin Serres, scénographe
Richard, d’abord, fut un soleil. L’un de ces trois soleils qui apparurent dans le ciel après la bataille de Wakefield, lorsque furent sauvagement tués par la reine Lancastre, son père, Richard Plantagenet, le duc d’York et son frère Rutland. Dans la troisième partie de Henry VI (1591), Shakespeare raconte le début de l’histoire de celui qui deviendra Richard III. On est en 1460. La guerre des Deux Roses a commencé depuis cinq ans déjà. La bataille de Wakefield sera la victoire de la reine Margaret d’Anjou, femme du roi Lancastre Henry VI. Mais les trois soleils, les trois fils de York, Edward, George, Richard, sont liés dans la vengeance.
Onze ans après, en 1471, à la bataille de Tewkesbury, les trois frères tuèrent en représailles du meurtre du père, Edward, le fils de Margaret et d’Henry VI. Puis, Richard entra seul dans la tour de Londres pour assassiner le roi Henry prisonnier. Les soleils s’éteignent. Les dernières paroles du roi Henry font de Richard, duc de Gloucester un monstre, né avec des dents pour mieux mordre le monde, un être physiquement difforme comme si la nature n’avait pas achevé son œuvre. Henry fait de ce corps maudit un signe diabolique du mal. Pour les Lancastres, Richard est un cacodémon, esprit mauvais qui hante l’Angleterre.
Le philosophe Francis Bacon, au XVIIe siècle, voyait la difformité physique moins comme un signe diabolique du mal que comme la cause du mal. A l’aube de la modernité on ne pense déjà plus que le corps difforme est sous l’emprise du mal et on comprend comment le mal peut découler d’un être qui rend le ciel responsable de sa difformité.
Richard III (1593), qui prend la suite des trois parties de Henry VI, est une généalogie du mal, un exposé de ses causes à chercher dans un corps mal aimé. En effet, Richard se le demande, comment le divin mot amour peut-il trouver à se loger dans un corps qui ne reproduit pas les divines proportions de l’harmonie du monde ? Richard ne connaissant pas la majesté de l’amour, comment pourrait-il être roi ? Richard est tout entier ce manquement d’amour. Il doit remplir ce vide, avec des mots s’il le faut, des mots vides d’amour. Celui qui avait été soleil n’est plus qu’une ombre, un être réduit à épier [son] ombre au soleil. Il ne supporte pas le paysage ensoleillé de l’Angleterre enfin en paix maintenant qu’Edward IV son frère aîné est roi. La pièce commence dans ce présent insupportable. Now, le premier mot de la pièce, c’est le tangible, le sensible et, pour cette ombre, le monde des sens qu’on appréhende par le cœur est comme le jour pour un vampire. Mais Richard veut posséder ce qu’il ne peut toucher, alors il séduit. C’est d’abord en séducteur qu’apparaît le duc de Gloucester. Son pouvoir de séduction est à la mesure de son incapacité à être en contact avec le monde. Il séduit la veuve de celui qu’il a tué, il persuade son frère de son soutien au moment où il ordonne sa mort, il laisse croire à Buckingham qu’il est son autre moi, son double, il séduit le peuple dont il se moque.
Cette séduction est fureur. Richard est un héros furieux, comme ceux de Sénèque qui l’ont inspiré ou de l’Arioste qui errent désarçonnés, à la recherche de leur monture, dans les forêts de la folie déchaînée. Un cheval, un cheval ! mon royaume pour un cheval ! Le cri de Richard résonne sur le champ de bataille de Bosworth, dernier paysage de la pièce, cri du manque jamais comblé de celui qui a laissé le cheval de sa passion furieuse le désarçonner. Mais si Richard joue le possédé, il ne l’est pas. Il n’est pas un signe du mal. Il inscrit le mal dans le monde partout où il le peut, et son ombre couvre bientôt tout l’espace du royaume. Là est toute la modernité de la pièce. On y parle beaucoup de sorcellerie mais la sorcellerie, à laquelle Richard ne croit pas, n’est qu’un moyen comme un autre pour parvenir à ses fins. Bien avant le siècle des Lumières, Richard a compris que la sorcellerie n’est qu’une affaire de mots, qu’avec des mots on peut faire naître quelque chose de rien. Richard n’est rien, il n’a rien en lui de substantiel à aimer et de ce rien il fait naître le mal dans l’âme de l’autre. Car jamais Richard ne passe pour la cause du mal qui arrive aux autres. Tel le pervers, il fait en sorte que ce mal semble naître de l’autre, comme si l’autre, pour n’avoir échangé que des mots avec lui, était voué à s’auto détruire. Margaret d’Anjou veut maudire Richard mais une simple inversion des noms habilement insérée par Richard dans son délire prophétique et voilà qu’elle se maudit elle-même. Richard fera arrêter Hastings par un homme qui porte ce même nom de Hastings. Buckingham avant de devenir à son tour victime de la furie meurtrière de Richard se souvient des mots d’une prière imprudemment faite qui se retournent avec ironie contre lui-même. Les guerres civiles naissent, comme on le lit au début de Roméo et Juliette, de querelles de mots. Mais la division est portée au cœur même de l’instigateur de ces guerres civiles. A l’heure de minuit, quand les lumières brûlent bleues qui signalent la présence des esprits, l’âme de Richard se divise, incapable de s’aimer elle-même, vouée à se haïr, fin appropriée de celui qui avait porté la division jusqu’au cœur de l’autre.
Seul un artisan d’énigmes, un maître du langage comme Stanley, le comte de Derby saura déjouer les ruses de Richard en battant le tyran sur son propre terrain, le monde des mots. Stanley, (ancêtre homonyme du directeur de la compagnie théâtrale dont fit partie Shakespeare), le beau-père de Richmond sera un faiseur de roi, propulsant sur le trône le premier Tudor, Henry VII qui en épousant la fille d’Edward réunira enfin la rose rouge des Lancastres et la rose blanche des Yorks.
La pièce est un immense espace, où, comme dans les romans de Lewis Carroll, on laisse les mots jouer de leur malice. Tout y est à double sens. J’interprète deux sens en un mot est le mot d’ordre de ce désordre mortel. La séduction fonctionne ainsi, et la malédiction aussi. Si Anne cède à Richard c’est parce qu’il porte, comme il le lui fait subtilement comprendre, le même nom « Plantagenet » que celui du mari bien aimé qu’il a fait tuer, Edward Plantagenet le prince de Galles, fils d’Henry VI. Quelle différence peut-il y avoir entre les êtres s’ils portent le même nom? Dans cette confusion des noms la vengeance trouve une logique : Margaret, grande sorcière du langage, ne voit pas pourquoi, puisque son fils « Edward » a été assassiné, le même sort ne serait pas réservé au fils « Edward » de son ennemie, la reine Elisabeth. Ton Edward est mort qui a tué mon Edward. Avant de mourir le roi Edward IV est de plus en plus superstitieux, croit facilement les faux prophètes. Richard en joue. Il existe une prophétie qui dit que les héritiers du roi mourront de la main de « G ». Son frère, le duc de Clarence, qui s’appelle Georges est jeté en prison où Richard le fera assassiner. Mais la lettre continuera à dessiner le destin funeste du roi puisque, Richard, dont le titre, le duc de Gloucester commence par un G réalise ironiquement la prophétie. Ainsi l’araignée tisse une toile de mots et de signes, déviés de leur usage propre.
Dans ce royaume des mots, les êtres perdent toute substance. Elisabeth ne sera plus qu’une reine fantoche, une reine fantôme. Pauvre reine peinte. Le monde petit à petit, devient ombre, vidée de substance - c’est cela le mal lorsque tout, le langage, les êtres et les lois perdent leur substance et leur sens. Lorsque Richard règne, ce ne peut être que sur les fantômes de ceux qu’il assassine.
Le lieu sacré du sanctuaire ne résiste pas à l’ombre qui envahit toute l’Angleterre. Au centre même de la pièce, le sanctuaire où se réfugient, dans une détresse orpheline, les petits princes, les fils d'Edward IV, est violé. On assiste à une lente désacralisation de l’espace par celui qui porte ironiquement le nom de Protecteur. Même le sanctuaire du cœur de l’autre est violé : la chambre d’Anne qu’il séduit, n’est plus qu’une image de l’enfer. Le cœur de l’Etat, l’unité du Conseil est violée, divisée entre ceux qui vont couronner le petit prince, héritier légitime de la couronne, et ceux que Richard tournera à son profit. Il ne reste bientôt pas un lieu où ne règne la division après la mort du roi Edward IV, le premier des trois soleils de la bataille de Wakefield.
Vers 1513, Sir Thomas More, qui sera Grand Chancellier du deuxième Tudor, Henry VIII (fils de Richmond, vainqueur de Richard), écrivit une biographie tendancieuse de Richard III. Les Tudors encourageaient chez leurs chroniqueurs une diabolisation de Richard. Mais ils n’étaient peut-être pas aussi irréprochables qu’ils le laissaient entendre. Après tout le fils de Clarence était encore en vie lorsque Richmond, devenu Henry VII, monta sur le trône. On se demanda même si le premier Tudor n'était pas responsable du meurtre des petits princes. Et si, comme on commence à le comprendre, Sir Thomas More, le biographe de Richard III, sembla obéir à la directive Tudor, peut-être pressentait-il déjà qu’Henry VIII l’enverrait à l’échafaud, et derrière le Richard monstrueux qu’il décrit et qui sera la source principale de Shakespeare, se profile peut-être l’image d’Henry VIII, autre violeur de sanctuaires.
Margaret Jones-Davies, dramaturge
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Nanterre - Amandiers
Nanterre - Amandiers
7, av. Pablo Picasso 92000 Nanterre
- RER : Nanterre Préfecture à 773 m
- Bus : Théâtre des Amandiers à 7 m, Joliot-Curie - Courbevoie à 132 m, Liberté à 203 m, Balzac - Zola à 278 m
-
Voiture : Accès par la RN 13, place de la Boule, puis itinéraire fléché.
Accès par la A 86, direction La Défense, sortie Nanterre Centre, puis itinéraire fléché.
Depuis Paris Porte Maillot, prendre l'avenue Charles-de-Gaulle jusqu'au pont de Neuilly, après le pont, prendre à droite le boulevard circulaire direction Nanterre, suivre Nanterre Centre, puis itinéraire fléché.
Plan d’accès - Nanterre - Amandiers
7, av. Pablo Picasso 92000 Nanterre