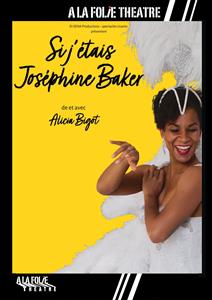Songs
Songs
Coup de cœur MUSIQUE & DANSE Le 9 janvier 2019
- Mise en scène : Samuel Achache
- Direction musicale : Sébastien Daucé
- Avec : Sébastien Daucé, Lucile Richardot, Sarah Le Picard, René Ramos-Premier, Margot Alexandre, Angélique Mauillon, Lucile Perret, Mathilde Vialle, Thibault Roussel, Arnaud de Pasquale
Songs - Photographies
Une création à partir de musiques anglaises du XVIIe siècle. Par l'Ensemble Correspondances et la Cie La Vie Brève.
- Notes d'intention
« Partant de l’univers des Consorts songs et des Virginalistes anglais, alors que l’esprit virtuose de la Renaissance s’étire encore sur les premières années du XVIIe siècle, il nous est apparu que le monde musical qui suit Dowland et précède Blow et Purcell constituait un univers aussi peu connu que fascinant.
L’instabilité politique du royaume d’Angleterre dans ces premières décennies (monarchie, exécution de Charles I, protectorat de Cromwell, puis restauration) et les tensions perpétuelles entre catholiques et protestants ont nécessairement des retentissements sur la vie artistique : les musiciens évoluent au gré du soutien qu’ils ont apporté à l’un ou l’autre régime, à l’une ou l’autre religion, et l’on voit éclore et disparaître des genres nouveaux, surgir des mélanges inédits et des saveurs nouvelles.
C’est durant cette période que naît véritablement la monodie accompagnée anglaise, où la beauté du contrepoint et de ses dissonances accorde une place nouvelle à une liberté de la déclamation, sur le modèle des recherches italiennes des Caccini et Monteverdi. L’univers poétique est largement issu de la pastorale, tout en faisant une part de plus en plus importante à une véritable inspiration dramatique. La mélancolie reste un ingrédient omniprésent et une signature spécifiquement anglaise .»
Sébastien Daucé, directeur musical
« Il faut imaginer un lieu qui ne serait pas de notre réalité, une faille sur les entrailles de notre monde : un orchestre qui a perdu la notion du temps, joue sans discontinuer dans une casse à instruments de musique. Il faut imaginer une femme, qui chante en anglais des pièces de musique du XVIIe siècle qui nous sont inconnues et qui vont fouiller la mélancolie, la tristesse et les peines d’amour le plus souvent. Cette musique et ce chant jouent de manière ininterrompue pour que nos peines s’atténuent, que la vie reste vivable et que nous mettions aux archives nos chagrins.
À la manière d’un petit chœur antique, l’orchestre et deux chanteurs peuplent et actionnent cette grande machinerie mélancolique. Ils vont rendre sensible et matérielle la descente « en elle-même » de cette femme. L’orchestre sera aussi la scénographie de ce spectacle, au milieu d’une quantité d’instruments de musique infiniment supérieure : des décombres d’instruments fonctionnant ou non, qu’on ne connaît pas ou cassés, détournés, coupés en deux. Une véritable « casse baroque », un Parnasse renversé .Un jour arrive une autre femme. Elle réclame ses peines, refuse d’oublier, veut garder vives ses douleurs. Elle vient récupérer son bien et l’empêcher de fuir dans l’oubli. Y parviendra-t-elle ? Ici, un certain ordre est à l’œuvre et l’oubli est bien gardé. »
Samuel Achache, metteur en scène
« Au commencement est cet espace. Ce qu’il s’y passe immuablement, ce qu’il charrie, comme déplacements, transformations et que nous traduirons en jeux et chants. Nous allons tenter ici de trouver l’écrin de ces paroles qui traversent les âmes et les siècles. Très vite, au début de nos discussions, nous nous sommes intéressés au Théétète de Platon. Dans ce texte, Platon met en scène les discussions et débats tenus autour de Socrate. Celui-ci émet l’hypothèse qu’il y a dans nos âmes des «tablettes de cire ».
Platon se réfère ici aux tablettes que les Grecs comme les Romains utilisaient comme support de l’écriture et qu’ils grattaient avec l’extrémité plate du poinçon pour y effacer ce qui y avait été écrit auparavant. Chez Platon, la tablette contenue dans l’âme joue le rôle de mémoire : elle conserve toutes les empreintes de ses sensations et de ses réflexions reçues par l’homme afin qu’il ne les oublie pas.
Avec le temps, ces empreintes perdent de leur précision, les contours s’effacent. En effet, on ne peut vivre constamment dans ses souvenirs et un trop plein d’affects peut devenir une entrave à la vie. Nous avons donc imaginé ce lieu, qui serait cet atelier, cette fabrique de l’oubli, de l’archivage. Dans lequel ce trop plein d’émotion vient être déversé, puis transformé. Ce lieu métaphorique, cette faille, peut être sans limite, immense aussi bien que minuscule et nichée en chacun de nous aussi.
À partir de là, j’ai imaginé l’idée de travailler, en reprenant la métaphore de Socrate, avec de la cire, matière qui évoque l’organique, le matriciel. En effet, la cire nous permettra d’évoquer la transformation, le passage d’un état à un autre (cire liquide/cire solide) et sa possibilité infinie et cyclique de transformation. On pourra ainsi couler de la cire qui durcira et que nous pourrons refondre et recouler à l’infini.
Cette matière nous permettra aussi d’évoquer le temps qui passe. Les objets emprisonnés dans la cire seront comme des fossiles pétrifiés. J’imagine ainsi un sol et des parois, sur lesquels la cire a coulé, qui a englué les pieds des meubles, des instruments. »
Lisa Navarro, scénographe
- La presse
« Humour et dérision, mais aussi peine et tendresse, tressent un spectacle fluide et attachant, souvent à fleur de peau. (...) Erudit et inventif, drôle et émouvant à la fois, le travail du metteur en scène rebat les cartes : musique ancienne, théories des humeurs, mythe pastoral, comme décachetés d’une cire mémorielle, recouvrent une étonnante modernité portée par l’excellence des interprètes. Des musiciens parfaitement intégrés au processus scénique, des comédiennes dont le jeu sait se couler dans le flux musical. » Marie-Aude Roux, Le Monde, 16 janvier 2019
« Samuel Achache et Sébastien Daucé conjuguent les affects du théâtre et de la musique dans un spectacle qui sublime la délectation morose. » Emmanuelle Giuliani, La Croix, 7 janvier 2019
« L’ensemble baroque Correspondances et le metteur en scène Samuel Achache conjuguent leurs talents dans un joyau de loufoquerie, entre musique et théâtre. Quand l’atmosphère mélancolique de chansons anglaises du XVIIème siècle rejoint la cocasserie d’une existence en délicatesse avec le bonheur… » Manuel Piolat Soleymat, La Terrasse, 19 décembre 2018
« Sébastien Daucé et le metteur en scène Samuel Achache (avec sa compagnie la vie brève) ont élaboré un conte semi-fantastique d’un charme fou, structuré par le répertoire même du disque Perpetual Night (Harmonia Mundi). (...) la mélancolie ambiante n’empêche pas qu’on rit souvent, et de bon cœur. Et qu’il faut saluer tout autant le talent des comédiennes professionnelles, qui offrent des caractérisations fines et sensibles de leurs personnages respectifs, que les capacités des musiciens présents sur scène à entrer, eux aussi, dans le jeu théâtral. » Sophie Bourdais, Télérama
- Songs, «un art en mouvement»
« Nos songs naviguent au gré des plus belles plumes de compositeurs des années 1630 à 1690. Les premiers invités sont deux des plus importants protagonistes des divertissements profanes de la cour d’Angleterre : Robert Johnson et Giovanni Coperario sont impliqués tout au long de leur carrière dans la composition des Masques qui réjouissent la cour. Ce genre du mask, équivalant au ballet de cour outre-Manche, mélange le théâtre, la musique, la danse, les costumes, décors et machines dans un subtil assemblage, qui dépasse largement la juxtaposition d’intermèdes successifs. La recherche d’un divertissement complet, aussi raffiné qu’impressionnant, dont peu de traces nous sont parvenues. L’air Care Charming Sleep est un exemple magnifique d’un grand récit chanté de Mask. Coperario, en réalité John Cooper, est une figure centrale de la cour et particulièrement intéressant en ce qu’il révèle l’attrait des compositeurs anglais pour la musique continentale : imiter les italiens, sans avoir jamais traversé la Manche, au point de travestir son nom révèle un tropisme italien. George Jeffreys composera même une pastorella, en italien, dans le style romain des cantates de Luigi Rossi.
Depuis Henry VIII, la cour d’Angleterre fait venir à Londres des musiciens italiens qui, pour beaucoup d’entre eux, se plaisent sous ces climats brumeux au point de s’y installer définitivement et de fonder des dynasties de musiciens dont certains descendants sont encore au service de la cour d’Élisabeth II !
Les frères Lawes, probablement élèves de Coperario, sont deux figures majeures de la musique anglaise du XVIIe : quand Henry fut l’un des compositeurs les plus féconds, William, probablement plus tourmenté (souffrant de troubles psychologiques ?), offre des pages d’une invention et d’une bizarrerie qui défient le style et les règles musicales du temps. Ce sont également eux deux qui mettent au point les premiers récitatifs anglais : déclamations libres, où la musique sert totalement le texte.
Robert Ramsey et John Hilton introduisent une dimension nouvelle : ils composent de grands « dialogues » où plusieurs personnages se répondent, à la manière d’une scène de théâtre. Miroir des grands récits de Boësset en France, ces grandes pièces s’inspirent de la mythologie (Orphée, Jugement de Pâris) et préfigurent l’opéra qui ne naîtra en réalité qu’à la fin du siècle sous la plume de Purcell.
John Jenkins a écrit principalement pour les instruments, et notamment pour les consorts de violes si appréciés de la cour et des bonnes maisons. Sa musique dense et extrêmement sensible offre des couleurs qui inspirent des sentiments profonds, sans paroles.
La génération suivante, représentée par Matthew Locke et John Banister, poursuit la tradition de ses maîtres, en apportant toujours davantage de théâtre, sans jamais renoncer à la bizzarerie : l’harmonie et les mélodies cherchent tantôt à séduire, tantôt à déstabiliser l’oreille. Le maître de Purcell, John Blow, qui clôt ce programme, ajoute encore sa pierre à l’édifice avec une sensualité, et une écriture particulièrement vocale qui ouvre définitivement la porte au jeune Henry Purcell.
En près d’une heure et demie, cette belle anthologie est un voyage au gré de la plume des meilleurs artistes du XVIIe siècle anglais, suivant une tradition qui n’en finit pas de se renouveler : sans connaître par avance ni les compositeurs, ni leur musique, le spectateur du XXIe siècle sentira nécessairement cette transformation du style, subreptiscement d’une pièce à l’autre, en se rendant finalement compte. Si tous ces grands artistes se respectent infiniment entre eux (certaines pièces du programme sont des hommages explicites des uns aux autres), chacun apporte des nouveautés, que les suivants se réapproprient : la grande tradition des songs est un art en mouvement. » Sébastien Daucé
- Programme
John Coperario (1570-1626) : Go happy man
Robert Johnson (1583-1633) : Care-charming sleep
Matthew Locke (1621-1677) : Suite n° 1, Consort for four parts
John Banister (1624-1679) : Give me my lute
William Lawes (1602-1645) : Whiles I this standing lake
Martin Peerson (1571-1651) : O precious time
William Webb (1600-1657) : Powerful Morpheus
Nicholas Lanier (1588-1666) : No more shall meads
John Blow (1649-1708) : Loving above himself
John Banister : Amintas
Robert Ramsey (1590-1644) : Howl not, you ghosts and furies, while I sing
Henry Purcell (1659-1695) : Miserere mei
John Blow : Extrait de l’Épilogue Sing sing Ye muses « Music may satisfy the ear »
Songs – Bande-annonce
Sélection d'avis des spectateurs - Songs
Par FlorenceW - 20 janvier 2019 à 10h53
Magnifique à tous points de vues . D'une grande finesse et musicalement merveilleux .
Tres original, belle mise en scene Par Patrick H. - 11 janvier 2019 à 10h21
Chanteurs et musiciens parfaits, quelques longueurs dans le spectacle..
Moyenne des avis du public - Songs
Pour 2 Notes
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Par FlorenceW (6 avis) - 20 janvier 2019 à 10h53
Magnifique à tous points de vues . D'une grande finesse et musicalement merveilleux .
Tres original, belle mise en scene Par Patrick H. (4 avis) - 11 janvier 2019 à 10h21
Chanteurs et musiciens parfaits, quelques longueurs dans le spectacle..
Informations pratiques - Bouffes du Nord
Bouffes du Nord
37 bis, bd de la Chapelle 75010 Paris
- Métro : La Chapelle à 119 m
- RER : Gare du Nord à 259 m, Magenta à 374 m
- Bus : Place de la Chapelle à 62 m, La Chapelle à 206 m, Gare du Nord à 256 m
- Transilien : Gare du Nord à 259 m
Plan d’accès - Bouffes du Nord
37 bis, bd de la Chapelle 75010 Paris