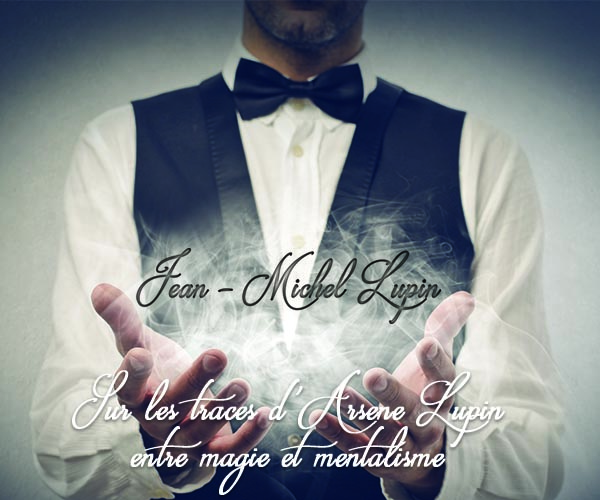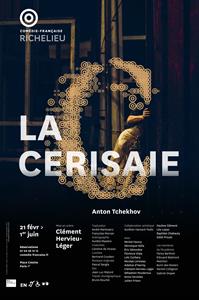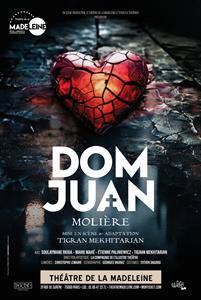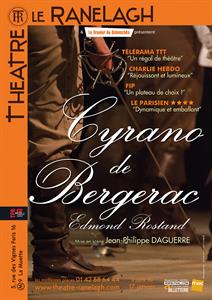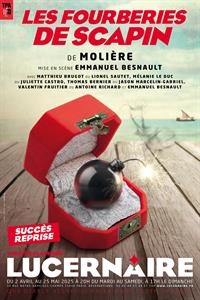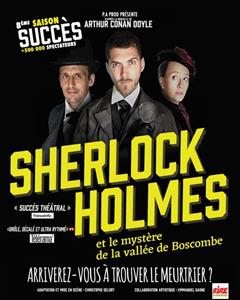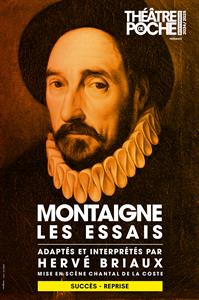Badier Grégoire
- De : Emmanuel Darley
- Mise en scène : Michel Didym
- Avec : Abdul Alafrez, Pierre Baillot, Quentin Baillot, Jean-Yves Chatelais, Sébastien Knafo, Gaëlle Fernandez-Bravo, Vincent Macaigne, Stanislas Stanic
Une première étape
par Michel Didym
Une forme de partage
par Emmanuel Darley
Trois aveugles cruels, les voix fantomatiques
et brutales des frères Chouard, l’appel sensuel de Suzanne... Tandis
qu’il chemine les mains dans les poches, le jeune Badier Grégoire fait
des rencontres. Elles le mettent à l’épreuve. Le monde est âpre,
la nature primaire, les éléments réduits à un état originel.
Le jeune Badier Grégoire avance à la découverte de sa vérité ;
mais de quelle vérité ?
Après deux romans parus aux éditions P.O.L. et Verdier,
Théâtre Ouvert publie la toute première pièce d’Emmanuel Darley
en Tapuscrit. Le metteur en scène Michel Didym
fait un chantier autour de cette écriture qui a retenu l’attention
des lecteurs de Théâtre Ouvert par son aspect
à la fois concret et raffiné.
Une première étape
par Michel Didym
Ce qui me touche dans cette première pièce d’un jeune romancier, c’est
l’univers de l’enfance aux frontières du paradis perdu, une enfance qui se
cherche et une adolescence qui se révèle à elle-même.
Aussi faire prendre en charge deux des personnages - les frères Chouard - par de jeunes
adolescents m’intéresse singulièrement. Pour les trois aveugles - autre repère de
la pièce - j’aimerais travailler avec des acteurs dont le tempérament et le
parcours sont complémentaires. Comme si, avec eux, Emmanuel Darley réinventait la
fonction d’un chœur antique contemporain.
La mise en espace sera pour moi une période expérimentale, une étape de recherche
nécessaire pour la création d’un spectacle à venir.
Une forme de partage
par Emmanuel Darley
- Comment avez-vous commencé à écrire, et surtout, à écrire du théâtre ?
Emmanuel Darley : Après le lycée j’ai entrepris de vagues études de
cinéma, pas très poussées parce que je ne suis pas très doué pour les études. Ce que
je voulais, c’était réaliser, faire des films : j’ai écrit quelques
scénarios qui sont restés dans mes tiroirs. Puis, en retravaillant l’un de ces
projets, peu à peu j’ai bifurqué et cela s’est transformé en roman, cela a
donné Des Petits Garçons qui montre quelqu’un dans une situation
d’enfermement. Je me suis tourné vers la littérature sans doute parce que j’ai
été élevé dans les livres, sans doute aussi parce que je travaillais en librairie à
cette époque. Je crois que ce qui me gênait avec le cinéma, c’était l’idée
de travailler en équipe : devoir nécessairement diriger ou être dirigé, je ne crois
pas être fait pour ça. Je suis plus à l’aise en travaillant seul. L’écriture
de théâtre me paraît être un juste milieu : toujours la solitude, le face à face avec
les mots mais au bout une sorte de partage, de " cadeau " à un metteur en
scène, à des acteurs.
Le deuxième livre, Un gâchis, était comme le premier un récit à la première
personne. Quelqu’un qui quitte le domicile familial et se trouve dans une extrême
solitude. Une sorte d’enfant sauvage, sans repères, qui avance dans l’inconnu,
se cherche, essaie de revenir à la vie et trouve une petite fille qui pourrait le sauver
mais c’est déjà trop tard. Ce fut un livre douloureux à écrire, remuant sans
doute beaucoup de choses autobiographiques. J’ai eu envie d’écrire pour le
théâtre, pour ne plus porter seul les choses, pour sortir aussi de la première
personne. Il y a des similitudes entre Badier Grégoire et Un gâchis : on y retrouve
notamment le même univers rural et frustre ; mais la grande différence est là, dans la
disparition du " je " unique qui parle presque seul, intérieurement.
- Aviez-vous l’expérience du théâtre, au moins comme spectateur ?
E. D. : Pas réellement, en tout cas, pas la proximité que j’ai toujours eue avec le
cinéma par exemple. C’est depuis l’écriture de Badier Grégoire que j’ai
commencé à voir des spectacles. A vrai dire, pendant longtemps, je n’ai pas été
persuadé que c’était vraiment une pièce de théâtre : j’ai procédé comme
pour les romans mais en choisissant la forme dialoguée. Cette démarche est assez
équivalente à celle que j’ai adoptée dès le premier livre : écrire avec le moins
de référent possible. C’est ce qui me gêne souvent avec les écrivains
d’aujourd’hui, ce poids des références, des "à la manière de". En
revanche, je me sens une familiarité avec deux d’entre eux invités cette saison à
Théâtre Ouvert : François Bon et Jacques Serena.
- Badier Grégoire comporte un certain nombre d’énigmes. Il y a notamment
la présence de ces aveugles dont le jeune homme va porter la faute... Est-il utile de
chercher des significations précises, des résolutions à ce qui serait alors un texte à
clefs ?
E. D. : Je crois que la signification doit rester ouverte. De même que pour les romans,
j’aime que les choses restent en suspens. J’aime que ne soient pas résolues
certaines questions, celles touchant à la culpabilité par exemple. J’ai écrit
trois textes qui sont imprécis quant au temps, au lieu, à l’époque, à l’âge
; ce n’est pas ce qui pour moi a de l’importance.
L’important, ce sont les mots, la langue. La poésie, disons. Et puis ce qui se dit
au premier abord, le discours de "l’Homme mort" dans Badier Grégoire, ce
qu’il dit de la solitude, de la destinée. En écrivant, j’ai cherché surtout
une ambiance, une proximité avec un aspect originel et primaire des éléments. Les
personnages sont plongés dans une nature qui se montre âpre et ils réagissent de
manière, eux aussi, primaire.
- Qu’attendez-vous de la mise en espace du texte ?
E. D. : Confronter le texte aux voix, aux corps et au mouvement. Je sens qu’il y a
des choses un peu bancales dans cette pièce, j’ai besoin de " voir en vrai
" avec Michel Didym afin d’améliorer, de rendre Badier Grégoire plus fort
encore. N’ayant aucune expérience du travail de la scène, ce chantier va être une
occasion de poser concrètement les questions d’écriture que je n’arrive pas à
résoudre.
Il me semble que l’idéal pour un auteur serait de pouvoir travailler avec des
acteurs pendant le processus d’écriture. Mettre en danger ses mots grâce à la
présence du corps et de la voix avant d’arriver à une version définitive du texte
de théâtre...
(septembre 1999)
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Théâtre Ouvert
Théâtre Ouvert
159 avenue Gambetta 75020 Paris
- Métro : Saint-Fargeau à 181 m
- Bus : Saint-Fargeau à 125 m, Pelleport - Gambetta à 210 m
Plan d’accès - Théâtre Ouvert
159 avenue Gambetta 75020 Paris