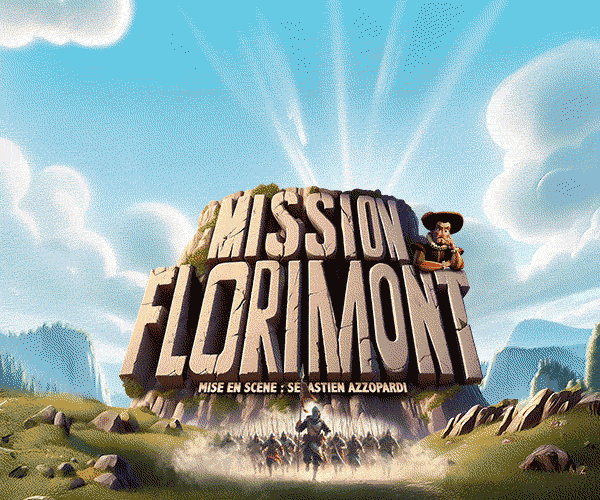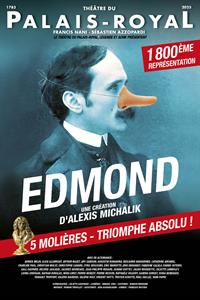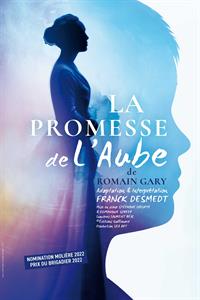Benjamin Walter
Benjamin Walter
Coup de cœur CONTEMPORAIN Le 1er février 2017
- De : Frédéric Sonntag
- Mise en scène : Frédéric Sonntag
- Avec : Simon Bellouard, Marc Berman, Amandine Dewasmes, Clovis Guerrin, Paul Levis, Lisa Sans, Jérémie Sonntag, Fleur Sulmont, Emmanuel Vérité
Benjamin Walter - Photographies
- Roadtrip musical et littéraire
En 2011, le jeune Benjamin Walter cesse d’écrire, abandonne tout et s’efface dans la nature. Frédéric Sonntag a parcouru 7 923 km pour le retrouver. Avec ses comédiens et musiciens, il raconte ici sa longue quête – roadtrip musical et littéraire à travers l’Europe –, livre des extraits des journaux de Walter et tente de comprendre pourquoi cet écrivain a préféré le silence.
Évidemment, Benjamin Walter ne doit pas être sans un certain rapport avec Walter Benjamin, disparu lui aussi sur les routes de l’exil, mais Benjamin revendique aussi sa dette envers une constellation d’artistes européens et crée ainsi un très subtil jeu de miroir entre passé et présent, vérité et fiction.
- Entretien avec Frédéric Sonntag
Le personnage titre, l’écrivain Benjamin Walter, n’est pas sans évoquer un autre écrivain plus connu. Quelles relations se tissent entre les deux ?
D’abord, il faut dire que cette pièce est le deuxième volet d’une trilogie. Chaque volet porte le nom d’un personnage qui n’est pas présent, et à chaque fois il s’agit d’enquêter sur l’identité fuyante de cet absent. Le premier volet tournait autour de George Kaplan, le héros mystérieux de La Mort aux trousses d’Alfred Hitchcock. Ici, dès le début de la pièce on explique que Benjamin Walter n’est pas Walter Benjamin, que Benjamin Walter est un jeune auteur qui a cessé d’écrire et a disparu, que la ressemblance des noms est pure coïncidence. Mais, bien sûr, en menant l’enquête, le personnage de Frédéric va révéler des séries d’échos entre l’un et l’autre : le goût de flâner par exemple ou de collecter des citations et de les monter ensemble.
Le montage est-il une procédure importante dans la construction de cette pièce ?
Benjamin Walter est une sorte d’enquête policière. Il s’agit de recueillir des traces, des indices, des citations, des bribes de choses qui nous permettent de savoir ce qu’est devenu Benjamin Walter, et de les monter entre elles pour savoir quelle image du réel en ressort. Comme dans toute bonne enquête policière, il y a un mur d’investigation où on colle les infos et où on les relie par des flèches. C’est une vraie enquête et en même temps c’est une méthode de pensée, le montage comme façon de construire et d’appréhender le réel, à la manière de Benjamin ou d’Aby Warburg. Le personnage de Frédéric voyage beaucoup dans la pièce. C’est une sorte de défi à la scène théâtrale. Les personnages de mes pièces ont souvent tendance à errer, à flâner, à déambuler. Je crois que j’aime bien cette dramaturgie d’un voyage sans but, où le voyage est sa propre finalité. À un certain moment, il est clair que cette déambulation devient non seulement l’occasion de raconter une histoire mais aussi un projet de vie. Alors ensuite, il est certain que raconter des voyages au théâtre pose de vraies questions. J’ai même décidé de changer ma façon de travailler pour cette pièce. D’habitude, j’écris les textes en amont et j’applique ensuite sur le texte une écriture scénique. Mais là, j’ai eu besoin de phases de répétitions pendant l’écriture pour voir comment des dispositifs scéniques pouvaient représenter les voyages, et du coup, nourrir l’écriture en retour. Je voulais par exemple un espace très mobile, que beaucoup de choses puissent circuler au plateau et créer des variations d’espace. La musique me sert aussi beaucoup à créer des circulations, à donner le sentiment d’un voyage en train par exemple. Mais, d’un autre côté, la scénographie est très simple : tout se passe dans une salle de répétition et les éléments de la salle servent à figurer les différents lieux. D’une certaine façon, tout ce voyage est aussi un voyage immobile parce que ce n’est pas forcément en bougeant qu’on bouge. Le corps immobile déplace beaucoup de choses.
Jouez-vous aussi sur les langues pour donner le sentiment du mouvement ?
Il y a le témoignage des personnes rencontrées, alors on entend du finnois, du danois, du serbe, de l’italien. Mais ce jeu sur les langues est surtout une façon pour les comédiens de se demander que faire au plateau. Ils reconnaissent volontiers qu’ils ne parlent pas toutes ces langues et alors faut-il parler anglais ? sous-titrer ? C’est un double mouvement constant dans la pièce : on voit toujours le résultat et le processus, c’est-à-dire les acteurs au travail. Au début du spectacle, un directeur de théâtre demande à un groupe d’acteurs de raconter une histoire vraie, le genre de spectacle que le public est supposé aimer aujourd’hui. Les comédiens se demandent : qu’est ce que raconter une histoire vraie ?, mais au bout d’un moment, à force de ne plus quitter la salle de répétition, ils finissent par inventer un projet de vie en commun. Les deux choses avancent de concert : l’enquête et la vie du groupe.
Dans les romans policiers, il y a souvent un narrateur. Est-ce le cas aussi dans Benjamin Walter ?
En fait, il y a deux sortes de scènes : des scènes jouées, et d’autres racontées. En général, les scènes de solitude sont prises en charge par le récit. Raconter la flânerie dans une ville, le rapport à l’espace urbain, la dimension psychogéographique de la déambulation est plus aisé par le récit que par les dialogues. Même si, dans Benjamin Walter, les récits sont pris en charge par plusieurs voix, ce qui permet de faire entendre les voix diverses qui s’entrecroisent à l’intérieur d’une même tête.
A voir voyager Frédéric à la recherche de l’écrivain volatilisé, on se dit que l’image documentaire est presque un médium obligé de la pièce.
Au début, bien sûr, il y a plein d’images. Frédéric part comme un touriste d’aujourd’hui avec ordinateur, appareil photo, téléphone. Grâce à quoi on peut tout enregistrer mais on s’aperçoit assez vite qu’en accumulant des images, on n’en sait pas plus. Les images finalement ne racontent rien. Au fur et à mesure, il y a donc une sorte d’abandon de la technologie. Paroles et écriture prennent le relais. Le personnage se met à envoyer des cartes postales et les comédiensenquêteurs à découper des images. Car, au fond, ce n’est pas l’image qui raconte mais la façon de l’utiliser, de l’inclure dans un montage.
L’histoire de Benjamin Walter, écrivain qui cesse d’écrire, évoque peut-être encore plus que Walter Benjamin, l’œuvre de l’écrivain espagnol Vila-Matas.
Oui, c’est une pièce qui doit énormément à Vila-Matas. Au début de la pièce, le directeur de théâtre refuse un projet qui tourne autour de Vila-Matas, Bolaño et Sebald. Il veut quelque chose de plus « grand public », une histoire vraie qui séduise le public. Mais la pièce qu’on joue s’inscrit dans cette lignée. Il y a quelque chose qui me hante dans la disparition ou le retrait du monde. Se retirer du monde pour mieux y être, disparaître pour mieux s’inventer, se déposséder pour retrouver une façon de se posséder. C’est ce que questionne cette pièce : quelle est la bonne façon d’être au monde ?
Propos recueillis par Stéphane Bouquet
- Une pièce documentaire
Benjamin Walter se présente comme une pièce documentaire, en ce qu’elle prétend tenter de retranscrire une expérience vécue, celle de la quête, à travers l’Europe, d’un auteur disparu. Ce faisant, son projet est d’en interroger la possibilité même : comment retranscrire la réalité, comment dire ce qui a été vécu, comment témoigner d’une expérience ?
Elle pose d’emblée la question de la représentation et du glissement que celle-ci opère. Alors que les moyens à notre disposition pour saisir/capter le réel n’ont jamais été si nombreux, sommes-nous pour autant plus avancés pour restituer ce qui a été, pour dire le monde ? C’est alors la question de la trace et de la mémoire qui se pose. Quelles traces laissons-nous ? De quelles traces dispose-t-on pour reconstituer le passé ? La mémoire semble être la seule véritable dépositaire de la chose vécue, mais n’est-elle pas déjà elle-même une reconstitution, un montage, une fiction.
Tout souvenir n’est-il pas, d’emblée, une trahison, un mensonge ? Le document (texte, photo, enregistrement sonore ou vidéo) pourrait être alors l’élement sur lequel s’appuyer, témoin objectif, il atteste d’une réalité. Mais, pour autant, toute réalité n’existe-t-elle que par les documents que l’on peut en fournir, que par la représentation que l’on en donne ? La pièce sème ainsi très vite le trouble sur sa nature même. Que doit-on croire de ce qui nous est raconté ? Qu’est-ce qui est vrai dans toute cette histoire ? Et, plus que de démêler le vrai du faux, en quoi la pièce est-elle différente si tel ou tel événement n’est en réalité que pure invention ? Toute la pièce n’a ainsi de cesse de jouer avec cette question du vrai et du faux pour mieux interroger les liens entre littérature et réel.
- La pratique du montage comme mode d’investigation
L’enquête menée sur la disparition de Benjamin Walter
Elle va nous conduire à nous intéresser à deux œuvres, l’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg et le Livre des passages de Walter Benjamin, dont on découvrira qu’elles avaient toutes deux retenu l’attention de notre auteur avant de disparaître et qui, chacune à leur manière utilise la pratique du montage comme mode de connaissance. Parallèlement, l’enquête elle-même utilise cette pratique comme mode d’investigation.
l’Atlas Mnemosyne
L’Atlas Mnémosyne est l’œuvre à laquelle se consacre Aby Warburg, historien de l’art allemand, de 1924 jusqu’à sa mort. C’est un grand atlas d’images destiné à rendre visibles les « survivances » de l’Antiquité dans la culture occidentale. Il se présente sous la forme d’un ensemble de photographies d’œuvres d’art accrochées sur des grands panneaux noirs afin de pouvoir les faire dialoguer les unes avec les autres, les faire entrer en résonances. Mais, pour reprendre les mots de Georges Didi-Huberman : « l’Atlas Mnémosyne n’est pas qu’un album d’images ou qu’un simple outil comparatif, il s’agit d’une forme nouvelle de collection et d’exposition des images, d’une méthode expérimentale de pensée par le montage. »
Le livre des Passages
Le Livre des Passages est un projet inachevé auquel a travaillé Walter Benjamin pendant la dernière partie de sa vie. C’était un projet qui devait s’articuler autour de la figure de Baudelaire pour élaborer une œuvre qui se voulait non seulement une « histoire sociale de Paris au xixe siècle », mais une tentative d’interprétation globale du xixe siècle. Le projet du Livre des Passages avait ceci de particulier qu’il devait être constitué en majeure partie de citations et que l’encadrement théorique et l’interprétation devait être réduits au minimum, pour reprendre les mots de Walter Benjamin : « La méthode de travail : le montage littéraire. Je n’ai rien à dire. Seulement à montrer. » Comme l’explique Theodor Adorno : « Dans le Livre des Passages, l’intention de Walter Benjamin était de renoncer à toute interprétation et de ne faire surgir les significations que grâce au choc provoqué par le montage des documents. »
Le mur d’investigation
Ce motif du film policier est l’application du principe de connaissance par le montage à l’enquête policière. Benjamin Walter se présente comme une vaste enquête à la recherche d’une personne disparue, et reprend donc (dans la deuxième partie de la pièce, après l’entracte) le principe de mise en relation, sur un mur, des indices retrouvés comme mode d’investigation, méthode de travail, afin de faire surgir une nouvelle signification née de leur agencement. La pratique du montage est ici une façon d’interroger le sens de chaque réel élément récolté en le rapprochant d’autres. Le montage ici n’est pas appréhendé en tant que forme, mais en tant que geste, en tant que mode opératoire, moyen de mettre à jour de nouvelles significations, des sens cachés, contenus dans chaque indice mais qui ne peuvent être révélés que par leur confrontation avec un autre, dans un dialogue avec celui-ci.
Frédéric Sonntag
Benjamin Walter – Bande-annonce
Sélection d'avis des spectateurs - Benjamin Walter
c'est génial Par RAPHAEL M. - 4 mars 2017 à 11h58
passionnante, haletante plongée dans une enquête policière-litéraire-philosophique; c'est vraiment saisissant.
Moyenne des avis du public - Benjamin Walter
Pour 1 Notes
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
c'est génial Par RAPHAEL M. (1 avis) - 4 mars 2017 à 11h58
passionnante, haletante plongée dans une enquête policière-litéraire-philosophique; c'est vraiment saisissant.
Informations pratiques - Théâtre de la Cité Internationale
Théâtre de la Cité Internationale
17, boulevard Jourdan 75014 Paris
- RER : Cité Universitaire à 157 m
- Tram : Cité Universitaire à 32 m
- Bus : Cité Universitaire à 227 m, Stade Charléty - Porte de Gentilly à 320 m, Jourdan - Montsouris à 358 m
Plan d’accès - Théâtre de la Cité Internationale
17, boulevard Jourdan 75014 Paris