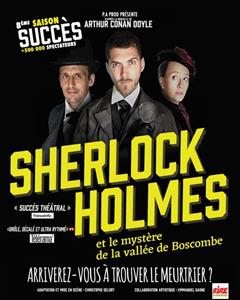Coriolan
Coriolan
Résumé
Note du metteur en scène
L’histoire de Coriolan
La tragédie d'une société
Etre seul face aux autres
La presse
Écrite en 1608, Coriolan est l’ultime tragédie de Shakespeare. Brecht la considérait comme « l’une des plus grandioses œuvres » de son auteur. Elle est pourtant peu représentée. C’est parce qu’elle fait peur. N’a-t-on pas vu avant guerre, dans l’aventure du général qui a sauvé la cité, auquel les tribuns de la plèbe refusent le consulat et qui du coup pactise avec les ennemis de Rome, une justification du coup d’État, voire du fascisme ?
Jean Boillot, metteur en scène associé au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis (où il a présenté, en 2001, après Avignon, une réalisation mémorable du Balcon, de Jean Genet) envisage Coriolan comme « une fable puissante et captivante », qui recèle quelque chose « d’étonnamment actuel, car, le premier, Shakespeare tente de penser le peuple comme un acteur de l’Histoire et fait sortir la tragédie des salles de trône et autres palais impériaux ».
Pour l’animateur du Théâtre à Spirale, « la logique de guerre du héros noble, son mépris du peuple, sont tout autant justifiés par la démagogie de la cité que condamnables pour leur violence de classe », tandis que « les revendications du peuple, révolté par la famine et l’exploitation subies, sont tout autant légitimes que soumises à la critique d’une versatilité et d’une inquiétante inconstance ».
Monter Coriolan aujourd’hui c’est, selon Jean Boillot, donner au théâtre, « non la mission de guider ou délivrer un message, mais de faire entendre une polyphonie, historique, sociale, intime » permettant à chacun de s’interroger sur sa place dans la cité.
Electeurs, spectateurs et représentants
2ème tour de l’élection présidentielle 2001 : éclipse par l’abstention d’un candidat sensé représenter la sensibilité d’une grande partie de la population.
2003 : création d'un protocole d’accord à propos de l’intermittence du spectacle, contre l’avis des artistes, dans la quasi-indifférence du grand public.
Crise du politique, du « vivre ensemble », et crise de l’esthétique, du « sentir ensemble ».
Certains ont vu une relation entre ces deux événements, les symptômes d’une crise plus large de la représentation symbolique dans notre démocratie. Comme si électeurs ou spectateurs ne se reconnaissaient plus dans ceux qui sont sensés les représenter. Comme si hommes politiques ou acteurs ne jouaient plus leur rôle.
Vivre ensemble / jouer ensemble
J’ai ainsi souhaité monter Coriolan de Shakespeare, où politique et théâtre sont intimement mêlés. Le sujet de la pièce, la fabrique du politique, coïncide avec sa mise en œuvre, le jeu théâtral. La métaphore de Shakespeare, " le monde est un théâtre " devient " le monde politique est un théâtre " et réciproquement. La tribune est une et la scène est une tribune.
La pièce de Shakespeare retrace l’avènement de la démocratie dans les débuts de la république romaine. Suite à une famine due au prix excessif du blé, le peuple se révolte contre le pouvoir patricien. Celui-ci doit faire face à une nouvelle attaque des ennemis de toujours, les Volsques. Il doit retrouver cette " concorde " au plus vite. Le peuple obtient le droit d’élire deux tribuns au Sénat pour représenter ses intérêts.
C’est l’invention du politique et du dialogue : cette nouvelle formule du pouvoir doit garantir le « vivre ensemble » pacifique, non plus dans la ressemblance aristocratique mais dans la différence qui sépare patriciens et plébéiens, dans l’altérité.
Corps politiques
Les personnages de Coriolan n'ont pas d'existence en dehors du débat qui a pour objet le droit à l’existence dans le corps politique. Ils représentent des sensibilités politiques. Ils en sont traversés, émus, blessés, métamorphosés.
La démocratie sitôt inventée, est fragilisée : patriciens qui ne veulent pas renoncer à leurs privilèges, plèbe mal éduquée, hommes politiques peu soucieux du collectif, manipulation, privation progressive de l’exercice direct de la démocratie… Toutes ces perversions sont déjà présentes.
Caius Martius Coriolan est un général patricien incorruptible. Considéré comme le sauveur de la nation, il est l’emblème de ceux qui refusent le dialogue avec le peuple et qui pensent qu’il faut l’affamer pour garantir la survie de Rome. Première victime de ce nouveau régime, il est banni et quitte Rome en pensant qu’ « il y a une vie ailleurs », hors de cette communauté politique qu'il pense corrompue. Sa fin tragique lui apprendra que l’Histoire maintenant, ne peut se faire que dans ce dialogue fragile qu’on appelle la démocratie.
Jean Boillot
Septembre 2004
Dernière tragédie, écrite en 1608 par Shakespeare, La Tragédie de Coriolan se présente sous le signe du paradoxe : d'une part, elle est une des pièces la moins représentée de l'illustre auteur, d'autre part, elle est considérée par B. Brecht comme " une des plus grandioses oeuvres " du dramaturge élisabethain.
Le destin exceptionnel d'un héros contre sa cité
Dans la lignée de Lear, Othello ou Macbeth, Coriolan est d'abord la tragédie d'une grande individualité, " arrachée à toutes ses attaches humaines, la famille, la caste et l'État " (Brecht). Patricien et homme de guerre, Coriolan est à la fois le sauveur de Rome et l' " ennemi numéro un du peuple " .
Alors qu'il va obtenir le consulat, confronté aux tribuns de la plèbe de la jeune république romaine, le héros, se voit banni de sa Cité, sans autre ménagement. Dès lors, il rejoint ses ennemis de la veille pour ruiner Rome et assouvir une vengeance implacable.
Aussi, cette fable, puissante et captivante, recèle quelque chose d'étonnamment actuel. Le premier, Shakespeare tente de penser le peuple comme un acteur de l'Histoire et fait sortir la tragédie des salles de trône et autres palais royaux. Coriolan, sur fonds de révoltes, de famines et de guerres, jouera son destin sur le forum et fera entendre les divisions et les failles qui fragilisent l'unité de la République.
Une tragédie de la société
Car, par-delà le destin exceptionnel d'un personnage tragique, dévoré par la Cité qu'il a sauvée, puis menaçant de la dévorer à son tour, Coriolan se veut également la tragédie d'une société où les idéologies, les intérêts privés, les désirs entrent dans un mouvement de perpétuel conflit.
La trajectoire du héros ne fait que révéler la monstrueuse relativité de l'Histoire où aucune vérité, aucun point de vue ne sont, en dernière instance, sauvés. La logique de guerre du héros noble, son mépris du peuple, sont tout autant justifiés par l'hypocrisie et la démagogie de sa cité que condamnables pour leur violence de classe. Les revendications du peuple, révoltés par la famine et l'exploitation subies, sont tout autant légitimes que soumis à la critique d'une versatilité et d'une inconstance inquiétante…
La jeune République romaine devient le théâtre et la métaphore de toute communauté où Justice et Vérité ne sont que des arguments de mauvaise foi, servant tels ou tels intérêts particuliers…
Tel est le monde sombre, déployé par Shakespeare, qui nous donne à réfléchir sur notre cité, notre espace public…Un théâtre où les points de vue se frottent et se heurtent les uns aux autres, laissant au spectateur le soin de construire " sa vérité " …
Une guerre en chacun de nous
Mais la tragédie de Coriolan va plus loin encore, chaque personnage lui-même est traversé de discours et de pulsions contradictoires… La guerre de Rome contre elle-même (ou contre ses adversaires) devient métaphorique d'une autre guerre, livrée celle-ci en chacun de nous : la pièce de Shakespeare fait de notre intériorité le principal champ de bataille…
À l'instar de Coriolan, le spectateur est mis face à sa propre polyphonie intime - on devrait dire peut-être cacophonie. En chacun, l'intérêt public, les intérêts économiques ou de classe, l'intérêt privé, le besoin animal et les motivations inconscientes (il faudrait parler ici de l'étrange relation qui unit Coriolan à sa mère) se livrent une guerre sans merci et nous interrogent sur nous-mêmes.
Tel serait pour nous l'intérêt de monter aujourd'hui Coriolan : donner au théâtre, non la mission de guider ou de délivrer un message, mais de faire entendre cette polyphonie, à la fois historique, sociale et intime, qui interroge chaque spectateur sur lui-même et la place qu'il occupe dans le fonctionnement de la Cité.
Olivier Chapuis, traducteur
L’histoire de Coriolan se passe alors que les rois viennent d’être chassés, à l’époque semi-légendaire de la naissance de la république romaine. Tite-Live la mentionne brièvement ; Plutarque, dans ses Vies des Hommes illustres, en parle longuement. La traduction anglaise de Plutarque parut en 1579. C’est là que Shakespeare a puisé la trame du drame, les caractères et le déroulement des faits.
Rome combat les tribus voisines ; dans Rome même, c’est une lutte de tous les instants des pauvres contre les riches. « … il advint que le sénat, soutenant les riches, entra en grande dissension avec le menu peuple, lequel se sentait trop durement traité et oppressé par les usuriers, qui leur avaient prêté quelque argent, parce que ceux qui avaient quelque peu de quoi en étaient privés par les créanciers, qui leur faisaient saisir ce peu de bien qu’ils avaient, à faute de payer les usures, et puis conséquemment décréter et vendre au plus offrant pour être payés ; et ceux qui n’avaient du tout rien étaient eux-mêmes saisis au corps, et leurs personnes détenues en servitude (…) Le Sénat faisait l’oreille sourde montrant ne se point souvenir des promesses qu’il leur avait faites, mais les laissant emmener comme esclaves en servitude par leurs créanciers, et souffrait qu’ils fussent dépouillés de tous leurs biens, adonc commencèrent-ils à se mutiner ouvertement, et à émouvoir de dangereuses et ouvertes séditions dans la ville (1). »
Les patriciens s’enrichissent dans les guerres. Ils s’emparent de terres et d’esclaves. Mais sans la plèbe, on ne saurait faire la guerre. Les plébéiens obtiennent le droit d’élire leurs propres tribuns et de participer au gouvernement.
Le plus vaillant des Romains est Caïus Marcius, d’une vieille famille de patriciens. Après avoir conquis sur les Volsques, tribu de montagnards, la ville de Corioles, il a reçu le surnom de Coriolan. Il a bien mérité de Rome, il est un grand chef de guerre, son corps porte la marque des vingt-sept blessures reçues de l’ennemi. Les patriciens proposent Coriolan à la dignité de consul. Pour cela, l’accord de la plèbe est nécessaire. Coriolan est un aristocrate, il hait le peuple et en est détesté. À Rome, c’est la famine. Coriolan s’oppose à la vente du blé, il exige que la plèbe renonce tout d’abord à élire ses tribuns. Indigné, le peuple lui refuse le consulat. Les tribuns l’accusent de violer les lois de la république. Coriolan comparaît devant le tribunal. Le peuple arrache aux patriciens une sentence condamnant Coriolan au bannissement perpétuel. Coriolan n’a plus qu’un rêve : se venger. Il se rend chez les Volsques et propose à ses ennemis d’hier une expédition en commun contre Rome. Il en prend la tête.
Tel est le premier chapitre de la légende romaine de Coriolan. Elle comporte une morale républicaine. Le chef qui méprise le peuple trahit la patrie et passe du côté de l’ennemi, le général ambitieux qui aspire à un pouvoir dictatorial est un danger mortel pour la république. Le peuple a eu raison de chasser Coriolan. Mais voici à présent le second chapitre de l’histoire. Coriolan, à la tête des Volsques, arrive aux portes de Rome. La ville n’a pas de chefs, elle est sans défense et condamnée à la perte. Plébéiens et patriciens s’accusent mutuellement du bannissement de Coriolan. Ils essaient d’obtenir son pardon. En vain. Ils implorent sa pitié. Sans effet. Alors les Romains envoient en délégation à Coriolan sa femme et sa mère. Coriolan s’éloigne des portes de la ville. Il accepte de conclure la paix et ramène à Corioles l’armée ennemie.
Suivent deux épilogues. Le premier, que donne Tite-Live, est sentimental et idyllique. Les Romains reconnaissants élèvent un temple à la gloire de la mère et de la femme de Coriolan, tandis que lui-même retourne auprès des Volsques où il vit très vieux et meurt l’âme tranquille. Le second épilogue est bien plus dramatique. Coriolan sait qu’en s’éloignant de Rome, il a signé sa condamnation à mort. Il a trahi une seconde fois, il a rompu l’accord passé avec les Volsques. Et les Volsques le tuent, parce que traître.
(1) Plutarque, les Vies des Hommes illustres, traductions de Jacques Amyot, tome I, p. 475-476, Ed. de la Pléiade, paris, 1937.
Jan Kott, in Shakespeare, notre contemporain.
©Editions Payot
Le nom fait drapeau, oriflamme : Coriolan. Ça lui vient de Corioles, la ville où il s’est retrouvé, en pleine bataille, seul contre tous ; « réellement ». Il porte un nom de lieu, du lieu où il fut renommé au moyen de son symptôme : être seul face aux autres ; les autres étant une foule, une ville, des « amis », un collectif, les conditions d’un lien social. Et lui, il serait là, de l’autre côté, à clamer sa vérité plutôt banale : droiture entêtée, intégrité… Il jouirait d’être le haut-parleur de sa vérité. Il est renommé par une malédiction : celle de ses démêlés avec le « nom », sa quête d’un renom sans réplique, d’un nom qui l’identifie à ses actes, à son mérite que les autres seraient forcés d’accorder, etc. Tout un programme.
Être enfermé seul dans une ville tout entière ennemie, et s’en sortir : Shakespeare aime ces gestes de pur théâtre, surtout quand l’histoire les fournit (ici, la source est Plutarque, il n’y a rien ajouté.) Or, cet événement « réel » scelle l’impasse symbolique du héros, celle d’une nomination totale, achevée : dans Corioles il y a le peuple qui se défend, il y a cette machine de guerre qu’est Marcius (Coriolan) et il y a la mort qu’il doit donner sans cesse comme un faucheur qui abat tout sur son passage pour arracher à ladite mort une nouvelle trace de… renom, une confirmation de son nom, encore une. Et à côté, derrière, il y a la Mère-patrie, incarnée par sa mère à lui. Volumnie, qui lance son fils bien-aimé tel un engin invincible contre cette Autre-femme qu’est la mort pour qu’il gagne sur elle… un nom dont il soit l’auteur, lui seul - sa mère étant l’auteur ultime et préalable…
À travers les ravages du brave Coriolan, il y a la guerre que sa mère déclare aux autres, aux autres qu’elle méprise et à la mort qu’elle défie. C’est donc une tragédie de la nomination absolue : avec quoi est-on nommé ? Qu’y-a-t-il dans un nom ? disait Juliette. Décidément…
Cela éclaire la compulsion de Coriolan : il provoque les autres, il les pousse à l’exclure, pour avoir face à lui un témoin vierge et sans mélange, une négation qui frise la mort et sur fond de laquelle il doit inscrire encore, comme pour la première fois, son nom signé par lui, tiré par lui chaque fois d’un néant renouvelé ; réinscrit chaque fois avec d’autant plus de mérite que le support est plus rétif, plus hostile. Dites-moi non pour que je puisse forcer ce non à fonder mon renom, à l’affirmer de votre refus. Épreuve de force contre la grâce.
Daniel Sibony, in Avec Shakespeare : éclats et passion en douze pièces
©Editions Le Seuil, collection Points « essais »
" Jean Boillot s’attaque à Coriolan de Shakespeare, tragédie à plus d’un titre redoutable. Il voit, pour l’essentiel, dans l’histoire du patricien en armes qui refuse de flatter la plèbe pour devenir consul, préférant pas dépit pactiser avec l’ennemi qu’il terrassa naguère, le difficile apprentissage de la démocratie, telle du moins qu’on l’entend aujourd’hui. Pourquoi pas ? Les chefs-d’œuvre d’hier ne peuvent-ils concourir à ouvrir nos yeux ici et maintenant ? (...) Quelle leçon tirer de la fable de Shakespeare ? Versatilité du peuple ? Orgueil démesuré du guerrier sûr de lui ? Embrouillaminis des combines politiciennes ? Il y a tout ça, bien sûr. (...) On apprécie néanmoins le jeu plus fin de Pierre-Alain Chapuis (Menenius) ou la prestation élaborée de Joséphine Derenne dans le rôle de Volumnia. " Jean-Pierre Léonardini, L’Humanité, 8 novembre 2004
" (...) David Ayala incarne le tyran obsessionnel, l’air sauvage et autoritaire, qui se refuse à toute démagogie et ne voit en la plèbe qu’une hydre méprisable. Ses pairs ne valent guère mieux avec leur film de propagande contemporaine, une métaphore appuyée de leur supériorité aristocratique (...). La mère abusive du héros - Joséphine Derenne majestueuse- fait de son fils ce qu’elle entend et exige en dû le renom. Quant à l’épouse, Isabelle Ronayette, elle s’échappe des controverses, consciente peu à peu de l’abus magistral de son puissant mari. La frêle Anne Rejony - figure de la plèbe en coryphée - pousse les chariots des champs de bataille sur lesquels se pavanent les nobles guerriers. Nulle solution n’est apportée à cette réflexion morale, les polarités de droite et de gauche s’annulent mutuellement. En échange, une réussite théâtrale à susciter la dialectique, sur le plateau comme chez le public. Et à l’intérieur de soi, pour que se taise la guerre. " Véronique Hotte, La Terrasse, Novembre 2004
" (...) La force magnifique du dramaturge c'est de laisser entendre, à chaque mot, à chaque pas, l'ambivalence qui est le sang et l'encre de tout homme. Evidemment, il y a une « histoire ». Celle du plus magnifique des Romains, Caius Marcius. S'appuyant sur une traduction scrupuleuse, le spectacle n'est pas sans intérêt mais on n'adhère pas aux partis pris de jeu. (...) Saluons Joséphine Derenne, la mère, sensible, aristocratique et le sobre et profond Pierre-Alain Chapuis. Il y a un rythme à trouver. Un mouvement. C'est lourd, lent, pas assez ambigu. Mais la pièce est un pur joyau. " Armelle Héliot, Le Figaro, 3 novembre 2004
Sélection d'avis des spectateurs - Coriolan
Coriolan Le 10 novembre 2004 à 13h39
Jaimerais poser une question par rapport à la isposition du décors: Pourquoi l'avoir constitué d'une tribune?
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Coriolan Le 10 novembre 2004 à 13h39
Jaimerais poser une question par rapport à la isposition du décors: Pourquoi l'avoir constitué d'une tribune?
Informations pratiques - TGP - CDN de Saint-Denis
TGP - CDN de Saint-Denis
59, boulevard Jules Guesde 93207 Saint-Denis
- Métro : Basilique de Saint-Denis à 666 m (13)
- RER : Saint-Denis à 534 m (D)
- Tram : Théâtre Gérard Philipe à 89 m (T1), Saint-Denis - Gare à 387 m (T8), Marché de Saint-Denis à 395 m (T1/T5)
- Bus : Église - Théâtre Gérard Philipe à 265 m, Marché de Saint-Denis à 361 m
- Transilien : Saint-Denis à 534 m (H)
-
Voiture : Depuis Paris : Porte de la Chapelle - Autoroute A1 - sortie n°2 Saint-Denis centre (Stade de France), suivre « Saint-Denis centre ». Contourner la Porte de Paris en prenant la file de gauche. Continuer tout droit puis suivre le fléchage « Théâtre Gérard Philipe » (emprunter le bd Marcel Sembat puis le bd Jules Guesde).
Plan d’accès - TGP - CDN de Saint-Denis
59, boulevard Jules Guesde 93207 Saint-Denis