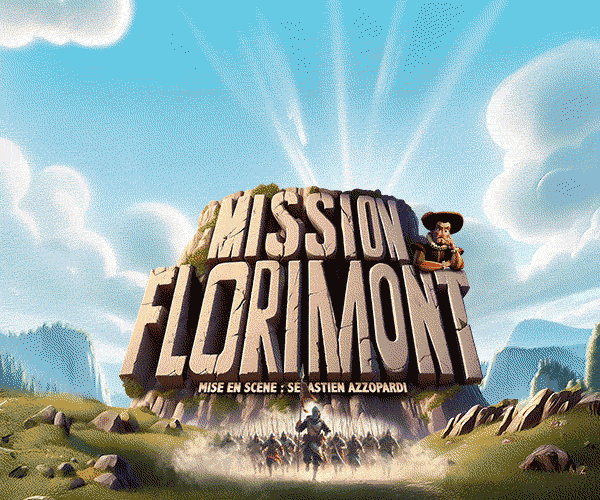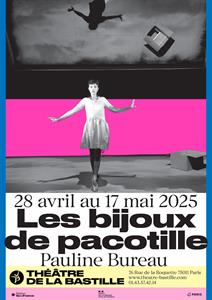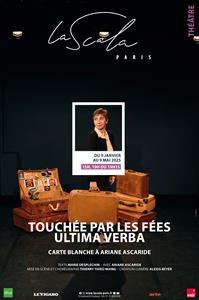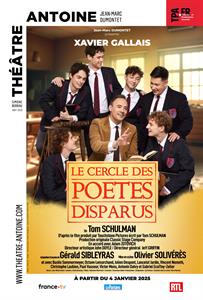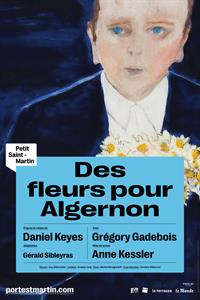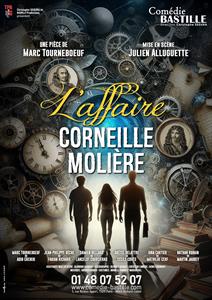La mécanique des femmes
La mécanique des femmes
- De : Louis Calaferte
- Mise en scène : Xavier Lukomski
- Avec : Véronique Sonck, Sandrine Laroche, Estelle Lannoy, Jean-Michel Vovk
Présentation
Notes de mise en scène
Théâtre des deux Eaux et Xavier
Lukomsky
La mécanique des femmes, parle du sexe tel que Louis Calaferte l'imagine vécu, ressenti par une femme. Avec une mise en scène qui allie trois langages - texte, image et musique - la Mécanique de femmes nous renvoie aux questions profondes, vitales que nos faims sexuelles peuvent cacher.
De la Mécanique des Femmes à la Mécanique du Monde
La Mécanique des Femmes, lors de sa sortie en 1992 fut aussi accusée de pornographie.
D'un point de vue légal, cette accusation peut d’ailleurs se comprendre. Elle
n'enlève rien, bien au contraire, à la force et à l'importance du texte. A ce propos,
dans un entretien avec Jean-Pierre Pauty pour un film malheureusement inédit* (censure
toujours), Calaferte parlait de "malentendu total". Car s'il est effectivement
question de sexe et ce dans les mots les plus crus, ces mots pornographiques sont les mots
d'une recherche métaphysique très particulière et très paradoxale, les mots du sexe
comme initiation à la mort, une sorte de métaphysique du désespoir, de la mécanique
des femmes à la mécanique du monde.
De La Mécanique Du Monde À La Mécanique Du Théâtre
Créer La Mécanique des Femmes au théâtre a pu paraître paradoxal vis-à-vis de
l’œuvre d'un dramaturge aussi prolifique. Ce texte, en effet, qui n'est pas un
roman, n'est pas non plus un texte dramatique. Mais c'est justement la difficulté de le
classer dans un genre littéraire reconnu qui lui a donné, à nos yeux, un intérêt
théâtral. Sans lui donner de sous-titre, Calaferte l'a fait classer dans sa
bibliographie comme "récit", soulignant par là que cette écriture en forme
courte, elliptique, allusive tient d'abord sa forme de la parole. Il paraissait donc
intéressant de porter cette parole sur une scène.
De la mécanique du récit à la Mécanique de la Parole
Dans le même entretien avec Jean-Pierre Pauty, Calaferte opposait un "érotisme de
la conscience", un "érotisme théâtralisé" qui "ne l'intéresse
pas" à un "érotisme de l'inconscient" qui "demande réflexion. Nous
sommes là dans l'extrême sensibilité de l'individu [...] qui entraîne une forme de vie
ultra-délicate, qui refuse les contingences pesantes. D'une certaine manière, c'est là
où le sexe rejoint la spiritualité, au spiritualisme. Nous atteignons entre êtres, d'un
être à l'autre, les zones les plus insaisissables, les plus sensibles, les plus
précieuses..."
C'est donc bien ce théâtre de parole qu'induit la qualification de "récit"
que nous avons tenté de mettre en scène, au milieu d’un dispositif scénique qui
s’est voulu d'abord un support narratif autonome. Cinq personnes, ayant le même
statut, sont présentes sur scène. Deux comédiens, une femme et un homme, ayant en
charge la parole du récit; une chanteuse et son accompagnatrice, ayant en charge
l’expression d’une émotion plus “ viscérale ” et un “
photographe-scénographe ” créant et recréant sur l’instant une scénographie
composée d’un certain nombre d'écrans, dont la disposition est pensée "en
soi", comme une pure installation plastique, sur laquelle sont projetées des photos,
figuratives ou non, qui ne sont pas là pour illustrer la parole, mais bien pour lui
répondre, lui donner un pendant formel, à la fois matière (des images) et immatériel
(la lumière), fait de sensations, de tensions esthétiques, de climats.
Théâtre des deux Eaux et Xavier Lukomsky
Le Théâtre des 2 Eaux est fondé en juin 84.
La première création a lieu en octobre 85. C’est Un Jour Mon Prince
Viendra... d'après Blanche Neige des frères Grimm, au Théâtre de la
Balsamine.
Nous travaillons peu à partir du texte original, mais plutôt sur les archétypes que
transporte le conte.
La structure narrative n’est pas linéaire, mais éclatée, construite sur une
accumulation de moments : recherche de climats, de rythmes... Un spectacle en forme de
chœur, à voix multiples.
En Février 88, nous créons : Il y a Parfois des Tempêtes"d'après
Lulu de F. Wedekind. La base est donc, cette fois-ci, un texte
dramatique. Mais là encore, c'est sur l'archétype que représente Lulu que nous
travaillons.
Dans un vaste mouvement d'ensemble, nous ferons porter sur les frêles épaules de la
pauvre Lulu, toute l'histoire d’un XXème siècle des passions. Nous serons victimes
de ce que certains ont appelé le “ syndrome de la seconde création ”. Bref, ce
sera un échec. Le spectacle sera incompris et c’est évidemment à ce jour celui que
j’aime le plus.
Quoi qu’il en soit, l'évidence de ces deux spectacles, est que notre démarche est
d’abord une démarche de recherche sur la forme. Avant tout une démarche
d'écriture, même s’il s’agit d’une “ écriture de plateau ” qui
emprunte ses mots (son texte), à la littérature, la plupart du temps non-dramatique.
L’échec de Il y a Parfois des Tempêtes se paiera par du
temps. Après un long et obstiné combat de mise en production, nous créons “ La
Bonne Vie ” de Michel Deutsch, au Théâtre Varia en février 94. Notre premier
"véritable texte de théâtre". Mais là encore, il s’agit d’une
écriture en forme de collage, que certains ont classé dans le théâtre dit du “
quotidien ”, mais que nous traitons dans une certaine abstraction. Si le quotidien
est bel et bien présent, il n’a rien de naturaliste et sert d’abord à une
réflexion philosophique sur la place de l’homme dans le monde. La scénographie, à
base d’images enchâssées dans des caissons lumineux, est l’œuvre
d’un plasticien français : Marc Rosensthiel. Un dispositif dont nous nous
inspirerons pour la “ Mécaniques des Femmes ”, en
collaboration cette fois avec le photographe-plasticien : Jorge Leon.
En octobre 96, après un long atelier de préparation, nous créons Donne
moi tes yeux, j'ouvrirai une fenêtre sur ma caboche, montage de textes à
partir de l’œuvre de l’auteur russe Daniil Harms, au Théâtre de la
Balsamine. Le spectacle, co-produit par la Balsamine, le Théâtre Arc en Ciel de Rungis
et la Maison de la Culture de Tournai, sera un gros succès public et critique. Il
tournera en région parisienne et nous le reprendrons en février 99 à la Chapelle des
Brigitinnes. C’est aussi la rencontre avec un auteur vis-à-vis duquel j’ai un
sentiment de quasi-fraternité. Un auteur sur lequel nous retravaillerons bientôt.
En septembre 99, pour la réouverture du Théâtre Les Tanneurs, nous créons un autre
montage de textes courts, La Mécanique des Femmes, d'après
Louis Calaferte. Le spectacle est un gros succès public et nous le reprenons, avec le
même succès, en avril 2001. C’est depuis cette création que nous sommes devenu
“ compagnon ” du Théâtre Les Tanneurs pour une durée de trois saisons.
En septembre 2000, nous créons, dans le cadre du Marathon Européen de la Création
Théâtrale, L’Europe, L’Europe ! ! ! de
l’auteur tchèque Marek Pivovar. C’est la aussi le début d’une
collaboration qui trouvera un prolongement par une création au Théâtre National
d’Ostrava dans le courant de la saison 2002/2003.
En mars 2000, nous créons, Au Théâtre Ce Soir
d’après Roland Dubillard au Théâtre Arc en Ciel de Rungis. Une expérience
très enrichissante de théâtre en appartements, forme oh combien particulière, mais qui
s’adapte bien à une de nos préoccupations principale, un contact le plus direct et
le plus simple possible au public.
En Mai 2001, dans le cadre du Festival du monologue, nous créons Quand
j’ai tué pour de vrai de Chantal Myttenaere. Un texte sur
l’enfance à la nostalgie énergique et joyeusement destructrice.
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Théâtre d'Angoulême
Théâtre d'Angoulême
Avenue des Maréchaux 16007 Angoulême