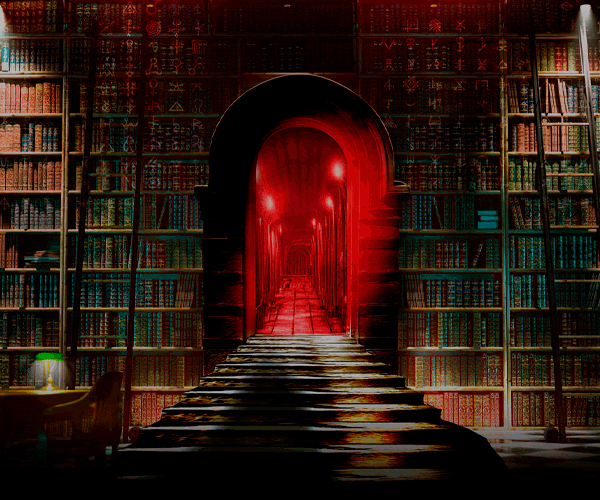Les Gens
Les Gens
- De : Edward Bond
- Adaptation : Michel Vittoz
- Mise en scène : Alain Françon
- Avec : Dominique Valadié, Pierre-Félix Gravière, Alain Rimoux, Aurélien Recoing
Les Gens - Photographies
- Un no-man’s land
Du dramaturge anglais Edward Bond, on connaît particulièrement en France les Pièces de guerre, montées en 1994 par le metteur en scène Alain Françon. La collaboration entre les deux hommes s’est avérée fructueuse, car à la suite, Edward Bond a composé la « Quinte de Paris », dont Les Gens est le quatrième opus (après Café, Naître, Le Crime du XXIe siècle et avant Innocence).
Ces pièces abordent la question de la déliquescence de la société occidentale. S’inspirant d’une phrase de Margaret Thatcher prononcée en 1987 (« La société n’existe pas. Il y a seulement des hommes, des femmes et des familles. »), Edward Bond s’interroge sur ce à quoi pourrait ressembler un futur proche si les hommes politiques faisaient de la destruction de tout lien social un vrai projet politique.
Fin du XXIe siècle, un no-man’s land, une terre vague – tombe ou berceau –, lieu de la décision finale où sont convoqués quatre personnages qui y cherchent la connaissance ; l’interaction avec le monde extérieur est presque réduite à la mémoire de ce qui s’est passé avant. Postern n’en finit pas de mourir dans cette tombe. Ken (Quelqu’un) doit y trouver sa vie en apprenant comment il est arrivé là et ce qu’il a fait. Margerson poursuit toujours son histoire comme s’il tournait en rond autour de sa mort. Lambeth trie les vêtements en attendant que meure Postern : elle passe en revue ce qui peut avoir de la valeur et ce qui n’en a pas, ce qui lui permet d’évoquer la communauté des gens qui les portaient et d’indiquer les fondements de ce qui l’a fait s’effondrer. En découvrant qui il est (un exécuteur), Ken (Quelqu‘un) accepte la plénitude – et le fardeau – d’être humain, fardeau qu’il ne veut pas fuir, parce qu’au lieu de se trouver il se mentirait à lui-même.
- La presse
« Allant et venant sur un bout de terre obscur, Pierre-Félix Gravière, Aurélien Recoing, Alain Rimoux et Dominique Valadié sont les remarquables protagonistes de cette création forte et rude. Ils sont « les gens » délabrés qui – de silences en soliloques, de rétractations en éructations – imposent la présence corporelle, concrète, de vies qui nous malmènent et nous impressionnent... Ce cauchemar, très paradoxalement, finit par sonner comme une ode à l’existence. C’est tout le talent d'Edward Bond et d'Alain Françon : changer le charbon en diamant. » Manuel Piolat Soleymat, La Terrasse n°161, 23 janvier 2014
- Les gens
Les Gens est le quatrième volet d'un cycle de cinq pièces (Café, Le Crime du XXIe siècle, Naître, Les Gens, Innocence), qu’Edward Bond appelle aujourd’hui « Le cycle de Paris » et qu’il a dédié à Alain Françon. Pourquoi cette dédicace ?
En premier lieu c’est sans doute, comme Edward Bond le lui a souvent écrit, parce que les mises en scènes des pièces auxquelles il assistait au théâtre de la Colline lui donnaient envie d’écrire de nouvelles pièces, d’écrire « mieux » comme il le disait, de reprendre et travailler et décliner avec Alain Françon et ses acteurs tous les thèmes qui sont au centre de son oeuvre.
En second lieu c’est aussi un témoignage de reconnaissance, une façon de soutenir celui dont le moins qu’on puisse dire est qu’il aura beaucoup travaillé pour que le théâtre d’Edward Bond retrouve une place en France.
Une place, mais quelle place ? Là, les choses deviennent plus délicates. Si l’on revient très loin en arrière, plus de quarante ans, on sait en général que Bond a été scénariste ou dialoguiste pour Antonioni et Visconti, qu’il a fait scandale en Angleterre, que ses premières pièces ont été montées par Claude Régy, Patrice Chéreau, Peter Stein etc. Puis il disparaît pendant presque vingt ans des scènes françaises. En 1992 deux pièces sont montées au Théâtre de la Ville dont La Compagnie des hommes mise en scène par Alain Françon. À peu près soutenue par la critique la pièce finit par trouver son public après avoir très largement vidé la salle. On sait ensuite que les Pièces de Guerre montées en 1996 en Avignon furent un événement considérable et qu’il se fit une incroyable unanimité autour de la deuxième version de Dans la compagnie des hommes jouée cette fois au théâtre de la Colline.
Cette belle unanimité se transforma en pur scandale avec Café (sans doute un chef-d’oeuvre) pour devenir un véritable désastre médiatique avec Le Crime du XXIe siècle. Il est vrai qu’Edward Bond n’est pas un homme très agréable et que, malheureusement, se rendre agréable n’est pas vraiment son souci et surtout pas quand il écrit. Bizarrement, alors qu’il est loin d’être un cas isolé (pensez à Thomas Bernhard ou à Samuel Beckett), il semblerait que l’importance de la place qu’il occupe dans le mouvement théâtral de ces 20 dernières années, tiendrait hélas beaucoup plus à tout le mal qu’on peut dire de lui, qu’à l’attention réelle qu’on porte à son oeuvre. Dès lors on peut se poser la question de savoir si, aujourd’hui, cette oeuvre a vraiment un intérêt ou si la place qu’elle prend tient seulement au passé de son auteur et à tout le bruit désagréable qu’il a provoqué et provoque encore. À cette question s’en ajoute une autre : pourquoi Alain Françon, qui met en scène des auteurs comme Michel Vinaver, Tchekhov, Ibsen, Beckett, Feydeau, etc. éprouve-t-il le besoin de continuer à monter des pièces d’Edward Bond alors qu’il n’a même plus d’institution pour le soutenir ? Le fait-il pour entendre une fois de plus la rumeur désagréable à laquelle il faut s’attendre ? Veut-il vider une salle de plus pour qu’elle finisse par se remplir ? Seulement pour faire ce genre de bruit ? Pourquoi cette obstination ou cette fidélité ?
Est-il masochiste ou y aurait-il un malentendu ?… Voyons cela de plus près. Nous disons que le seul nom d’Edward Bond déclenche un bruit désagréable. Mais qu’est-ce que c’est que ce bruit, cette rumeur ? Eh ! bien, c’est que Bond, c’est toujours désespérant, que c’est sale et ultra-violent, qu’on n’arrête pas de tuer des bébés, que ça rabâche sans arrêt les mêmes choses, que ça fait la morale, que c’est terrible, que ça va, on a compris, qu’il a tout pris à Brecht sans savoir s’en servir, que c’est du vieux théâtre et en plus réaliste qui fait de la science -fiction complètement nulle et quand il est au sommet de sa forme, c’est le pompier de l’apocalypse !
Évidemment c’est concentré et donc un peu rude mais, hélas, tout cela a été dit et surtout redit à propos de pièces qui sont pourtant totalement différentes et qui, au fond n’ont strictement, rien à voir avec tout ça.
Comment faire pour que Les Gens échappe, ne serait-ce qu’une seconde à tous ces à priori ? Faut-il annoncer que Bond a changé ? Qu’il est enfin beaucoup plus moderne, que cette fois, il veut séduire ?… Faut-il réfuter une à une toutes ces affirmations et faire un panégyrique du génie qu’on traîne dans la boue ? Non, parce que ce serait trop long, très ennuyeux et sans doute très faux.
Mais alors que pourrait-on dire ? Peut-être, par exemple, qu’Edward Bond fait du théâtre et surtout du théâtre. Qu’il travaille avec des images, surtout des images et qu’il les fabrique avec des mots qui ordonnent des objets et des actes élémentaires. Tout est toujours très simple. C’est peutêtre ça qui est bizarre.
Vous voyez un baluchon fait avec un drap, une femme le berce et c’est un enfant. Et bientôt elle lui parle et elle lui apprend à lire.
Passent des soldats, ils défont le baluchon, étendent le drap, le déchirent. La femme hurle. Les soldats s’en vont.
La femme prend les morceaux de draps, reforme le baluchon, s’éloigne en le consolant. C’est une scène qui dure cinq minutes dans Grande Paix, la dernière pièce de la trilogie des Pièces de Guerre. Prenez cette scène comme si elle avait lieu dans le coin d’un tableau de Breughel l’ancien et agrandissez-la, agrandissez-la, agrandissez-la comme le photographe de Blow-up agrandit sa photo et maintenant vous avez sous les yeux une scène de trois quart d’heure dans Naître ou un soldat extrait d’une bataille de Paolo Uccello essaie avec l’aide des morts de redonner vie à un tas de chiffon. Essaie de comprendre ce qui sépare la vie de la mort…
En agrandissant on peut voir des détails comme on ne les avait jamais vus. Étonnant, non ? Peut-être aussi qu’on peut dire de Bond que c’est d’abord un Poète. Ses pièces sont toutes de longs poèmes. Et c’est vrai qu’il écrit aussi beaucoup de poèmes dont certains sont très courts. Malheureusement, ils ne sont pas traduits ou très peu. Tenez, en voilà un.
Oranges
Quand je serai mort depuis cent ans
Un jour une femme dans une rue animée
Passant par là pour rentrer chez elle
Trébuchera sur un pavé inégal
Vacillera – ne tombera pas – suspendra son pas
Et laissera tomber son cabas
Paquets, éclats, débris, s'étaleront à ses pieds
Mais les oranges se disperseront dans la rue
J'aimerais être là pour les ramasser
Courir après celle qui roule plus loin – une couleur qu'on ne peut pas manquer – au
milieu de la circulation
Et les lui rapporter
Et les mettre dans son cabas
Mieux vaudrait ramasser les oranges de cette femme dans la rue
Mais peut-être les pièces que j'écris pourraient être utiles encore
Quand je serai mort.
Peut-être peut-on dire encore, ajouter, que par rapport aux autres pièces du Cycle de Paris, Les Gens est une pièce plutôt méditative. Mais alors il n’y aura même pas d’action ? !…
Eh non, non, pas d’action. Pas cette fois. Rien. Rien que des histoires qu’on raconte, comme des contes qui s’entretissent, très belles… des motifs dans un tapis persan, on pourrait penser au Motif dans le tapis d’Henry James.
Qu’est-ce qu’on pourrait dire d’autre ? Je ne sais pas, venez voir.
Michel Vittoz
Les Gens – Bande-annonce
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - TGP - CDN de Saint-Denis
TGP - CDN de Saint-Denis
59, boulevard Jules Guesde 93207 Saint-Denis
- Métro : Basilique de Saint-Denis à 666 m
- RER : Saint-Denis à 534 m
- Tram : Théâtre Gérard Philipe à 89 m, Saint-Denis - Gare à 387 m, Marché de Saint-Denis à 395 m
- Bus : Église - Théâtre Gérard Philipe à 265 m, Marché de Saint-Denis à 361 m
- Transilien : Saint-Denis à 534 m
-
Voiture : Depuis Paris : Porte de la Chapelle - Autoroute A1 - sortie n°2 Saint-Denis centre (Stade de France), suivre « Saint-Denis centre ». Contourner la Porte de Paris en prenant la file de gauche. Continuer tout droit puis suivre le fléchage « Théâtre Gérard Philipe » (emprunter le bd Marcel Sembat puis le bd Jules Guesde).
Plan d’accès - TGP - CDN de Saint-Denis
59, boulevard Jules Guesde 93207 Saint-Denis