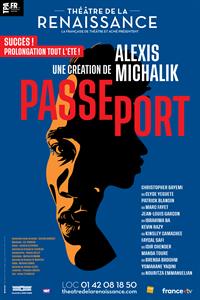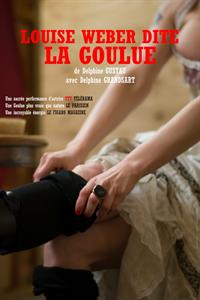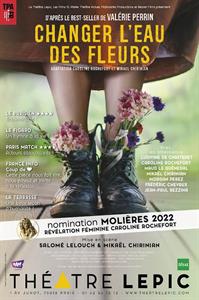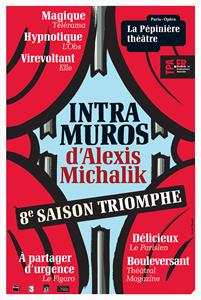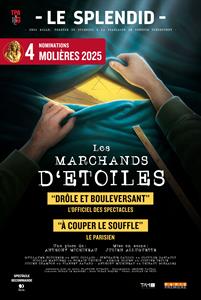Nouvelle Byzance
Nouvelle Byzance
- De : Mladen Materic
- Mise en scène : Mladen Materic
- Avec : Jelena Covic, Thierry Dussout, Emmanuelle Hiron, Sandrine Nogueira, Haris Resic
- Une nouvelle géographie du réel
Un homme traverse le plateau, une lune perchée sur son épaule ; une femme se promène avec un couteau planté dans le dos ; ailleurs, un arbre a poussé sur le bras d’une femme… Mladen Materic propulse ses personnages oniriques dans un espace qui évolue au gré de leurs relations de séduction, répulsion, domination ou soumission… Sous le ciel percé de cristaux reflétant les lumières lointaines, Nouvelle Byzance sculpte dans le rêve une nouvelle géographie du réel.
« Ce qui me pousse vers un sujet, c’est l’inconnu : ne pas savoir a priori comment l’aborder et le traiter, qu’en faire, voilà ce qui me fait avancer. J’ai toujours pensé que le plateau était un endroit pour poser des questions plus que pour y répondre. Si j’ai déjà la réponse, je crois que ça ne vaut pas la peine de faire le spectacle. Sujet, verbe, complément : cette structure grammaticale de base que nous apprenons devient aussi la structure de notre pensée et même de notre perception. Utile sans doute, elle nous trompe souvent. Existe-t-il d’autres possibilités de pensée ? Intuition ? Rêve ? Pensée émotionnelle ? Les éléments non réalistes ont pour objectif de déplacer les actions du champ dit « connu». Pour mettre en relation une femme avec un triangle doré et un homme avec un bandeau noir sur les yeux, cela demande aussi bien aux acteurs qu’aux spectateurs d’appliquer une autre manière de perception et de pensée.
D’après les expériences de travail menées jusqu’à aujourd’hui, on a raison de croire qu’un déplacement de cette sorte nous amène au plus près de la vérité des rapports, et notamment des rapports humains. »
Mladen Materic
Par la Compagnie Théâtre Tattoo.
- Entretien avec Mladen Materic
- Quelle est la question que pose Nouvelle
Byzance ?
Mes spectacles précédents étaient sans
paroles. Il y avait donc une attention particulière portée à l’espace, aux acteurs, à
leurs relations, aux situations qu’ils
recréaient sur le plateau. Mais ces situations étaient encore reconnaissables, c’étaient
des tableaux de la vie quotidienne : un
couple, ou des parents et leurs enfants par
exemple. Les personnages étaient identifiables,
ils étaient visiblement le produit de
certaines conceptions culturelles.
Avec Nouvelle Byzance, j’ai eu envie d’aller
au-delà de ces tableaux, au-delà des jugements
préconçus qu’on ne peut éviter de
projeter sur des situations reconnaissables.
J’avais déjà ôté les mots du théâtre pour
voir ce qui restait. Là je me suis dit : que se
passe-t-il si j’enlève aussi le reste ?
- Et que reste-t-il ?
Prends une peinture de Malevitch, compare-la à une peinture figurative. Que reste-t-il
chez Malevitch ? Ce qui reste, c’est la
peinture. On peut dire que Malevitch a
enlevé toute figuration, mais la peinture est
restée la peinture. On la reçoit, on l’aime ou
pas, on l’accepte ou pas, exactement de la
même façon que la peinture figurative.
Donc on accepte l’idée que la substance de
la peinture n’est pas dans la figuration, et
qu’elle a sa propre substance. Que reste-t-il,
je me pose la même question avec le
théâtre, et Nouvelle Byzance est une façon
de poser cette question.
- Comment se débarrasse-t-on de la figuration
au théâtre ?
D’abord on ne peut pas tout à fait, sauf à
produire un théâtre d’objets débarrassé des
acteurs, ce qui n’est pas mon propos. Mais il
y a d’autres moyens, qui sont les moyens de
base du théâtre : en l’occurrence, cela
passe par un espace indéfini qui ne prétend
pas être autre chose qu’un plateau de
théâtre, et par des personnages sans définition
psychologique.
Nous sommes donc dépourvus des signes
de reconnaissance habituels. Il me semble
que ce dénuement peut nous mener au plus près de la réalité d’une situation.
Conflit, amour, haine : comment se tissent
les relations entre les êtres ? Nouvelle
Byzance attaque ces questions d’une manière
directe, sans aucun prétexte réaliste, aucune
introduction formelle.
- En quoi Nouvelle Byzance poursuit-il la
ligne engagée avec tes précédents spectacles ?
Depuis des années, les spectateurs disent
que notre jeu est hyperréaliste mais avec « quelque chose en plus ». Parfois ils parlent
d’un jeu « comme au cinéma, mais au
ralenti, ou avec un effet bizarre». Je crois
que ça vient du fait qu’à chaque spectacle
nouveau, nous commençons les répétitions
par une étape préparatoire dans laquelle
sont travaillés les forces, les rythmes, les
conflits, comme dans le théâtre dramatique
mais avec des moyens abstraits. De ces
exercices naît une conscience particulière
de l’espace, des acteurs, et surtout des
gestes. Nous travaillons alors avec un
répertoire de gestes réalistes, qui sont
banals dans la vie mais deviennent sur le
plateau nos moyens de jeu, nos seuls
moyens, comme un peintre joue avec les
lignes et les couleurs. Cette phase préparatoire
est devenue la base de Nouvelle
Byzance. C’est pour cela que j’ai choisi des
acteurs avec lesquels j’ai déjà travaillé.
- A la base de ce spectacle, il y a aussi l’intuition
d’un théâtre de sensations, d’émotions,
où la raison ne dirige pas l’action ou
la narration…
Je crois que dans notre pensée occidentale,
très rationaliste, il y a un grand danger de
simplification. On ne peut envisager la réalité sous le seul angle de la raison. Si c’était
aussi simple, il me semble que nous serions
bien meilleurs dans l’anticipation et la prévision. Au niveau social, politique autant
que personnel, les prévisions se révèlent
souvent fausses, même à court terme. Je
pense que ce vocabulaire logique, toutes
nos évaluations rationnelles, toute notre
morale, nos jugements, tout cela déforme
notre perception de la réalité. Nous avons
tendance à séparer les choses : une part
rationnelle, une émotionnelle, une corporelle.
Il faudrait donc couper un personnage en
trois ? Et en trois quoi ? En réalité ces trois
dimensions sont inséparables. Nos réactions
sont conditionnées par un mélange de ces
trois parts, jamais par une seule. La raison
intervient dans nos décisions, et pourtant
nous nous surprenons parfois à prendre des
décisions qui vont à l’encontre de la raison.
- Comment le travail de plateau peut éclairer
ces mécanismes non rationnels ?
Quels sont les moments de théâtre préférés
par les acteurs, et même par les spectateurs ?
Justement ces moments irrationnels, quand
on glisse vers l’abstraction, vers un au-delà
du réel. Même au niveau du jeu d’acteur,
les meilleures écoles enseignent que les
moments les plus précieux sont marqués
par l’introduction de forces subconscientes,
qui échappent à la seule raison. C’est pourquoi
dans Nouvelle Byzance on s’affranchit
de la figuration, de cette introduction dite
réaliste des situations : on entre tout de suite
dans le non-dit, où les réponses ne peuvent
plus être simplement logiques mais
nuancées par de pures sensations, à ce
niveau qui nous engage ensemble, de tout
notre être, et pas seulement au niveau analytique.
C’est une petite tentative nourrie de
notre expérience théâtrale précédente,
comme une méthode pour voir mieux en
prenant un peu de recul.
- « Voir mieux » : le recours à l’irrationnel
modifie la perception du spectacle ?
Je pense que cette approche permet un
plus large registre d’associations, parce que
les émotions se partagent plus facilement
que les idées. Je n’ai jamais essayé de trop
suggérer ma propre vision, ni trop insisté sur
ce que je voulais que le public voit. De toute
façon, je pense qu’au théâtre l’enjeu n’est
pas du tout là. Le plateau doit reconstruire
une réalité propre au spectacle, et de toute
façon, quand un metteur en scène veut
imposer sa vision, même si elle est très
lisible, ça ne marche pas vraiment. Le spectateur
ne voit que ce qu’il voit, chacun
selon sa culture, son expérience, et au final ce qui est perçu est toujours plus riche que ce que l'on montre.
- Remettre en jeu l’intuition, les émotions,
l’irrationnel : voilà qui dépasse le seul cadre
du théâtre…
Ça va à l’encontre de ce sur quoi toute notre
société est fondée. Pourtant on tombe
amoureux sans savoir pourquoi. On ne
comprend pas pourquoi on aime un millefeuille.
On n’a pas besoin de comprendre
un paysage pour l’aimer. Pareil pour un
tableau de Vermeer. Toute cette partie de
notre vie se fait sans le recours à la raison.
Et je pense que si l’on retarde le moment où
intervient la raison, ce moment où l’on juge,
où l’on évalue, où l’on définit l’identité, où
l’on exclut, ça peut ouvrir une Nouvelle
Byzance de sensations.
Propos recueillis par Stéphane Boitel.
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Théâtre de la Bastille
Théâtre de la Bastille
76, rue de la Roquette 75011 Paris
- Métro : Bréguet-Sabin à 377 m (5), Voltaire à 391 m (9)
- Bus : Commandant Lamy à 1 m, Basfroi à 237 m, Charonne - Keller à 244 m, Voltaire - Léon Blum à 383 m
Plan d’accès - Théâtre de la Bastille
76, rue de la Roquette 75011 Paris