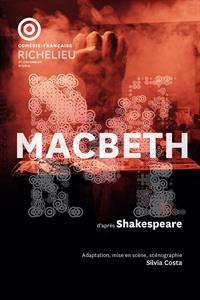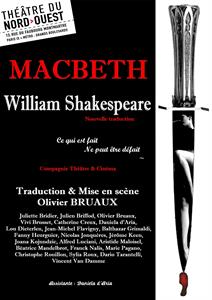Bérénice
Bérénice
- De : Jean Racine
- Mise en scène : Jacques Osinski
- Avec : Maud Le Grévellec, Stanislas Stanic, Clément Clavel, Alice Le Strat, Arnaud Simon
Bérénice - Photographie
Dès 16 ans.
- Une lignée souterraine d’héroïnes féminines éprises d’absolu
Bérénice aime Titus. Titus aime Bérénice. Voilà cinq ans que le fils du défunt Vespasien aime la reine de Palestine qui a tout quitté pour le suivre à Rome.
Il vient de monter sur le trône et s’apprête à l’épouser. Mais le Sénat réprouve cette union avec une reine étrangère. Titus épousera-t-il Bérénice ? La loi de Rome finira par l’emporter. Titus ne se dérobera pas au « fardeau » du pouvoir et assumera son destin. Avec une tristesse infinie, il renverra la « tendre et sublime » Bérénice, « malgré lui, malgré elle ».
Une tragédie sans coups de théâtre, sans morts, qui a séduit Jacques Osinski. Bérénice s’inscrit « dans une lignée souterraine d’héroïnes féminines éprises d’absolu », comme le souligne le metteur en scène d’opéra et de théâtre. L’étrangère sans royaume, soumise à son amant, ose affirmer « ce qu’elle est ». Et c’est « cet amour mis à nu dans tout ce qu’il a de beau mais aussi de violent » que souligne la scénographie par un espace ouvert où les sentiments « ont l’obligation de se dire ».
- Note d'intention
Affronter Racine... Enfin. Ou plutôt qu’affronter, retrouver Racine. Plutôt que voir en lui, une muraille infranchissable, un Everest à escalader, le prendre comme un support, un soutien, des mots qui portent le monde. Bérénice est là depuis 1670. Elle sera encore là après nous. Bérénice est éternelle. Le texte semble être là depuis toujours, tellement là, tellement puissant qu’on a oublié de le regarder. Alors le regarder à nouveau et se laisser prendre par la main, le laisser nous emmener là où il le veut. Regarder Bérénice comme pour la première fois, avec cette distance que confèrent les ans dont parle si bien Proust dans ses Journées de lecture : regarder Bérénice comme on se promène dans une ville restée miraculeusement intacte, éloignée des transformations, épargnée par le poids des années, une ville qui, s’offrant alors à nous, nous aidera à retrouver notre humanité.
Venir à Bérénice a finalement quelque chose de logique dans mon chemin. Peut-on faire du théâtre sans, un jour ou l’autre, rencontrer Racine ? Non. Evidemment. Mais il faut du temps pour arriver à lui. Ce retour ou plutôt cette venue à Racine rejoint deux pans de mon parcours. Bérénice est reine, étrangère et abandonnée comme Médée, comme Didon. Après Medealand de Sara Stridsberg relecture contemporaine du mythe de Médée (et dont le rôle principal était déjà tenu par Maud Le Grévellec, actrice d’une force incroyable), oser enfin la classique Bérénice avec le besoin d’une langue absolue, inattaquable comme un retour aux sources (et peut-être le passage par L’Avare (1668) pièce quasiment contemporaine de celle de Racine (1670) n’est-il pas non plus étranger à ce choix). Et puis Bérénice s’inscrit aussi dans la lignée de mes mises en scène d’opéra les plus personnelles, les plus intimistes : Didon et Enée qui fut la première, au Festival d’Aix-en-Provence, et Iphigénie en Tauride, pour l’atelier lyrique de l’Opéra National de Paris, l’une des plus récentes. Dans mon travail, Bérénice prend ainsi sa place aux côtés de toute une lignée souterraine d’héroïnes féminines éprises d’absolu. Elle arrive comme une évidence : il est temps.
Et puis, il y a cette assurance de Racine, cet aplomb qui le mène à faire « quelque chose de rien » comme il le souligne dans sa préface. « Il y avait longtemps que je voulais essayer si je pourrais faire une tragédie avec cette simplicité d’action qui a été si fort du goût des Anciens » écrit-il. Racine, au contraire de Corneille, ose faire une tragédie toute intérieure, sans coups de théâtre, sans événement extérieur autre que la mort de Vespasien qui a déjà eu lieu lorsque la pièce commence. Elle avance en suivant le rythme intérieur des personnages. Bérénice aime Titus. Titus aime Bérénice. Entre les deux, il y a Antiochus, qui aime Bérénice depuis toujours, sans pouvoir le dire. Et ce silence d’Antiochus est peut-être le moteur de la pièce : Quand parler ? Peut-il parler ? A quoi bon parler ? La tragédie avance en ligne droite vers l’abandon de Bérénice par Titus. Et sans doute est-ce là, si on veut vraiment l’y chercher, sa grande « modernité ». Il y a dans Bérénice quelque chose du « stream of consciousness » du XXe siècle, quelque chose qui évoque les monologues intérieurs mouvants de Joyce ou de Woolf. La grande force de Racine est d’avancer toujours avec ce « rien » qui s’appelle l’amour. Loin de faire du surplace, cette simplicité d’action donne un vrai suspens. Nous sommes suspendus aux tourments de Bérénice. Elle porte en elle une chose qui fait peur aux hommes (et sans doute qui fait peur à Titus) : l’absolu du désir féminin. Proust, qui rêva Albertine prisonnière, la cite comme son héroïne préférée dans son fameux questionnaire… Sans doute n’est-ce pas pour rien. Bérénice est reine et elle aime. Elle assume un amour qui fait d’elle, lorsqu’elle suit Titus à Rome, une étrangère sans royaume. Recluse, soumise à celui qu’elle aime, ne semblant faire rien d’autre qu’attendre que son amant prenne le temps de venir la voir, elle semble la réalisation d’un fantasme masculin. Mais en affirmant son amour, elle affirme aussi totalement ce qu’elle est et l’exigence de son désir. Elle est un paradoxe : totalement soumise à Titus qu’elle a suivi par amour et pour lequel elle semble avoir tout abandonné, elle le surpasse par la force de son amour. Bérénice, l’héroïne recluse, est passionnante de liberté.
Bérénice, c’est l’amour mis à nu dans tout ce qu’il a de beau mais aussi de violent et de cruel, l’amour mis à nu et retenu dans une cage de mots. Pour cette mise en scène, j’ai envie d’un espace ouvert, sans recoin, sans refuge, un espace où les sentiments ont obligation de se dire, de se mettre à nu. Au rebours de Bérénice qui met de côté son statut de Reine, qui n’aime en Titus « que lui-même », Titus en devenant Roi se défait de l’amour. Il ne me semble pas intéressant de douter de l’amour de Titus comme ce fut souvent le cas (« il me paraît que Titus ne l’aime pas tant qu’il dit, puisqu’il ne fait aucun effort en sa faveur à l’égard du sénat et du peuple romain » écrivait déjà Bussy Rabutin bien avant Barthes). Bérénice ne peut être seule à pleurer. Titus doit être conscient de ce qu’il quitte. Ne voir en lui qu’un amant déjà lassé, c’est faire peu de cas du poids du costume d’empereur. Tout est dit dans la scène 2 de l’acte II. Le noeud est dans la mort du père : « Mais à peine le ciel eut rappelé mon père, /Dès que ma triste main eut fermé sa paupière, /De mon aimable erreur je fus désabusé /Je sentis le fardeau qui m’était imposé ;/ Je connus que bientôt, loin d’être à ce que j’aime, Il fallait cher Paulin, renoncer à moi-même ». Etre roi, c’est renoncer à être soi. Loin de le nier, Titus reconnait tout ce qu’il doit à Bérénice. Il est pour elle un bien meilleur avocat qu’elle-même (« je connais Bérénice et ne sait que trop bien/Que son coeur n’a jamais demandé que le mien… ») mais il est déjà ailleurs, à la place du père. Titus me fait songer au Henry IV de Shakespeare se transformant au moment de son accession au trône.
C’est le passage de l’adolescence à l’âge adulte. A la mort de son père, Titus quitte l’âge des possibles pour l’âge des responsabilités. C’est ce poids qui tombe sur lui qui m’intéresse. Si Titus épousait Bérénice, il ne serait plus un roi mais un révolutionnaire… Ce serait alors une autre histoire, une fin que Rousseau d’ailleurs se plaira à imaginer plus tard : Titus quittant sa charge pour vivre loin de tous avec Bérénice : une fin impossible, d’un autre temps... L’amour de Titus et Bérénice est enfermé dans un temps révolu : ce moment, si régulièrement évoqué dans la pièce, de la rencontre en Orient. Ayant suivi Titus, ayant tout abandonné pour lui, Bérénice est restée dans ce temps passé. Depuis elle est dans l’attente « Etrangère dans Rome, inconnue à la cour,/ Elle passe ses jours, Paulin, sans rien prétendre/ Que quelque heure à me voir, et le reste à m’attendre » (acte II, scène3). Pour Bérénice, cette attente doit déboucher sur un avenir. Mais pour Titus les choses sont différentes. Son amour est une bulle (« Depuis cinq ans entiers chaque jour je la vois/ Et crois toujours la voir pour la première fois »), une bulle qui éclate avec la mort de son père.
Les personnages évoluent dans trois temporalités différentes, sur trois lignes droites. Unis par un passé mythique, Titus et Bérénice avancent sur deux parallèles (et l’on sait qu’en mathématiques, les parallèles finissent par se rejoindre à l’infini..). Entre eux se tient Antiochus, personnage souvent négligé et pourtant passionnant, le seul mobile, sur une droite perpendiculaire. Il est sur un autre plan, dans une temporalité mouvante faite uniquement d’instants (« Tous mes moments ne sont qu’un éternel passage/ De la crainte à l’espoir, de l’espoir à la rage », V, 5). Témoin du passé et porteur de l’avenir, messager et amant, amoureux prisonnier du silence, personnage silencieux qui ne peut se résoudre à l’être, Antiochus déborde du cadre qui lui est attribué. Témoin et acteur de la tragédie, il la referme sur un « hélas » plus triste encore que tout le sang versé dans d’autres tragédies.
Les trois protagonistes sont traversés par la tentation du suicide et cette vie qui continue malgré tout, malgré eux, est plus implacable que la mort car elle sonne comme l’adieu à l’amour, l’adieu à l’absolu. En mourant, Titus et Bérénice comme Antiochus auraient conservé l’idée de l’amour. En vivant, ils renoncent à celui-ci. Titus se fait absorber par son rôle d’empereur, Antiochus s’efface et l’idée exprimée par Mauriac dans un beau texte m’intrigue : l’idée d’une Bérénice future Agrippine. Ne pouvant plus aimer, Bérénice « règnera » dit Mauriac. La perte de l’amour est comme un adieu à l’enfance, une époque qui ne reviendra plus. Reste à vivre, à vivre et à régner en ayant perdu sa part d’humanité. Reste à vivre et à régner dans un monde où on ne peut épouser une « étrangère », reste à supporter ce monde-là. Bérénice, Titus et Antiochus ont perdu leur liberté. Ils se figent alors, signant la fin d’un monde.
Bérénice – Bandes-annonces
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Théâtre Romain Rolland
Théâtre Romain Rolland
18 rue Eugène Varlin 94800 Villejuif
- Métro : Villejuif Paul Vaillant-Couturier à 483 m
- Bus : Groupe Hospitalier Paul Brousse à 131 m, Guynemer - Place des Fusillés à 257 m
Plan d’accès - Théâtre Romain Rolland
18 rue Eugène Varlin 94800 Villejuif