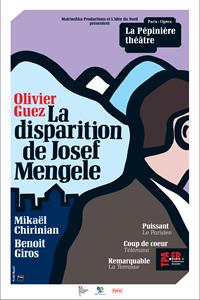La Nuit de l'lguane
La Nuit de l'lguane
- De : Tennessee Williams
- Mise en scène : Georges Lavaudant
- Avec : Dominique Reymond, Astrid Bas, Anne Benoît, Pierre Debauche, Bernard Eylenbosch, Sara Forestier, Ianis Guerrero, Anne-Lise Heimburger, Tcheky Karyo, Roch Leibovici, Emilien Marion, Giovanni Ortega, Ariane Pirie, Christophe Vandevelde
L’esquisse d’une libération
Entretien avec Georges Lavaudant
La presse
Tennessee Williams avait le génie des titres. Les siens sont souvent inoubliables : La Chatte sur un toit brûlant, Un Tramway nommé Désir, La Nuit de l’iguane suggèrent tout de suite une atmosphère trouble, violemment sensuelle. Pour le public d’aujourd’hui, ces titres sont d’abord ceux de films célèbres. Vingt-cinq ans après la mort de Williams, son théâtre mérite pourtant d’être apprécié pour lui-même.
Cela dit, que Georges Lavaudant puisse s’y intéresser sera sans doute une surprise pour beaucoup. Son amour de la littérature américaine n’explique pas tout. Il aborde Williams sans idée préconçue, pour rencontrer un auteur, au-delà des clichés d’époque (qui d’ailleurs n’en sont peut-être pas) sur le désir, la névrose, ou la solitude des êtres, qui font que l’on s’imagine connaître Williams sans jamais avoir pris la peine de le lire.
Lavaudant aime le Mexique. Il l’a sillonné en tous sens, de ses montagnes centrales jusqu’à ses côtes. Il a connu, sur son littoral Ouest, ses plages presque désertes prises dans un étau dont les mâchoires seraient la jungle et l’océan. La Nuit de l’iguane se situe non loin d’une de ces plages. L’hôtel où Shannon vient chercher refuge, le Costa Verde, est un havre fragile coincé entre les deux puissances massives, vivantes, inhumaines, de l’eau et de la forêt tropicale. L’unité de temps n’est pas moins concentrée : trois actes, trois groupes d’instants à quelques heures d’intervalle, d’une arrivée en fin d’après-midi jusqu’à un bain de minuit à la lueur de la lune. En ce lieu comme assiégé et qui baigne pourtant dans le suspens d’un calme étrange, à l’écart des remous du monde, un homme traqué ne sait pas encore qu’il a rendez-vous.
Shannon est à l’image de ce paysage. Lui aussi est comme une frontière très mince entre deux forces élémentaires qui se disputent son humanité. D’un côté, sa vocation spirituelle ne l’a jamais laissé en paix. De l’autre, l’appel des corps le hante encore et toujours. S’il est devenu voyageur, c’est peut-être pour fuir aux quatre coins du monde l’acuité de ce combat intime.
Mais Shannon, innocent coupable, rebelle résigné, séducteur suicidaire, touche au bout du voyage. Il est acculé, cerné par trop de miroirs : toutes ces femmes qui le fascinent, incarnations tentatrices de la jeunesse, de l’expérience, de l’utopie artistique, chacune belle à sa façon, et qui sont autant de visages possibles de la vie (Lavaudant confie que la pièce, par cet aspect, l’a fait penser à Platonov, mais Shannon est aussi un peu parent de Baal ou de Danton, autres héros de l’ivresse et de l’autodestruction sensuelle dont le metteur en scène a dressé de brillants portraits). Et c’est pourtant là, au Costa Verde, qu’une dernière rencontre va offrir à Shannon l’épuisé une chance d’échapper à l’impasse, ou de fuir autrement - c’est là, sur une terrasse de planches où quelques confidences nocturnes s’échangent comme dans l’oeil d’un cyclone, que s’amorce signe après signe l’esquisse d’une libération.
Daniel Loayza
Texte français Daniel Loayza
L’auteur est représenté dans les pays de langue française par l’agence MCR, Marie-Cécile Renauld, Paris en accord avec Casarotto Ramsay Ltd, London.
Ne me forcez pas à croire qu’un être humain adulte puisse faire passer son exigence de réparation avant la situation sinistre et sans phrases d’un homme au bout du rouleau qui doit pourtant s’efforcer d’aller de l’avant, de continuer, comme s’il n’avait jamais été meilleur ni plus fort de toute sa vie. Shannon - La Nuit de l’iguane - acte 1
Pourquoi Tennessee Williams ?
D’abord, pour aborder un nouvel auteur... Il y a quelques classiques qui m’intéressent, que je connais et que j’aime– les Grecs, Shakespeare, Pirandello, Tchekhov, je pourrais passer toute ma vie avec eux. Alors, si je ne veux pas en rester là, il faut bien faire des pas de côté ! C’est ce que j’avais fait avec Feydeau ou Labiche, par exemple. S’il y a défi, il consiste à me remettre en question en engageant la bataille d’un théâtre inconnu pour moi, d’un théâtre dont je n’ai pas les clefs. Je n’ai jamais monté ce genre d’auteur. J’aurais pu monter du répertoire anglais contemporain, des textes qui s’inscrivent dans la lignée de Tennessee Williams... mais il se trouve que non, jamais. Il s’agit vraiment d’entrer dans des territoires où je n’aurais pas cru que j’irais un jour.
Quelle sorte de territoire ?
Avec Tennessee Williams, disons que ce serait un théâtre psychologique, c’est-à-dire une dramaturgie où dans un premier temps, du moins en apparence, la langue a moins d’importance que ce qui se joue entre les personnages – même si, bien entendu, elle en a beaucoup.
La pièce a été créée en 1962, quelques années avant que tu commences à faire du théâtre...
Oui. Le début des années soixante fait partie pour moi de cette tache aveugle qu’on a tous plus ou moins dans notre biographie, aux alentours de notre naissance et de notre jeunesse. C’est une zone historique que l’on commence par repousser ou par ignorer, quitte à y revenir plus tard. Vers 1968, Tennessee Williams ne faisait pas partie des auteurs par lesquels nous étions attirés. Il faut traverser plusieurs écritures, plusieurs époques, pour que les choses se décantent, et qu’on en arrive à se dire qu’il y a là, dans cette zone, une écriture à comprendre, une machine dramatique à démonter pour voir comment elle marche. Il faut aussi dire que le succès de ce théâtre au cinéma a été à double tranchant. C’est d’ailleurs cet aspect-là que la plupart des gens retiennent d’abord : toute la galerie de grands acteurs américains qui ont créé ces rôles typiquement « Actors’ Studio », avec névrose, alcool, folie, traumatismes en tout genre et psychanalyse, tous ces personnages tendus vers la destruction... Ce que je voudrais tenter, c’est de reprendre les choses à partir de l’écriture, non pas pour effacer l’image cinéma, mais pour qu’on puisse s’en démarquer. Les solutions de ce cinéma, ce n’est pas la peine de les reprendre, pour deux raisons : parce qu’elles sont belles comme elles sont, et parce qu’elles sont datées aussi. Je crois que ce n’est pas la peine de surhéroïser les personnages – c’est plutôt dans le retrait, du côté de quelque chose de plus incertain, que je voudrais aller chercher.
Finalement, en ce qui te concerne, l’influence de cette génération d’auteurs dramatiques sera d’abord passée par le cinéma...
Oui.
Alors pourquoi, maintenant, ce retour d’intérêt pour l’aspect proprement théâtral ?
Pour continuer la mise à l’épreuve de la nouveauté, de l’inconnu... Quand on a monté cinquante ou cent pièces, on pourrait faire toujours la même chose. Je l’ai dit, les Grecs, Shakespeare, ça me suffirait... mais justement, je ne peux pas travailler comme ça.
Et pourquoi cette pièce ?
Tennessee Williams recommence à être lu. Il y a quelques années, à l’Odéon, j’avais pensé à programmer Zadek qui voulait monter Un Tramway nommé désir. Pour ce qui est de l’Iguane, il y a évidemment la référence mexicaine, qui compte beaucoup pour moi et qui ne pouvait que m’attirer. Mais je veux éviter la couleur locale. Williams a situé sa pièce avec beaucoup de soin, dans l’espace et dans le temps. Géographiquement, comme il le dit, le Mexique se tient entre deux mondes, les deux Amériques du Nord et du Sud. Et historiquement, on est en pleine Bataille d’Angleterre, un des points cruciaux de la deuxième Guerre Mondiale. Tout cela est très précis, et pourtant, il me semble qu’il faut « désanecdotiser », déshistoriciser, pour le dire comme ça... ne serait ce que pour éviter le kitsch, le convenu. Cette écriture-là est quand même d’abord destinée aux acteurs, il ne faut pas réduire cette langue à une trame squelettique : elle est faite pour être portée par des comédiens, par des voix.
Est-ce que ce rapport à l’incarnation par l’acteur n’explique pas une bonne partie du succès de Tennessee Williams ?
Bien sûr. Cette écriture a rencontré toute une génération d’interprètes qui voulaient sortir du beau langage, pour mettre en jeu autre chose, de l’ordre du désir, de la sexualité, en engageant leurs corps sur d’autres codes. Et cette génération a été reconnue parce qu’elle répondait à une attente.
Comment faire pour renouveler notre regard sur ce théâtre ?
Dans ce réalisme-là, il y a curieusement un côté presque symboliste, et j’ai l’impression qu’on peut redonner de la tension en partant de là : le Mexique entre Nord et Sud, l’hôtel entre la jungle et l’Océan, les oppositions entre corps, ceux des Mexicains et ceux des Allemands, par exemple...
Dans l’adaptation cinématographique de John Huston, les nazis n’apparaissent pas puisque le film transpose toute l’action dans les années soixante, de façon à la rendre contemporaine...
L’option est très claire. Elle permet d’éviter les questions historiques et de se concentrer sur la psychologie. Mais je voudrais essayer de dégager une valeur plus classique de l’écriture. Williams n’a pas voulu composer une chronique contemporaine, il a essayé de réinventer une époque à vingt ans de distance... Ces nazis, je les vois comme le contrepoint des amants mexicains de Maxine. D’un côté, un monde pauvre, silencieux, primitif et sensuel ; de l’autre, un monde ultramécanisé – le père de famille allemand est un marchand d’armes... J’ai l’impression que l’enjeu ne porte pas sur le nazisme lui-même – la pièce n’a pas cette ambition – mais sur une certaine attitude. Ces Allemands sont évidemment des caricatures, et en particulier des caricatures de touristes indifférents et égoïstes... Des gens à qui les Américains n’ont pas encore déclaré la guerre – c’est un détail important : ce sont donc des gens avec qui il faut bien cohabiter, même si l’on n’en pense pas moins, comme Shannon... Et là, on retrouve une des grandes questions de la pièce : celle du rapport que l’on entretient forcément avec les formes de mal qui nous côtoient sans cesse dans le monde. Pour toutes ces raisons, il me semble que l’écart entre les Mexicains et les Allemands est intéressant, et qu’il ne faut pas l’annuler d’emblée. C’est la même chose avec les différentes femmes...
Justement, comment comprends-tu leurs rôles ?
Est-ce qu’elles sont deux, trois, quatre à compter dans le destin de Shannon ? Il y a une opposition majeure qui passe entre Hannah et Maxine. Dans le processus de parole, c’est Hannah qui fait avancer l’histoire. Elle assume le traumatisme, la douleur, la chute et la rédemption... Comme si les autres étaient d’abord des figures physiques, charnelles. Mais Maxine ne peut pas être écartée trop vite... L’une est plus sur le plan « fantastique », l’autre plutôt sur le plan « réaliste », pour reprendre les termes de Shannon. Mais l’opposition n’est pas sans nuances : Hannah est ironiquement assimilée par Shannon à un Bouddha, mais Maxine, vers la fin, est elle aussi comparée à une sorte de divinité... Et puis elles ont un point commun qui les oppose à Charlotte : l’âge... Sans parler de l’aspect religieux. Shannon est un ancien pasteur, ou plutôt, à ses yeux, il n’a jamais cessé de l’être... Cela fait des années qu’il a dû renoncer à assumer activement sa charge, et pourtant, il n’a jamais accepté de regarder la situation en face. Il s’imagine sérieusement revenir à l’Eglise. Mais il y a une quatrième femme, la terrible Mademoiselle Fellowes, qui lui renvoie ces illusions-là à la figure... Chacune de ces femmes porte une part de sa vérité.
Peux-tu dire deux mots de la distribution ?...
Elle est étonnante, et c’est ce que j’aime. Pour moi qui ai si longtemps travaillé avec une troupe, ce sont presque tous des inconnus, un groupe un peu sauvage. Il y a des gens qui viennent du cinéma, comme Tchéky, ou des gens très ancrés dans le théâtre, comme Dominique Reymond. Il y a des jeunes gens, d’autres qui savent chanter, ou qui viennent de l’étranger... C’est très ouvert. Je crois que la pièce mérite cette espèce de courant d’air. Ca donne à l’entreprise un côté un peu aventureux. Et humoristique aussi. On sent bien qu’il y a une dérision possible. On n’est pas chez Ibsen ! Cette dimension d’autodérision, Houston l’avait bien sentie. Shannon se voit volontiers comme personnage christique, mais comme le dit Hannah, on a vu des façons plus douloureuses de souffrir pour les péchés du monde ! D’ailleurs, Hannah aussi, avec ses petites aventures « amoureuses », n’est pas tout à fait à l’abri du dérisoire...
Hannah dénonce en effet en Shannon un certain histrionisme épuisé... De Richard III à Platonov en passant par Lorenzaccio, Danton ou Baal, n’est-ce pas une figure masculine qui revient souvent dans ton théâtre ?
En tout cas, la parenté avec Platonov est évidente, et j’y ai pensé tout de suite. Cet homme autour duquel tournent toutes ces femmes qui veulent le sauver et qui toutes se mettent à le détester... La situation de départ est un peu la même : tout ce que l’homme voudrait, c’est que ces femmes le laissent tranquille...
Comment interprètes-tu la fin de la pièce ?
D’un côté, il y a peut-être un certain retour de la morale conventionnelle – on retombe sur un compromis minimal entre les deux héros qui étaient destinés à se retrouver ensemble depuis le début, et tout rentre dans l’ordre prévu – même si la fin peut rester en porte-à-faux ou en suspens. Après tout, on ne sait pas si le lendemain, tout va sauter à nouveau. La réconciliation s’opère par épuisement de l’un des combattants, plus que par vraie résolution... On tire le rideau provisoirement... Ou alors, ce qui devait n’être qu’un abri provisoire devient un point de chute à plus long terme, une solution envisageable. Le retour aux USA est de toute façon impossible pour Shannon, alors autant transformer le précaire en pérenne. Mais d’un autre côté, est-ce que ce n’est qu’une simple question de résignation à la médiocrité, et même, est-ce que ce compromis est si médiocre, après tout ? On pourrait dire que le fantasme de prêtrise que nourrissait Shannon n’était plus qu’un mensonge depuis longtemps, et qu’en acceptant la proposition de Maxine, il fait peut-être plus que de simplement succomber à une tentation charnelle très confortable : il se pourrait qu’il accepte enfin une certaine vérité... Et en même temps, tout cela retombe tellement du côté du manche... Donc il reste un suspens, la fin reste ouverte.
Cette fin intervient après la scène la plus longue et la plus fouillée, le dialogue nocturne entre Hannah et Shannon qui constitue le sommet de la pièce. Après coup, la résolution proprement dite paraît à peine marquée...
C’est comme s’il y avait plusieurs fins qui s’empilent, ou plusieurs niveaux de fin. La conversation se conclut entre eux, il n’y aurait plus qu’à prendre congé, mais Hannah revient sur le destin de l’iguane, et c’est là que Shannon accepte de « jouer à être Dieu » et à délivrer l’animal... Pendant qu’il le détache, le vieux Nonno récite son poème, puis il meurt, lui aussi délivré... L’iguane qui retrouve sa liberté, c’est aussi Shannon, évidemment, que Hannah aide à se défaire de ce qui l’étrangle – lui aussi d’ailleurs porte un lien autour du cou. Mais tout se résout très vite, comme dans une sorte de sérénité inconsciente. Est-ce qu’il agit dans le détachement ou dans la contrainte, est-ce qu’il a vraiment le choix ? Peut-être que tout se confond un peu, sans parler de la tentation que représente Maxine, cette attirance de la chair qui le met en joie et en fureur...
A propos de choix, il semble quand même envisager l’option du suicide...
Je ne suis pas sûr qu’il l’assumerait. On a plutôt le sentiment d’une force vitale, animale...
Un peu comme chez Baal ? Le héros a une énergie énorme, mais quand il est épuisé, son épuisement est énorme aussi ?
Exactement.
Et le vieux Nonno, qu’en dis-tu ?
Lui aussi est un histrion. C’est un poète superficiel, un phénomène de foire. A première vue, ce n’est pas la souffrance de l’écriture qu’il incarne, mais plutôt un versant dérisoire, pique-assiette et exhibitionniste de la performance poétique. Pourtant, il est aussi sincère. Sa vie, malgré tout, il l’a à sa façon entièrement vouée à l’écriture. C’est un personnage d’un autre siècle, un anachronisme ambulant, un fantôme de gentleman à l’ancienne perdu dans une époque de rhums-coco, de musique, d’agitation et de touristes nazis... Un vieux monsieur la tête dans les nuages, qui ne saisit rien du business local ou mondial qui se trame autour de lui... Bon, cela dit, ce n’est quand même pas une figure de Dostoïevski !
Donc, c’est un mélange d’histrionisme et de sérieux ? On peut rappeler aussi que dans sa cécité et sa surdité, ce personnage, depuis vingt ans, mûrit un seul poème...
Oui, son poème est une sorte d’autoportrait. L’oranger dont le fruit tombe et pourrit au sol avant de pourrir lui-même, c’est bien entendu une figure du poète. Le poème serait le fruit du poète, et une fois que ce fruit est mûr, la mort peut venir, très douce, comme la chute d’une feuille...
Dans ce poème, le fruit sublime de l’oranger, le fruit d’or, en tombant au sol, est livré à une sorte d’union sexuelle avec la terre... Le pourrissement est porteur d’une charge érotique...
Oui, on a le sentiment qu’il y a une sorte d’image en réduction, un emboîtage d’une des figures principales de la pièce. Le thème de la pureté et de la chute, ou du pourrissement comme phénomène vital malgré tout, est comme démultiplié. On le constate un peu partout. Le monde de La Nuit de l’iguane est un monde qui pullule, qui grouille. Un monde de prédation. ça se mange de partout. L’iguane attend d’être dévoré. Le rapport sexuel aussi est fantasmé comme une sorte de dévoration, et Shannon se voit comme une proie, capturé, ligoté, réduit à l’impuissance par les femmes... L’air et l’eau sont pleins de microbes, la jungle est pleine de bêtes et d’insectes, l’océan est plein de poissons que Fred pêche, et qui dévorent Fred après sa mort... D’ailleurs, il succombe à une septicémie en moins d’une semaine... Shannon est fiévreux, les touristes contractent des amibiases, il faut tamponner la moindre égratignure à la teinture d’iode... Shannon est très sensible à cela, il a vu des gens survivre en se nourrissant des déjections des autres sur les tas d’ordures. Il y a une sorte de recyclage impur, répugnant, qui est une loi vitale, une loi de la vie bouillonnante, infecte et foisonnante à la fois. On retrouve cette dualité à un moment ou à un autre chez tous les personnages principaux. Notamment au niveau économique, par exemple. Il faut bien manger, alors Maxine accueille des nazis, Hannah essaie de leur vendre ses oeuvres, Nonno récite ses poèmes, et même Shannon fait un petit profit sur les pastilles contre les troubles digestifs qu’il vend à son groupe de touristes... Le donnant-donnant, le parasitisme n’est jamais très loin, mais en même temps, c’est une nécessité vitale. Et c’est sur le fond de cette nécessité que la beauté se détache de loin en loin, gratuitement : comme une orange qui brille dans l’arbre, ou comme un geste de bonté, celui de Shannon détachant l’iguane à la demande de Hannah. Ou même comme le don que Hannah concède à ce représentant de commerce australien, quand elle accepte de lui remettre un sous-vêtement pour qu’il assouvisse son désir. Il n’y a pas de virginité qui ne soit un peu souillée, mais inversement, il n’y a pas de souillure qui ne garde un reflet ou au moins la possibilité d’une certaine pureté – du moins quand la cruauté n’intervient pas, comme le dit Hannah à propos de son aventure sur le sampan. Là aussi, c’est une histoire un peu sale et pourtant non, elle ne l’est pas, il y a là de l’amour, quelque chose qui mérite d’être appelé ainsi – c’est un incident un peu risible et pourtant non, pas tant que ça, et au fond, tout le monde en passe par là et doit accepter cela...
Sur ce point, il y a un passage, dans la pièce, qui est souvent coupé à la représentation : celui où il est question de la raclée humiliante que reçoit Shannon enfant, quand sa mère le surprend en train de se masturber... Maxine d’ailleurs met ce traumatisme en rapport avec les relations tourmentées que Shannon entretient avec Dieu...
C’est lié à la volonté, chez Williams, de casser la serrure et d’ouvrir toute grande la boîte du puritanisme américain, de libérer les récits non-dits que ce puritanisme a censurés. Après la révolution sexuelle, c’est peut-être devenu plus difficile pour nous de ressentir quels efforts il a fallu faire pour fracturer cette serrure. Il y a évidemment une dimension psychanalytique dans cet usage de l’écriture. C’est peut-être aussi ce qui a rendu Williams si proche d’une certaine époque. Mais ce qui m’intéresserait, c’est de vérifier qu’il ne se réduit pas à cela, ni à ce temps-là. Et que la délivrance qu’il raconte est une expérience qui nous parle encore : semblable à cette délivrance gratuite, sans raison, d’un animal terrifié et muet – même pas par compassion, mais plutôt comme un hommage rendu à la compassion d’autrui.
Propos recueillis par Daniel Loayza (décembre 2008).
"Georges Lavaudant épure l'oeuvre de Tennessee Williams. Dans La Nuit de l'iguane, à la MC 93, le metteur en scène impose la fragilité de Tchéky Karyo. L'être humain est une jungle. Ainsi le voyait Tennessee Williams, qui vit un retour en grâce, ces temps-ci. L'écrivain américain (1911-1983), tant aimé pour les films qu'il a inspirés, d'Un tramway nommé désir à Baby Doll, avait été laminé par les avant-gardes des années 1960-1970 : trop lourdement psychologique, pensait-on, trop naïf. Trop théâtral, pour tout dire. Mais le théâtre a ceci de beau qu'avec lui l'histoire n'est jamais finie : quand une oeuvre est forte, elle finit toujours par vivre une nouvelle vie, incarnée par de nouveaux corps. C'est ce qui arrive aujourd'hui à Tennessee Williams." Fabienne Darge, Le Monde, 19 mars 2009
"Monter Tennessee Williams dans un théâtre subventionné français est un vrai défi. Pour le relever, l’ancien directeur du théâtre de l’Odéon, Georges Lavaudant, inscrit la Nuit de L’Iguane dans une nouvelle perspective : entre émotion contenue et distanciation contrôlée, il évite les pièges du pathos à tout crin et rend justice à une écriture bien plus actuelle qu’il n’y paraît." Julie de Faramond, Fluctuat.net
La Nuit de l'lguane – Bande-annonce
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - MC93
MC93
9, bd Lénine 93000 Bobigny
- Métro : Bobigny Pablo Picasso à 472 m (5)
- Tram : Hôtel de Ville de Bobigny à 90 m (T1)
- Bus : Hôtel de Ville de Bobigny à 84 m, Karl Marx à 176 m, Maurice Thorez à 274 m
-
Voiture : A3 (Porte de Bagnolet) ou A1 (Roissy) ou RN3 (Porte de Pantin) sortie Bobigny / centre-ville ou A86 sorties N° 14 Bobigny /Drancy.
Parking à proximité (un parking gratuit dans le centre commercial Bobigny 2 est accessible les soirs de représentation)
Plan d’accès - MC93
9, bd Lénine 93000 Bobigny