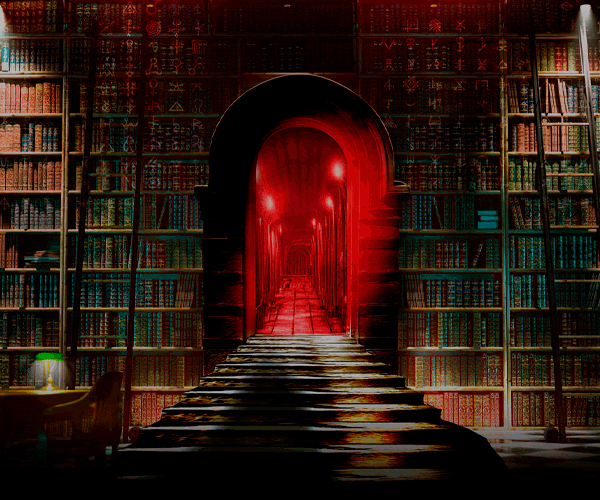May
May
- De : Didier Bezace, Hanif Kureishi
- Mise en scène : Didier Bezace
- Avec : Antoine Basler, Maya Borker, Patrick Catalifo, Jean Haas, Geneviève Mnich, Lisa Schuster
"Pour l’enfant, la mère est perçue comme quelqu’un d’intact et de puissant, de « toute mère ». C’est un des drames de l’humain que de s’apercevoir que la mère n’est pas que mère mais qu’elle est femme." Michèle Abbaye
Le moi de May
Saison 2006/2007 : d’une dissidence à l’autre…
Souvenirs et divagations d’Hanif Kureishi - extraits
L'autre et soi
May vient de perdre son mari, elle flotte entre le refus de vieillir comme une veuve ordinaire et l’absence de projet dans sa vie. Jusqu’au jour où, presque par hasard, un baiser la réveille et l’entraîne dans une expérience de jeune fille, retrouvant une part d’elle-même enfouie dans son coeur et dans son corps.
Parmi les mamans invitées au Théâtre de la Commune durant cette saison, il nous a paru indispensable d’accorder une place à May, peut-être la plus moderne d’entre toutes : mère ordinaire, épouse modèle, grand-mère sans histoire, May ressemble à beaucoup de femmes que nous connaissons ou que nous croyons connaître. Elle fait un parcours paradoxal, scandaleux au regard du rôle qu’elle-même et la société lui assignent. May se surprend et nous surprend, elle s’évade de son emploi par instinct de survie et part à la recherche d’une personne oubliée qui n’est autre qu’elle-même ; elle la redécouvre avec étonnement, plaisir et souffrance parfois.
Didier Bezace
D’après The Mother scénario original d'Hanif Kureishi, traduction Dyssia Loubatière.
Dans les rôles des enfants, en alternance : Laura Rosero-Melo et Antonin Pinguet, Valentine Cornier-Vinci et Valentin Bonetti, Océanne Bondeaux et Thomas Guillotte, Axelle Perrault de Jotemps et Obeid Mousa.
Il y a quelques semaines, nous vous invitions à découvrir sur la scène du Théâtre de la Commune, une mère combattante, insolente et joyeuse : La maman bohême de Franca Rame et Dario Fo ; sa révolte s’inscrivait dans un mouvement collectif de résistance à l’oppression des femmes à une époque où en Italie, en France et ailleurs en Europe, il semblait possible de transformer radicalement le monde, les institutions qui le gouvernent et les rapports entre les individus ; époque d’émancipation, d’insouciance et d’utopie, temps de générosité et de solidarité, moments de conscience collective où chacun pouvait se sentir soi-même avec les autres.
Presque quarante ans plus tard, Hanif Kureishi nous propose, à travers le scénario d’un film anglais, The Mother, le portrait d’une mère dont la résistance s’inscrit dans un contexte bien différent : tout semble être rentré dans l’ordre d’une société assagie - du moins apparemment - mais l’harmonie familiale, la réussite économique et sociale ne sont que le masque fragile et bien vite brisé d’un monde émietté où chacun lutte d’abord pour soi-même et où il semble difficile de trouver sa place.
May, femme ordinaire, mère et grand-mère sans histoire, au sens propre du terme, sent ce monde féroce se refermer sur elle et l’engloutir définitivement à l’heure où il faudrait accepter de vieillir seule. Elle s’en échappe, c’est un acte de survie solitaire et scandaleux aux yeux de ceux pour qui l’ordre de l’existence reste immuable, c’est un voyage narcissique vers elle-même pour sentir un peu de sa propre existence flotter dans un océan d’indifférence générale.
Maman bohême et May s’imposent comme deux figures emblématiques et contradictoires de la dissidence, elles nous parlent d’elles-mêmes à des moments différents de l’Histoire, elles nous parlent aussi du temps qui passe, des choses de la vie qui font que cette Histoire n’est pas la même selon que nous l’envisageons et la vivons comme un destin collectif ou comme l’addition d’aventures individuelles plus ou moins réussies.
La réflexion semble pertinente à l’heure, très proche, où certains choix de société cruciaux peuvent se poser à nous. Et je remercie toutes ces mères inventées par leurs auteurs et convoquées sur nos plateaux depuis le début de la saison - celle de Brecht, la Jocaste d’Anne Théron, Hélène dont Michel Vinaver fait un émouvant portrait dans sa pièce Dissident, il va sans dire, actuellement représentée au Théâtre de la Commune, la « Maman fatale » qu’Ilka Schönbein a su faire naître et incarner superbement durant le mois de janvier sur la scène de la grande salle à partir du récit d’Aglaja Veteranyi, Maman bohême créée en novembre et May d’Hanif Kureishi que nous vous présenterons en avril - je les remercie de venir nous parler si intimement de nous-mêmes en nous laissant interroger le cours de l’Histoire. Ainsi le théâtre travaille, émeut et nous réjouit, c’est bien ce que nous aimons en attendre, non ?
Didier Bezace, avril 2007
The Mother, un film de Roger Michell, scénario Hanif Kureishi, 2004
D’où viennent les histoires ? Quels sujets inspirent ? Où trouve-t-on les matériaux ? De quelle manière commence-ton ? Et pourquoi pose-t-on si souvent ces questions aux écrivains ?
Il ne s’agit pas d’aller pêcher des expériences. S’il en était ainsi, cela donnerait à penser que l’expérience offre une prise extérieure qu’on peut donc saisir. En fait, il s’agit plutôt de déterminer ce que l’expérience recouvre ; par définition elle est ce qui a déjà eu lieu. Comme l’amour et la haine, l’expérience commence chez soi : dans sa chambre ou dans sa cuisine. Elle naît au moment où les gens, qu’ils soient ensemble ou séparés, ont besoin les uns des autres et s’aperçoivent que l’écoute de ceux qu’ils aiment ne les satisfait pas. Les histoires, il y en a partout ; elles germent dans les sujets même les plus anodins.
Surtout dans ceux-là, comme aurait dit mon père, si le matériau est convenablement choisi, s’il est suffisamment malléable. Je dis « choisi », mais pour peu que l’écrivain y prête quelque attention, les histoires dont il a besoin pour donner forme à ses préoccupations les plus urgentes surgiront pour lui spontanément. Il y a des idées, comme il y a des gens, qui attirent l’écrivain. Il suffit d’attendre et de regarder. On ne saurait déceler pourquoi on a préféré cette idée-là avant d’avoir terminé l’histoire, si tant est qu’on y arrive.
La plupart des écrivains, dans une certaine mesure, ne comprennent pas pleinement ce qu’ils font. Ils flairent l’existence d’une piste, mais sont dans l’incapacité de la situer. Pour la découvrir, il leur faudra démarrer. Et ce qu’ils trouveront ne sera vraisemblablement pas ce qu’ils imaginaient ou espéraient au départ ; ils pourront même être surpris et déconcertés. Cependant cette ignorance peut être utile, et cette tension fructueuse - mais attention, il ne faut pas toujours compter sur elles.
Le maître Tchekhov nous a enseigné que c’est dans l’ordinaire, le quotidien, le quelconque -ce qu’en général on ne remarque pas - que se produisent les événements les plus extraordinaires et qui nous affectent le plus. L’observation du domaine de l’ordinaire se limite à l’expérience de chacun et à ce que signifie être un enfant, un parent, un mari, un amant. Pour les autres, la plupart des moments importants de la vie sont « insignifiants ». L’art consiste à montrer comment et pourquoi ils sont signifiants et pourquoi aussi ils peuvent paraître absurdes.
Le vieux Tolstoï croyait qu’il lui incombait de résoudre tous les problèmes de la vie. Tchekhov sentait que, en tant qu’artiste, on ne pouvait que poser ces problèmes sans leur apporter de réponses, et que, en tant qu’homme, on pouvait peut-être se montrer efficace ; Tchekhov, assurément, l’était. Mais pour l’écrivain, le scepticisme est préférable au didactisme ou au plaidoyer qui semblent tout régler mais qui, en réalité, ferment toutes les portes. Les solutions politiques ou spirituelles rendent le monde moins intéressant ; au lieu de mettre l’accent sur sa déconcertante étrangeté, elles le nivellent.
Au bout du compte, un seul sujet pour l’artiste. Quelle est la nature de l’expérience humaine ? Qu’est-ce donc qu’être vivant, que souffrir, et qu’est-ce qu’aimer une personne ou avoir besoin d’elle ? Dans quelle mesure connaît-on autrui ? Ou soi-même ? Autrement dit, qu’est-ce donc qu’un être humain ? Autant de questions auxquelles on ne pourra jamais trouver de réponses satisfaisantes, mais que chaque génération, chaque individu doit inlassablement poser. Le fonds de commerce de l’écrivain, c’est l’insatisfaction.
*
Écriture
Oscar Wilde, ce contestataire exemplaire, dont le châtiment n’a pas réussi à effacer les
propos mais qui nous a enseigné où pourrait nous amener une langue trop bien pendue, a écrit à la fin du XIXe siècle : « Quand les gens parlent des autres, ils sont en général
ennuyeux. Lorsqu’ils nous parlent d’eux-mêmes, ils sont presque toujours intéressants. »
Ce n’est pas une coïncidence si les systèmes politiques et sociaux qui ont dominé notre époque - communisme, capitalisme, fascisme, impérialisme, noyau familial, diverses variétés de fondamentalisme religieux, pour n’en citer que quelques-uns - comportent tous un élément remarquable. Il y a des circonstances dont on ne veut pas que les gens parlent, c’est d’eux-mêmes. Les tyrans imposent le silence comme une forme de contrôle. […]
Les récits collectifs découlent d’un accord implicite sur ce que devrait être l’avenir ou sur le choix à faire entre, d’un côté, les héros, les chefs, ceux qui appliquent une morale, et de l’autre, les démons, les traîtres, les méconnus et les mauvais. On peut dire aussi bien sûr qu’il s’agit là d’idéologies, de traditions, de croyances, de modes de vie ou de formes de pouvoir. Après avoir eu cours quelque temps, les récits se transforment en doctrines politiques, en institutions qui doivent être parfaitement lisibles et stables.
Où trouver alors l’intérêt, la friction dans la fiction ? En évoquant les catégories auxquelles on refuse le privilège de s’exprimer et de se faire entendre - immigrants, demandeurs d’asile, femmes, fous, enfants, vieillards, ouvriers du tiers-monde, exploités. […] Chaque système utilise sa propre méthode pour imposer le silence. Depuis les langues que l’on coupe jusqu’aux livres que l’on brûle, en passant par le moralisme sexuel ou l’interdiction dissimulée derrière l’indifférence, autant de façons différentes de faire taire les voix ou n’en choisir qu’une seule pour agir dans le secret. Si quelqu’un explique aux gens qui ils sont vraiment, tout en leur refusant le droit de se décrire, que, du moins pour quelque temps, ils sont contraints de le croire, il s’ensuivra un certain manque de confiance en soi ou une désintégration intérieure ; ce que l’on racontera sur eux les façonnera et les perturbera. […]
Ce silence forcé imposé par les puissants a un but : le difficile travail de la dénomination de l’Autre, le silencieux ; le nommera-t-on étranger, réfugié, immigrant ou demandeur d’asile ? Ce sera de toute façon un exilé, un intrus, celui qui n’est pas à sa place, qui n’est pas chez lui, et dont les mots ne comptent pas. Être chassé de la communauté linguistique, être dépouillé de ses propres mots, c’est être vraiment déshumanisé. […] Les bonnes raisons pour se taire abondent, comme en témoigneront de nombreux artistes et dissidents. En parlant on risque d’offenser, de blesser, d’effrayer ou de faire souffrir ; on est moralement condamnable ; au mieux on risque de ne pas être entendu. La faculté d’appréhender totalement une âme nous échappera toujours, comme celle de connaître à fond quelqu’un. Mais nous inscrirons au bénéfice des mots, des phrases et des récits leur inestimable impact affectif.
Nous ne connaîtrons jamais à l’avance la signification, à nos yeux ou pour les autres, de nos propres paroles ; encore moins comment le monde les recevra. Les effets de la parole, absolument imprévisibles, peuvent déboucher sur n’importe quoi ; en revanche nous savons avec précision à quoi ressemblera le silence.
Hanif Kureishi © Christian Bourgois Éditeur, 2003
[La solitude,] Ce n'est pas la même chose que l’isolement. Être isolé, c'est être coupé des autres : sans relations, sans amis, sans amours. État anormal, pour l'homme, et presque toujours douloureux ou mortifère. Alors que la solitude est notre condition ordinaire : non parce que nous n’avons pas de relations avec autrui, mais parce que ces relations ne sauraient abolir notre solitude essentielle, qui tient au fait que nous sommes seuls à être ce que nous sommes et à vivre ce que nous vivons. « Dans la mesure où nous sommes seuls, écrit Rilke, l'amour et la mort se rapprochent. » Non qu'il n'y ait pas d'amour, ou qu’on soit seul à mourir ; mais parce que personne ne peut mourir ou aimer à notre place. C'est pourquoi « on mourra seul », disait Pascal : non parce qu’on devrait mourir isolé (du temps de Pascal, ce n’était presque jamais le cas : il y avait ordinairement un prêtre, la famille, des amis…), mais parce que personne ne peut mourir à notre place. C'est pourquoi on vit seul, toujours : parce que personne ne peut vivre à notre place. Ainsi l'isolement est l'exception ; la solitude, la règle. C'est le prix à payer d'être soi.
André Comte-Sponville,
Dictionnaire Philosophique
© Collection Perspectives Critiques, PUF, 2001
Nul tapis rouge déroulé devant l’homme pour qu’il découvre le sens d’un accomplissement naturel et immédiat, mais au contraire une série d’obstacles sur la route de sa révolution intérieure. La réponse à l’appel que la reconnaissance de soi fait retentir d’abord sourdement ébranle un individu et lui prescrit de se découvrir. Face à lui se profilent alors des abîmes insondables mais attirants. […] « Je n’ai vu monstre et miracle au monde plus exprès que moi-même : on s’apprivoise à toute étrangeté par l’usage et le temps ; mais plus je me hante et me connais, plus ma difformité m’étonne, moins je m’entends en moi. » Constat sagace de Montaigne : l’homme est étranger à l’homme. Non qu’il croise seulement sur son chemin des êtres étranges, inconnus ou mystérieux, mais il représente pour lui-même une étrangeté, une inconnue, un mystère. Celui qui donc oublie de s’étudier ne rencontrera jamais personne. Qui accepte le « faces à faces » avec soi, celui-là entre en contact immédiat avec autrui.
Montaigne dessine assez bien le paysage auquel se trouve rapidement confronté l’homme qui se cherche et qui, pour cette raison, ne doit pas seulement consentir à l’inconnu, mais l’aimer. L’auteur des Essais n’affirme pas qu’il est parvenu à une idée précise de ce qu’il serait, mais que plus il se « hante » et moins il s’« apprivoise ». Il ne s’agit donc plus de penser toucher au port, mais de comprendre que celui-ci se dérobe à mesure de la traversée. […] Le succès ne relève pas de l’aboutissement, et tient au seul mouvement. Je dois accomplir ce voyage, sans espoir d’achèvement, et me contenter d’une série de reconnaissances. Tel est le prix de l’accès à autrui.
François Rachline,
Faces à faces, de l’indifférence de soi à la reconnaissance de soi
in Être indifférent ? © Collection Mutations, Éditions Autrement, 2001
Adieu, Grand Peintre de l’Univers !
Toi qui a dompté la plus noble forme de l’art
Dont les peintures des vertus envoûtent l’esprit.
Si le Génie te libère, lecteur écoute,
Si la nature t’émeut, verse une larme.
Si ni l’un, ni l’autre ne te trouble, passe ton chemin
Car c’est la poussière honorée d’Hogarth qui gît ici !
Épitaphe sur la tombe du peintre William Hogarth
enterré le 2 novembre 1764 dans le cimetière de St. Nicholas à Chiswick,
qu’Hanif Kureishi fait entendre dans The Mother.
À la fois graveur, peintre, caricaturiste et portraitiste, William Hogarth (1697-1764) fut très tôt reconnu par ses pairs comme le plus grand peintre et graveur anglais de son temps, et sa réputation d’artiste original et inventif, capable de réagir à l’actualité sociale et culturelle, ne cessa de croître. Aujourd’hui il est surtout apprécié pour sa fibre satirique, pour sa vision acerbe et parfois comique d’une société rongée par la corruption et l’hypocrisie, pour ses remarquables récits en images qui mettent en scène des personnages imparfaits ou maudits par le destin qui vivaient et mouraient en marge de la société respectable. Il fut un des premiers peintres à représenter de manière réaliste la vie quotidienne à Londres - alors la plus grande capitale d’Europe avec ses six cent mille habitants, et développa une vision forte de la ville moderne, lieu de délires et de fragmentations envahi par des foules grouillantes d’individus en proie aux désirs les plus divers et victimes des séductions les plus perverses.
Pour le critique d'art britannique Brian Sewell « Quand Hogarth dénonçait la corruption, la cruauté et la décadence de la société de son époque, il utilisait l'art aussi subtilement qu'un bélier. Il sentait intuitivement la nécessité de faire des réformes. [...] Ce qu'il a vu autour de lui dans le Londres de son temps a fait naître la colère et le zèle réformateur de Hogarth. [...] Pendant que les riches se gavaient, les pauvres mouraient de faim, volaient et étaient exécutés ; les fous étaient exposés comme des animaux de foire pour les sains d'esprit, la prostitution des deux sexes était un commerce organisé et le plaisir sexuel obtenu immédiatement et au hasard habituel. [...] » article de The Evening Standard paru dans Courrier International, le 13/02/2007
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Théâtre de la Commune
Théâtre de la Commune
2, rue Edouard Poisson 93304 Aubervilliers
- Métro : Mairie d'Aubervilliers à 395 m
- Bus : André Karman à 73 m, Mairie d'Aubervilliers à 297 m, Paul Bert à 357 m
-
Voiture : par la Porte d'Aubervilliers ou de La Villette - puis direction Aubervilliers centre
Navette retour : le Théâtre de la Commune met à votre disposition une navette retour gratuite du mardi au samedi - dans la limite des places disponibles. Elle dessert les stations Porte de la Villette, Stalingrad, Gare de l'Est et Châtelet.
Plan d’accès - Théâtre de la Commune
2, rue Edouard Poisson 93304 Aubervilliers